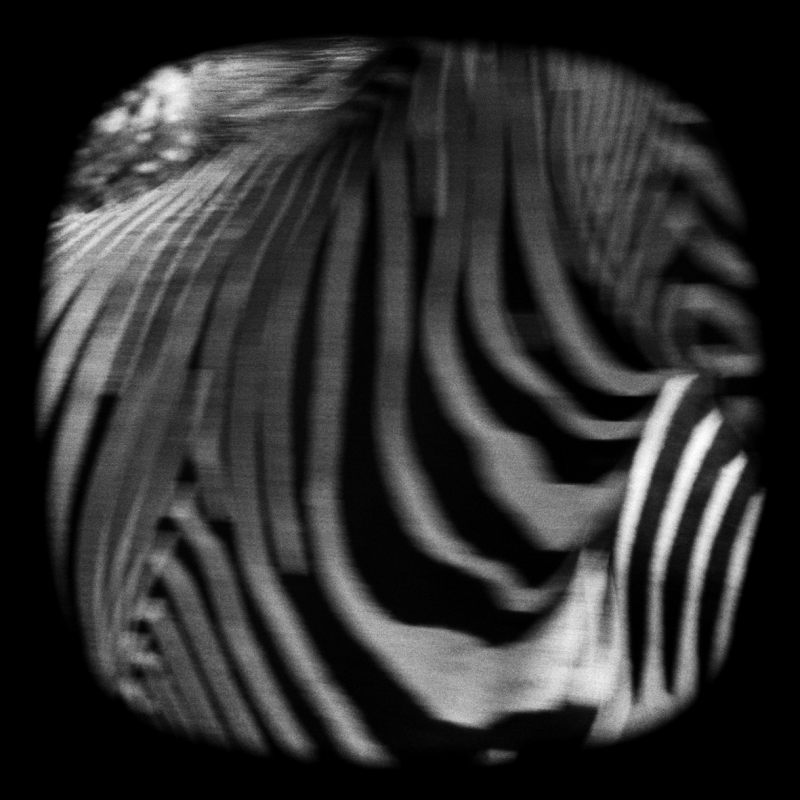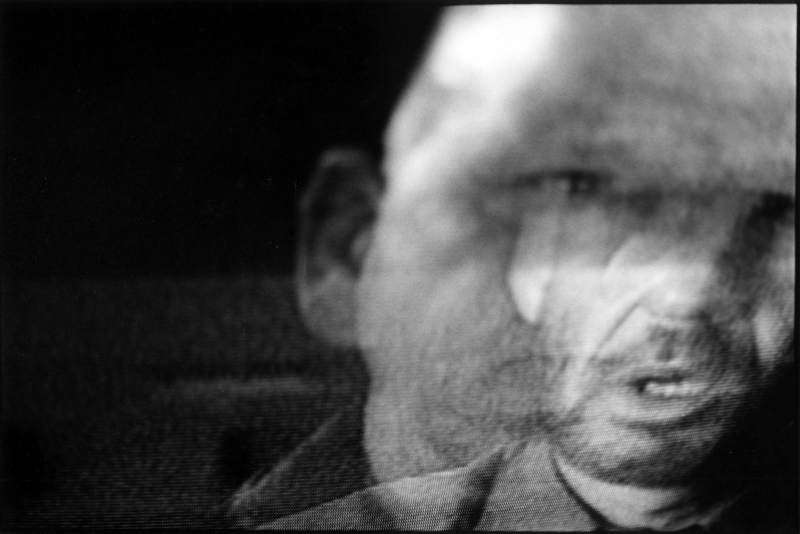L’intensité est silencieuse. Son image ne l’est pas.
(J’aime qui m’éblouit puis accentue l’obscur à l’intérieur de moi.)1
Hoy quiero hablarte como los árboles: con sombras
en el silencio más negro
quiero ser la estática temeridad del paisaje, el contexto
el verbo permanecer.2
C’est un nuage blanc gigantesque de Pía Elizondo3, sensation atmosphérique saisie hors du temps, présence arrachée, mobile, éclat, étal sans nom. Ou un poème de Coral Bracho4, étoilé sur la page, autre constellation de blanc, autre vibration bordée de silence. Même fugacité de présences capturées, à la fois silencieuses et hurlantes au regard, à l’écoute intérieure, traces bouleversantes, avènement « de la matière-émotion instantanément reine » (Char 1936 : 62) : l’image.
Image 1.
Puissance du voir et du visible qui ouvrent au lointain, ou face à face intime avec le monde, toile tremblante du poème ou de la photographie depuis le silence de papier, nous ferons ici le pari d’un même élan d’écriture photo-poétique qui engage le regard et l’écoute : mots, lumières et ombres en tensions silencieuses, surfaces d’empreintes bruissantes. Ainsi nous disons le poème comme regard (c’est le poème de Coral Bracho qui regarde et ouvre des visions au cœur du réel) et le regard comme poème (c’est la photographie de Pía Elizondo dans sa saisie du visible et sa part d’invisible qui crée de la matière poétique). Si « le poème reste d’abord une musique mentale, pour l’oreille interne » (Emaz 2009 : 31), si « la page est […] une sorte de musique d’œil où j’entends parfaitement rythmes et sons » (Emaz 2009 : 32), alors l’absolu silencieux est en partie défait. Ces échos mélodiques intérieurs viennent bien habiter l’espace de leur déploiement, dans les mots ou entre les mots, « à la clairière du langage » (Deguy 2016 : 20) ou au-delà, pour trouver quelque ancrage bruissant dans l’objet poétique ou photographique.
Nous proposerons ainsi d’aller par le jeu des graphèmes du clair et du sombre dans des oeuvres comme des planches de contact, territoires d'intensités, affleurements et résonances. Réunies ici par leur singulière convergence, poésie et photographie posent en effet le problème de la figurabilité du silence et de sa circulation dans le sensible. Résolument non documentaires mais façonnés comme « matière-émotion », ces deux corpus constituent des gestes lyriques qui condensent leur technicité propre de mot et d’image. Comme levées dans le silence de la langue ou du monde, la poésie et la photographique posent une manière d’interloquer le dire et le voir pour laisser passer de l’autre. C'est bien la force de l’image de laisser ouverts les connexions de sens, les échos, tout tissage. Image photographique ou métaphorique de la poésie, quand « les mots sur la page travaillent à une approche, une présence » (Emaz 2009 : 33) ; laissent « flotter le sens » (Emaz 2009 : 32). Et cette suspension est à la fois vecteur de l’incertain et du bruissement qui s’arrache au silence. Elle est une touche, un fond qui s’ouvre et qui permet la palpation du regard et celle du dire. Elle place la visibilité et la diction en tension avec ce qui leur échappe, joue avec la précarité des limites, des repères, des compositions : il y a ce qui est happé par l’ombre, qui forme quelquefois une part significative du poème ou de la photographie (Frizot 1998 : 6) et qui devient énigmatique, trouée par laquelle la vision, la pensée, l'existence se remet en jeu. Il y a ce qui est là, rendu fragile, intermittent, là où ça replonge dans l’obscur, par contraste, par aveuglement. Là où ça se transfigure, où se projettent les formes indécises et mouvantes ; un là voyant aussi, espace ouvert où le proche appelle le lointain. Poésie et photographie engagent des manières de penser l’intensité et la résonance de l’image et les formes de silence ou d’abîme qui y sont attachées : absence, solitude, lointain, réserve de temps ou de souffle, ce qui tait ou qui est tu car « ne se laisse ni posséder ni nommer » (Starobinski 1968 : 14) ; mais aussi contre-jour, saturation, surexposition, ce qui suspend, ce qui risque ailleurs, matière ombreuse, trouée ou scansion de blanc.
Ce seront précisément nos temps d’exploration de quelques poèmes de Coral Bracho placés en vis-à-vis de photographies de Pía Elizondo, deux artistes mexicaines et cosmopolites qui habitent poétiquement mondes et regards.
Taire
La coulée de l’ombre
En esta tierra de larguísimas sombras
el rostro de lo que vive
dura sólo un instante;
y el de lo inerte,
también (Bracho 2015 : 75).
Comme ces vers de Coral Bracho, de nombreux textes contemporains5 tirent de l’ombre une force silencieuse à partir de laquelle interroger la perduration du réel dans l'image, dans ce qu'elle garde du monde et du temps qui s'écoule. L’ombre habite ici le poème dans sa matérialité, étirant loin l’encre du premier vers de manière presque performative, et ramassant au-dessous des traversées de lueurs, toujours plus brèves, réduisant la possibilité du visible à un « contreseing de l'ombre » (Frizot 1998 : 7). C’est l’indéfini augmenté par le neutre (« lo que vive / lo inerte ») qui dit la fugacité de l’instant, puis l’effacement. Ainsi se modèle l’incertain, par surexposition ombreuse et extrême précarité du visible bientôt entouré de silence. Les vers eux-mêmes constituent l’espace fugace du dire, incarnation momentanée. Le poème fait ainsi de son lieu le lieu où quelque chose passe, se passe, est dépassé : incertitude organique, proximité du non-être, surgissement et disparition. Le poème reproduit des lisières de silence qui miment dans l’ordonnancement des vers l’extinction du dire.
D’autres fois pourtant, le taire semble insuffisant à contenir le besoin de langage, l’étrange autonomie de la pensée :
Es una ficción
este cuarto,
estos callados pensamientos. Vienen
como fantasmas, como impulsadas
bailarinas entre el aire polar, se angostan
y se contraen,
se pierden (Bracho 2007 : 17).
C’est peut-être une chambre d’hôtel, où s’impose un espace d’immersion dans l'indistinct, espace de métamorphose, de visions silencieuses, d’apparitions spectrales. Il y a là comme une lutte avec le visible, risque d'asphyxie, friction d’altérités : surgissement de pensées tues, blanches, évanescentes. Une tentative renouvelée pour s'accommoder quelque part, se retrouver dans le brouillage de l’informulé, des images et des mots où se lovent la perplexité et la quête devant le séjour même que constitue le vivre.
Dans ce carré noir très dense, un rideau tiré devant une fenêtre (dont un montant à peine se devine à droite) est saisi en contre-plongée oblique au centre de l’image. C’est la première photographie de la longue série Songe d’oubli. L’ondulation des plis verticaux barrés de lignes produit du rythme, du mouvement sur l’à-plat du noir. L’oblique rectangulaire et ondulante du rideau figure une présence vaguement fantomatique, rappelant la comparaison de Bracho dans les vers précédents. Le noir dense de cet intérieur vient buter contre le clair du rideau, produisant une étrange écriture de la lumière qui précisément ne laisse pas voir. Il y a obstruction de l’extérieur par le plus clair, de l’intérieur par le plus obscur. Le visible se réduit à son empêchement : le rideau tiré constitue l’horizon, condamne à l’horizon intime non identifiable, le silence fait masse.
Image 2.
De ces deux objets poétique et photographique, se lève quelque chose qui s'écrit contre le réel, qui s’éloigne de la matérialité, « puissance fictionnelle d’apparitions » (Bailly 2008 : 26) qui bute contre l'ombreux du monde. Quelque chose d'aveuglé au-dedans qui se déporte, faisant disparaître l'horizon, l’au-delà. Quelque chose là aussi, du côté de la photographie, dans l’épaisseur du noir, de la même masse d’invisible : le rideau, à l’étrange flottement immobile, suspendu dans l’obscur, sans attache visible dans l’indistinct, tranchant légèrement oblique sur un corps d’ombre.
Le visible rendu en partie inaccessible – ses objets altérés par l’absence ou le flou des contours – est tu ; et sa réalité, mise en question, demeure informulée : toutes les formes de silence « détourent la silhouette » des choses, « inventent l’inachevable » (Deguy 2016 : 49).
Dans les mots de Deguy encore :
Écouter ce que ne dit pas – la pierre
ni la feuille ni l’oiseau ni la foudre
L’ouïe consultante opérée par la langue
fait parler les choses en signes de sourd-muet
Un dialogue peut se nouer autour
des sémaphores du visible (Deguy 2016 : 24).
L’informulé constitue le ressort d’un autre langage silencieux, vecteur d’échos pourtant et de signes parfois tracés dans l’air. Avec ce carré de neige en sourdine et quatre rameaux plantés dedans (sans titre, Songe d’oubli, n°7), en gros plan (détail du tout proche), s’impose à son tour une écriture de signes, de fragments : les tiges noires se prolongent hors cadre, on n’en saisit que la partie affleurante.
Image 3.
L’ample vignetage de la photographie rend plus lumineux le centre de l’image, rythmé par la scansion végétale contrastant en forme, en couleur et en matière avec le fond granité de la neige. A ces matérialités en collision, s’ajoute l’étrangeté des signes produits par ces tiges noires qui écrivent littéralement quelque chose sur le blanc. Mime de lignes majuscules, un X un H un I, des césures, l’élan et la brisure. C’est un paysage par définition silencieux qui pourtant trace et dit quelque chose depuis la cristallisation de la neige. Pas tout à fait une nature morte qui fut longtemps le paradigme du silence en peinture, mais plutôt une forme d’écriture de textures silencieuses, émergence fragile et résistante d’un nouvel alphabet optique. Une problématique assez peu étrangère à la poésie, et au hors lieu du poème.
C’est presque l’image inverse : maintenant la frondaison nue et éclairée sur fond de ciel gris très dense (sans titre, Songe d’oubli, n°28). La pointe des branches léchée par un halo qui s’étire en cercle au centre de l’image. C’est le bas qui disparaît hors cadre, déplaçant la perspective à une cime dénudée contre le ciel, à la masse opaque, comme filtrée, touchant au lointain indéfinissable. Il y a bien du silence là encore dans le regard contemplatif que propose l’image. Le rythme de la lumière qui oscille, produit un effet de trapèze éclairant en discontinu sur fond de silence.
Image 4.
La fragmentation de l’arbre, de l’arbuste, de la plante – précisément on n’en connaît pas l’échelle ce qui rend l’objet en partie insaisissable, irréductible à son silence –, déplace la perspective vers le lieu du contact, l’élan, là où la pointe végétale touche le ciel, produit du dialogue incertain depuis l’isolement. A nouveau, la photographie se donne à voir comme le lieu d’une écriture en graphèmes solitaires, noirs et blancs, signes en réseau de textures contrastées, nues dans le silence.
Image 5.
Taire aussi se déclinera en présences d’informulé, d’indistinct, d’incertain, à base d’effacement, d’empêchement, de fragmentation, d’abstraction de signes. Pour ces poèmes et ces photographies diversement en prise avec le silence, taire deviendra faire place au hors lieu, hors lieu du poème par la contraction des vers, des images mêmes et leur brouillage sémantique, hors lieu photographique par cadrage aux confins de l’inerte, empêchant toute vision totalisante.
Suspendre la syntaxe du monde
A l’image de Bachelard explorant l’instant poétique, il faudrait travailler le moment suspendu de l’instant photographique. L’instant où le regard capte et capture, séparant un fragment du réel du cours du temps, libérant de tout lieu. Suspendre : retenir dans le silence. Surprendre le sens par l’instant, instant de pause ou instant du clic :
La vida puesta en duda un instante
de luz, sombra, luz;
de sombra, luz entre coches tasajeados
y giros (Bracho 2011 : 67).
Suspendre le sens par le son, par la profondeur du « u » espagnol qui s’égrène dès le premier vers et revient habiter l’alternance « de luz, sombra, luz; /de sombra, luz ». Suspendre par le rythme battant de l’image poétique déjà éminemment optique (juxtapositions lumière / ombre / lumière), par cet étonnement qui naît de l’effet stroboscopique de la robe du zèbre et l’intense vignetage de la photographie (sans titre, tirée de la série Jungla de asfalto) qui échantillonne le visible en isolant l’encolure, et qui en fait un paradigme graphique sublimé par le flou de mouvement. Bougé du poème et bougé du cliché saisissent l’instant interrogeant, la suspension où se créent souffle ou palpitation qui s’ébroue, vertige des « giros » et rotation des courbes noires et blanches. Prélevée du réel, l’image réinvente du son, rumeur-mouvement.
Sur fond clair plutôt uniforme, une plateforme lévite au milieu de l’image et du ciel (sans titre, tirée de la série photographique Mar). Elle est saisie dans une contre-plongée qui la prive d’ancrage et l’abstrait potentiellement du monde. L’installation semble de plastique, comme ces installations de plage, celles des jeux pour enfants et celles des sauveteurs en charge des baigneurs. Une chaise laisse penser à cette vigie. Des escaliers montent à l’avant, soulignant ainsi la diagonale de l’image, et mènent à la plateforme circulaire couverte d’un chapeau peut-être soulevé par le vent. A l’arrière, le mât soutient la structure doublé d’une échelle, équilibrant la composition d’une deuxième ligne graphique, ainsi que d’un trapèze. Entre les deux, pendent des bouteilles, comme les lests d’une nacelle improbable. Des morceaux de toile, une bâche rendue en partie illisible, repliée vers l’arrière, semble avoir violemment été secoués par le vent. L’image est mordue par le flou aux quatre angles sous le même effet du vignetage qui estompe les limites des objets – peut-être des cocotiers dont les têtes affleurent à peine, premières marches de l’escalier, en un bougé qui fait déborder le noir. Etrange et solitaire, face à la mer dont on devine la poussée, cette plateforme qui s’incruste contre le ciel, et son double cercle central en position de nœud visuel (presque une bouche ouverte) au cœur de l’image, ne dit rien mais porte les stigmates du mouvement-son (claquement, sifflement, réponses de la matière au vent), à la fois finisterre aérien promontoire de silence, et avant-poste onirique du souffle marin.
Image 6.
Instant d’étonnement poétique et photographique, surgissement de l’inespéré, pouvoir de la métamorphose : l’image bruissant par-delà son décor de silence, soulève la syntaxe du réel.
Yo me volvía yo, un paréntesis, un alado caer
de infinitivo, un caer lentísimo
parvada de aves azules con voluntad
de precipicio. (Rivera Garza 2005 : 133)
Avec Tiempo vertical, n° 13 (sans titre), saisie du dindon en trapéziste, aux confins surréalistes, l’image est spectaculaire : la dépouille lisse, illuminée, tendue, cage thoracique pointant sous l’effet de la gravité (le poids du cou et de la tête pendante, tranchée encore par le carré de lumière à l’arrière-plan) contraste avec le déploiement maximal des ailes toujours emplumées. On voit l’intérieur du plumage, la découpe en ailes de papillon hachurées de noir et blanc, les ailes précisément comme des parenthèses ouvertes (« un paréntesis, un alado caer »), figurant le mouvement et pourtant inertes.
Image 7.
L’effet optique du plumage latéral s’étire en lignes successives incurvées, hyper graphiques, redoublées à l’intérieur par la ligne des plumes plus courtes, et celui de la queue, plus sombre et ramassé. La composition fait naître quelque chose de tragique et de ridicule, porté par l’obscénité silencieuse de la mort. Quelque chose qui dépasse la bête, transfigurée par l’intensité des contrastes dans le passage de l’ombre à l’étrange lumière crue, sacrifiée et saisie dans ce déploiement en croix, dans le lien qui maintient les pattes et l’étrange nudité presque absurde, suspendue comme une offrande, tout au fond du précipice. On en devine l’accroche, dans la masse noire du haut de la photographie. Le parcours de la lumière fait dialoguer le corps, la base du thorax, la membrane des ailes, les flancs, les cuisses, avec le cadre qui se découpe entre les immeubles. Quelque chose d’improbable, d’incongru dans ce décor urbain (édifices hauts, juxtaposés, créant un cadre de béton, néon lumineux et bouche de climatisation) enserrant à l’intérieur. Précisément, c’est la saisie de l’envers d’un décor : envers du décor des étroits patios urbains, profonds comme des puits, et celui de l’animal pendant à l’envers dans cet envers de solitude, monstration d’un sens dessus dessous. L’effet de contre-plongée augmente et intensifie l’étrangeté de la métamorphose, en fait un surréel. Comme dans les vers performatifs de Rivera Garza, « un alado caer / de infinitivo, un caer lentísimo », il est bien question de la chute. Si l’oiseau conserve ses attributs aériens, pourtant il pend, dans un dernier vol immobile offert à la lumière depuis l’intérieur de l’arrière-cour, sur l’intérieur des ailes. Quelque chose de l’illusion vitale, de la figure de style : paradigme du battement des ailes dans la pesanteur. D’où l’évidente résonance du titre de la série, Tiempo vertical : la ligne descendante qui axe la photographie, l’impact de l’éclairage, la gravité qui dit inexorablement la chute. La courbure contre l’angle droit, la chair contre le béton. Même la lumière tombe.
Dans le dialogue de l’image et du poème, l’acte de voir nous mène, nous ouvre à un vide qui nous regarde, nous concerne et, en ce sens aussi, nous constitue (« yo me volvía yo »). Il nous place ici doublement face à notre trajectoire marquée par la gravité – au sens de la chute – et face à l’altérité – au sens de la dépouille : « la modalité du visible devient inéluctable – c’est-à-dire vouée à une question d’être – quand voir, c’est sentir que quelque chose inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir, c’est perdre » (Didi-Hubermann 1992 :14).
Précisément la série photographique Te Ve, (dont nous produisons ci-après le premier cliché, sans titre) presque une glose du titre de Didi-Huberman (Ce que nous voyons, ce qui nous regarde), provoque une sorte d’inquiétude visuelle devant des images comme des monuments de solitude. S’il y a suspension là, c’est suspension du lien, du son, du sens, image dépouillée. Suspension des contours des visages, des objets, des perspectives, qui produit du flou, du difforme.
L’adversité du visage de l’homme, pris dans la servitude du cadre de la télévision, très expressif, presque expressionniste, (on pensera à Lucian Freud, Munch ou Bacon) à la bouche entrouverte figée dans la sortie du son, nous mène à l’hébétude. Notre inquiétude, notre perplexité : celle du dédoublement, portrait redoublé, potentiellement aussi autoportrait du spectateur. L’image en partie superposée produit du bougé : tremblement du sens, chaos augmenté par l’aspérité du grain brut de l’image qui compose un ensemble violent, d’enfermement et d’incertain. Le ressort photographique tient à la mise en abîme qui abîme, isole, refuse à l’évidence. L’image est perturbée et perturbante.
Image 8.
Elle configure la friction interlope d’ombres et de lumières, de contours défaits. La série dans son ensemble constitue un tableau précaire de touches élaborées par le parasitage. Le travail rend manifeste ici des espaces obscurcis, des visages, des paysages mis à distance : le cadre devient espace d’aveuglement du sens par réverbération, distorsion. C’est une figure labile, en partie illisible, qui compose encore un étonnant tête à tête avec ces vers de Coral Bracho :
Un espejo vacío
entre muro y muro, entre borrados rostros
y oscuras distancias somos. El hueco
entre palabra y palabra. Entre espacios que ocultan
y el vasto esplendor del día. -Encendido,
resonante vitral. (Bracho 2011 : 35)
La présence du miroir sans reflet se livre, intercalée, dans le murmure, « entre muro y muro », et la construction d’un paysage sonore qui dit l’effacement. La perte du visage, siège de l’identité6, l’inconnaissable profondeur, les formes du vide (« vacío » / « hueco ») configurent (défigurent) l’être par le silence. L’épaisseur sonore du poème (qui multiplie aux vers 2 et 3 notamment les combinaisons acoustiques des « u », « o », « b » et « r ») se déploie en tension ombre/lumière, dans tous les interstices produits par l’enjambement : la syntaxe du monde se fissure et fait naître de l’entre, filtration de lumière vibrante, lumière ardente qui devient résonance…
L’image mouvante et/ou bruissante, parfois entourée de torpeur, finit par installer un lieu autre, fascinant, dérangeant, précaire. Arrière-cour létale, espace béant de solitude, écran de télévision, la présence mondaine, comme le portrait, s’y donne comme dépouille, fragment, perturbation, comme syntaxe défaite, suspendue. Semble à l’oeuvre une radicalisation du langage poétique et pictural, où a migré tour à tour le trivial et le mystère, le détail et le panorama, comme formes de sidération du voir et du dire. Pourtant, l’intensité s’impose par-delà l’aphasie, par exemple dans le retournement de la brutalité de l’image vers le spectateur, et l’éveil d’échos intimes quand c’est le jeu d’ombre-lumière qui produit du son.
Risquer, depuis la nuit
La vue répand l’infini
Me jette à l’embouchure du monde7.
Image 9.
Hors du noir, comme brèche dans le langage ou l’image, s’engagent ailleurs les mots et la vision. Ici (première photographie sans titre, de la série Camera Obscura), la lisière de l’ombre projette loin au-devant cette lentille de ciel et d’eau, comme en suspens, à la lisière du temps mythique : une autre embouchure du monde.
La courbure des branches nues, l’emmêlement des lianes nouées à la mangrove peut-être, constitue un plan intermédiaire qui accentue l’intensité de la perspective. Les noirs cerclant l’image sont profonds, les ombres végétales diluées comme des traînées d’encre : c’est la merveilleuse imperfection du sténopé. C’est le dépôt du temps rendu visible, qui densifie la matière, lui confère épaisseur, indistinction. Cette plastique à la longue vue figure, là, comme la saisie d’un monde de l’origine, cercle hors du temps chronologique, hors du langage humain, surface plane, cycle lisse de ciel et d’eau, où l’effet de lointain optimise la résonance du silence. Pourtant, la tension de l’image suggère potentiellement une sortie vers le sonore, vers les expressions possibles du végétal et des éléments naturels : imperceptible frisson des arbres, froissement, bruissement, bourdonnement, ondoiement. Risquer, c’est ouvrir la matière, la perception, l’œil ou l’écoute ; espacer mondes et mots pour faire circuler le souffle :
Fluida plenitud que nos ciñe, nos rodea, esta compleja y fina
brevedad de la luz,
que traza
y funda, abre prodigios entre las ramas, entre los muros,
entre los filos de las rocas: Al filo
de un abismo
vivimos; al filo deslumbrante y fugaz del aire,
honda caída transparente
hasta los contornos.
Y esos contornos somos, ese abismo,
y la furtiva pradera de tonos cálidos, suaves, que arrastra el sol
a la alta orilla de la noche. (Bracho 1998 : 35)
S’aventurer, créer du passage pour la lumière, refaire le parcours du jour, d’une rive à l’autre (« que arrastra el sol / a la alta orilla de la noche »), imprime du son. Dès les premiers vers, coule l’assonance décisive en « u » (« fluida plenitud / luz ») qui ouvre dans le poème les sons en miroir d’espaces interstitiels (« entre las ramas, entre los muros »). Se tissent des systèmes d’échos par parallélismes syntaxiques, répétitions (« entre los filos » / « al filo » / « al filo ») , par allitérations (en « br »/ « pr »: « abre prodigios », en « s » : « esos contornos somos, ese abismo »), des résonances plus discrètes, notamment, encore, à partir de « luz » : « traza / y funda », une lumière disséminée en trace, en fondation, ou plus loin « alumbrante y fugaz »… Une lumière qui constitue le détonateur, le déclencheur de métamorphoses : puissance de révélation de lointains enfouis dans la matière du poème, elle permet (en termes bachelardiens) de profonder le réel (« abismo » / « honda caída »). Il y a bien une magie du passage de la lumière « que traza / y funda, abre prodigios entre las ramas ».
Image 10.
Et c’est bien la même fenestrité prodigieuse en acte dans la photographie de Pía Elizondo (dernière photographie sans titre, de la série Songe d’oubli), qui à son tour ouvre une trappe de blanc triangulaire dans le fatras de la matière végétale très sombre, se risquant justement hors de l’aveuglement du noir par contraste. Le plissement de l’eau et ses effets variables de texture et de profondeur, porte la trace d’une écriture de la matière non silencieuse propre à la lumière, qui modèle ici aux confins obscurs une spumeuse transparence.
Fenestrité encore, trappes de blanc poématiques, qui creusent le réel, multiplient les confins, relient : où risquer l’aveuglement du blanc pour faire entendre…
Este huerto, este rapto
que heredamos
como una abierta melodía entre la noche, como un
[destello,
una pregunta,
este cuerpo
*
y su sed.
-De allí nos hablan,
de allí nos llaman, como entre sueños.
De un sueño a otro
nos llevan.
De un sueño a otro nos trazan, nos transparentan. (Bracho 2004 : 50)
Ce sont les mêmes gestes de respiration à valeur épiphanique : le poème à son tour se trouve perforé, largement espacé, aveuglé de blanc et pourtant voyant, intensément sonore. Les marges se dispersent, les strophes s’ouvrent, s’éparpillent, la ponctuation s’ensauvage : naissent ainsi d’inattendus dialogues, et avec eux des syllabes en résonance conduites par le silence intermittent, un autre prisme bruissant où de nouvelles parentés nous lient tout au bout à la mort même. Dans l’intervalle du poème toutefois, comme les vers migrant des marges, la vie s’affirme cheminement, parcours d’imaginaire qui enjoint de profonds contours où fécondité rime avec éclat (« huerto/destello »), où la fissure du chant, sa plaie, devient tracé de lumière au creux de la nuit, alliance lumineuse des contraires dans le chant (« abierta melodía entre la noche »). Dans ce creusement qui signe une dynamique de l’ajout et de l’ampleur gagnés par l’obsession de « l’entre », le corps devient matière, inquiété par l’aridité de la soif, comme une clôture. De cette quête (« pregunta »), naît un appel incandescent comme une flamme (« llaman »). L’intensité de la convocation poétique crée le bruissement de l’image qui tour à tour glisse comme un fluide et crépite pour à la fin venir habiter le même en le révélant.
L’abîme du dernier vers en effet, modelé par la pause silencieuse, déporte plus loin la transparence au rivage de la plus intime parenté (« trans-parentan ») : où la vie et la mémoire puisent dans la mort les racines de notre être traversé. C’est bien une réserve de silence qui nous lie à l’enfui. La mort filée s’étire d’un mot à l’autre, d’un corps à l’autre par-delà les trappes graphiques des intervalles. Le blanc ainsi, dans sa présence apparemment silencieuse, est épiphanie frémissant des échos qu’elle transporte et conduit à la révélation des soubassements de l’être.
Comme matière et mode de rencontre sensible, les poèmes voyants de Coral Bracho et les photographies cernées de noir de Pía Elizondo expriment la profondeur des manières d’être au monde. Leurs passerelles : la tension précaire avec ce qui leur (nous) échappe, une écriture tissée par la lumière et ses échos qui transforment la syntaxe du réel, la transportent, la soulèvent, la dépassent. Dans l’objet photopoétique qui combine ainsi art du regard et de l’écoute, se livrent rythme, volume, épaisseur rarement tout à fait silencieux, une manière d’habiter et d’interroger l’espace pour en faire un lieu de résonance. Si dans l’approche du monde, textes et images semblent d’abord saisir une irréductibilité du silence – présences contemplatives, objets inertes, trous, abîmes, suspensions, défigurations, incertitude – les compositions photopoétiques pourtant produisent et tamisent du son, excitent sa transmission, fabriquée pour l’oeil quand l’image bruisse, ou l’écoute intime. Froissement de l’étoffe ou du végétal, rumeur de l’eau, de l’air, halos de sourdines urbaines, fugacité crépitante de l’instant, bruits perdus de l’invisible, manifestent le bouleversement du regard dont « l’émotion laisse sans voix » (Emaz 2009 : 31).