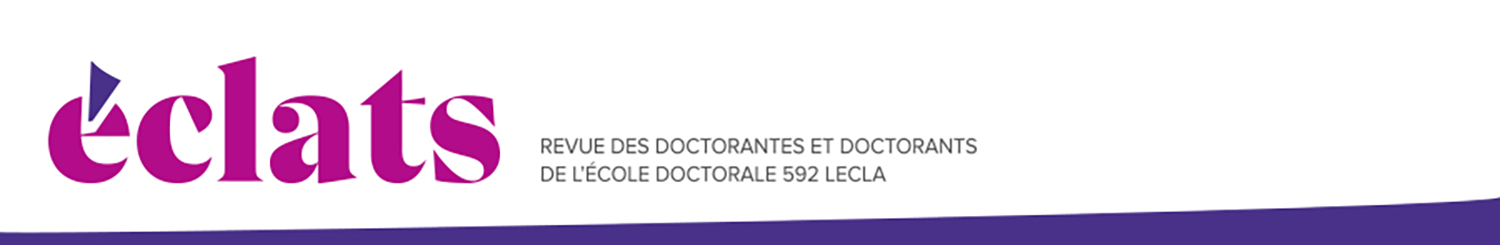Introduction
Depuis le xixe siècle, la communauté chicano – les Américains identifiés à une culture mexicaine‑américaine – produit des ouvrages littéraires dans leur combat pour préserver leur intégrité culturelle et un sens d’unité (Saldivar, 1990, p. 3). Ces textes anglophones riches en détails vivants de la condition « d’étrangers dans leurs propre pays » (Savin, 1998, p. 21), attirent l’intérêt français dès les années 1980 et 1990, époque où la France commence à faire face à sa propre réalité plurielle et postcoloniale (Geweke, 2012, p. 108). Pendant cette période, des traductions d’ouvrages chicanos1 et des essais critiques (Roncard, 1980 ; Grandjeat, Andouard‑Labarthe, Lerat & Ricard, 1990 ; Savin, 1998 ; Tréguer, 2000) apparaissent sur la scène littéraire française, de même que des colloques qui s’investissent à rendre plus divers l’imaginaire états‑unien2. Pourtant, comme le montre Crystel Pinçonnat dans son étude comparative des récits franco‑maghrébins et hispanique‑états‑uniens, Endofiction ou fable de soi : écrire en héritier de l’immigration (2016), cet intérêt scientifique reste sporadique et généralement soumis au gré des intérêts spécifiques des éditeurs. Elle remarque ainsi que beaucoup de traductions des textes chicanos publiés dans les années 1990 comme plusieurs textes de la littérature franco‑maghrébine ne sont plus disponibles dans leurs catalogues d’édition et sont souvent mis dans l’ombre des réserves et hors des rayons des bibliothèques françaises. Elle met en relation ce phénomène avec le désengagement du système éducatif français pour la découverte de la réalité des héritiers de l’immigration en France ou dans le monde3 (p. 355).
Ce faible intérêt académique et culturel pour la littérature des minorités en France peut‑il s’expliquer par le réflexe des lecteurs et critiques français à considérer les auteurs issus de la migration comme étant des étrangers4 ? En ce sens, explorer les possibilités culturelles de la littérature chicano, inscrite sur une longue tradition militante qui se revendique en tant qu’états‑unienne, peut‑il inviter le lecteur français à la concevoir hors des débats politiques français et au contraire dans une optique qui porte sur l’hétérogénéité de l’individu contemporain ? Face à cette dimension sociale de la littérature chicano, dans cet article nous proposons d’étudier la traduction française du roman Caramelo (2002) de l’écrivaine chicana Sandra Cisneros publiée en 2004. Plus spécifiquement, nous chercherons à voir comment cette traduction illustre la question du passage de la voix chicano dans une autre langue et culture. En premier lieu, nous analyserons l’hybridisme linguistique et culturel du texte original et les études qui abordent sa traduction dans d’autres langues pour montrer les enjeux de sa traduction dans la langue et la culture française. À partir de ce plan comparatiste, nous évaluerons ensuite si les stratégies employées par le traducteur français pour traiter cette voix Autre parviennent à insérer les perspectives de l’écrivaine.
Langue et identité transnationale dans Caramelo et la littérature chicano
Sandra Cisneros, représentante éminente de la littérature chicano, a connu une grande popularité lors de la publication de son roman The House On Mango Street (1984), traduit en plusieurs langues (y compris une traduction française, désormais épuisée, par l’écrivaine et traductrice Annie Saumont en 1997). Elle appartient à la génération postérieure au mouvement chicano des droits civiques des années soixante qui réfléchit sur la position complexe de la femme chicana, aliénée à sa culture d’origine et « étrangère » dans la culture dominante (Anzaldúa, 1987, p. 20). De plus, ses textes faisant souvent appel au Mexique dévoilent l’intérêt de l’écrivaine pour construire un espace littéraire interaméricain destiné à mettre en dialogue la civilisation états‑unienne et la mexicaine (Savin, 1995, p. 577).
Après la publication de recueils de nouvelles et de poésie et son incorporation à la Heath Anthology of American Literature qui lui fit une place dans le canon américain des années 1990 (ibid., p. 576), Cisneros publie en 2002 son second roman, Caramelo or Puro Cuento, aux éditions Alfred Knopf, une division de Random House, l’un des plus grands groupes d’édition américains. Ce roman présente en plus de quatre‑cents pages le récit de filiation de la jeune américaine Celaya « Lala » Reyes et de ses ancêtres mexicains, espagnols et mexico‑américains tout au long du xxe siècle. Compte tenu du caractère transnational et transhistorique de l’intrigue, Caramelo est devenu le sujet de diverses études sur son langage informé par la langue espagnole et sur les cultures mexicaines et mexico‑américaines, des aspects essentiels pour comprendre les défis de sa traduction.
Certes, l’analyse de l’hybridité linguistique dans l’écriture de Cisneros et d’autres écrivains Chicanos n’est pas neuve dans les études de littérature chicano en France. Ada Savin consacre dans son étude littéraire et sociologique Chicanos aux États‑Unis : étrangers dans leur propre pays ? (1998) trois chapitres aux aspects linguistiques des Chicanos qui sont des traits saillants de leur tradition littéraire :
[…] Ce qui frappe le plus le lecteur [de la littérature chicano], c’est la marque que ces tensions culturelles impriment sur la langue même qui les véhicule. Le lexique et la syntaxe indiquent en effet à la lettre la complexité des paramètres qui président à l’élaboration de tout énoncé pris entre deux langues. (p. 10)
Parmi les pratiques linguistiques des Chicanos, outre le bilinguisme ou la persistance relativement forte de l’espagnol (p. 85), elle distingue l’alternance de deux langues [code‑switching] comme outil inventif de déformation de la langue majoritaire et de réversion des rapports de pouvoir (p. 78). Elle note également que les alternances entre l’espagnol et l’anglais dans la langue des Chicanos accentuent leur effet de foregrounding, c’est‑à‑dire une stratégie linguistique qui attire l’attention sur leurs pratiques linguistiques (p. 102). Ainsi, Savin considère l’alternance dans la littérature chicano comme « le contrepoint linguistique des forces sociales antagonistes qui accompagnent le processus d’intégration aux États‑Unis » (ibid.). Un tel conflit dans l’alternance de langues s’approche donc du concept de la poésie chicano dite « interlingue » de Juan Bruce‑Nova, qu’il différencie de la poésie « bilingue », et qui regroupe deux ou plusieurs langues dans le même texte. Ces langues sont donc positionnées dans un « état de tension » qui produit une troisième possibilité de langue, « l’interlangue ». Il ajoute que tandis que le bilinguisme suppose des mouvements d’une langue à l’autre, l’interlinguisme implique la tension des deux en même temps5.
Pour apprécier cet espace linguistique intermédiaire de l’interlangue, il suffit d’observer des passages de Caramelo tels que celui du coucher de la protagoniste enfant lors d’un voyage à Mexico qui déclenche une discussion comique sur les croisements entre l’anglais et l’espagnol :
Father makes the same joke he always makes at bedtime.
— ¿Qué tienes? ¿Sueño o sleepy?
— Es que tengo sleepy. I have sleepy, Father.
—And who loves you, my heaven?
—You do.
—That’s right, my life. Your father loves you. Never forget it […] Ahora, time to mimi. Que duermas con los angelitos panzones, sleep with the fat little angels, my heart, he adds before putting out the light. (Cisneros, 2002, pp. 52‑53)
– ¿Qué tienes? [qu’est-ce que tu as] ¿Sueño [sommeil] o fatiguée [sleepy] ?
– Es que tengo [c’est que j’ai] fatiguée. J’ai fatiguée, Papa.
– Et qui t’aime, mon ciel [my heaven] ?
– Toi.
– C’est exact, ma vie [my life]. Ton père t’aime. Ne l’oublie jamais […] Ahora, il est temps de mimi [dodo]. Que duermas con los angelitos panzones, dors avec les petits anges dodus, mon cœur [my heart], ajoute-t-il avant d’éteindre. (Cisneros, 2004, p. 64, traduction de Lambrechts, mes crochets.)
Il est important de noter que malgré l’alternance de langues, la lecture de ce passage n’est pas déstabilisée à cause de la présence dominante de l’anglais qui, en plus de ne pas figurer en italique, nous fournit un contexte pour comprendre les incursions hispaniques comme dans les phrases “Es que tengo sleepy. I have sleepy, Father” où un lecteur monolingue anglophone pourrait toujours comprendre la majorité de la conversation. Cette intercompréhension est attestée par l’écrivaine elle‑même lors d’un entretien sur son langage en 1996, où elle affirme que dans son écriture elle veut que son lecteur monolingue anglophone puisse comprendre ou capturer l’essence de son langage même s’il ne maîtrise pas l’espagnol, en démontrant ainsi une dimension pédagogique de ses textes qui veulent montrer à ses lecteurs des façons de parler d’autres cultures6 (Díaz‑Pérez, p. 328).
Certes, l’entreprise linguistique de Cisneros va au‑delà de l’alternance entre langues ; une lecture du même passage de Caramelo révèle également une langue espiègle qui exprime des expressions idiomatiques hispaniques dans la langue anglaise. En effet, les expressions I have sleepy comme my heaven, my life ou my heart, quoique compréhensibles en anglais possèdent un caractère inhabituel, hors de l’anglais standard. Le lecteur bilingue en espagnol, pourtant, y reconnaîtra les expressions hispaniques tengo sueño, mi cielo, mi vida et mi corazón tout en démontrant un aspect de traduction dans le texte même qui correspond aux intérêts pédagogiques de l’écrivaine. Cette technique que Cisneros partage avec d’autres écrivains latinos des États‑Unis est typiquement décrite en tant que « calque », terme qui désigne une traduction de morphèmes ou d’une phrase dans une langue à son équivalent dans une autre langue (Díaz‑Pérez, p. 339). Néanmoins, comme l’indique Frances Aparicio, en sociolinguistique, ce terme signale des pratiques linguistiques de locuteurs dits sans instruction, ceux qui subordonneraient l’espagnol à l’anglais et illustreraient ainsi la perte de leur langue maternelle (p. 799). Aparicio souligne donc qu’utiliser telle appellation pour décrire l’écriture d’écrivains états‑uniens dont la langue maternelle est l’anglais – comme c’est le cas de Sandra Cisneros7 – réduit l’originalité de cette stratégie littéraire subversive en l’attribuant à un simple geste involontaire mimétique (ibid.). C’est dans cette perspective que Bill Johnson González analyse le langage de Caramelo et considère la transposition de l’espagnol dans l’anglais comme une stratégie interlingue qui, en défamiliarisant l’anglais du texte, renouvelle et étend ses capacités expressives (p. 5). Or, il explique que si des expressions comme my heart semblent être une traduction, elles ne sont pas de « bonnes traductions » car elles auraient cherché un substitut commun dans la langue anglaise (par exemple, darling), et c’est précisément dans cette rupture avec la langue anglaise que l’écrivaine crée une langue Autre en traduction : « Dans ces exemples… ce n’est pas tellement que Cisneros traduit des phrases idiomatiques mexicaines populaires à l’anglais, mais qu’elle réussit à traduire l’anglais dans le parler populaire mexicain8. » Le critique indique ainsi que l’anglais de Caramelo est un anglais « retourné contre soi‑même », un nouvel anglais, temporaire, en train de se faire dans la lecture, qui a été re-désigné pour faire de cette langue un chez soi plus accueillant pour la culture chicano (ibid.).
L’ingénieuse construction de cette langue en traduction suscite une question fondamentale pour notre étude : comment traduire cette « interlangue » de Cisneros dans une autre langue ? Francisco Javier Díaz‑Pérez aborde cette problématique dans un article qui analyse les traductions des premiers textes de l’écrivaine en espagnol mexicain, en galicien et en catalan. Il distingue notamment le positionnement « frontalier » qui entremêle la culture américaine et mexicaine comme l’une des caractéristiques essentielles du langage de Cisneros et affirme que toute traduction impliquerait nécessairement la recréation d’un texte « à la frontière » ; un concept qui se détache de tout type d’essentialisme et qui trouve dans l’hybridation l’une de ses caractéristiques principales9. Parmi les stratégies des traductions en galicien et en catalan, trois demeurent pertinentes pour notre étude. En premier lieu, Diaz‑Pérez note que plusieurs traducteurs substituent l’anglais du texte original par la langue cible, en créant une nouvelle alternance codique où la langue du traducteur devient la langue dominante tandis que l’espagnol original demeure intact et en italique (p. 332). Une seconde stratégie est celle de la compensation qui consiste à ajouter de nouveaux mots en espagnol non‑présents dans le texte original pour équilibrer les manques où l’alternance n’a pas pu s’effectuer. Par exemple, dans la traduction catalane, la traductrice emploie le terme espagnol espaldamojada (dos mouillé) – terme péjoratif pour les émigrés mexicains clandestins – en italiques même si dans la version originale ce terme apparaît en anglais (p. 334). La troisième stratégie consiste à incorporer les trois langues dans la traduction pour mettre en scène de façon plus explicite la réalité bilingue des personnages comme dans la traduction galicienne de María Pilar Godayol : You’re nuts, Chayo, ven a saludar. Tota la familia és aquí (p. 57) (Cité dans Díaz‑Pérez, p. 338).
Il est cependant important de prendre en considération les différentes implications entre des traductions de l’anglais de Cisneros dans des langues ibériques et en français. D’abord, le lecteur catalan et galicien, vivant dans un contexte souvent bilingue avec l’espagnol, est capable de le comprendre, en faisant ainsi une expérience de traduction et de lecture moins opaque (Díaz‑Pérez, p. 337). Ce lectorat de langues ibériques minoritaires possède en outre une position frontalière avec l’espagnol similaire à celle de l’espagnol avec l’anglais pour les Chicanos (ibid., p. 330‑331). En revanche, le français, quoique langue romane, possède un niveau plus bas d’intelligibilité avec l’espagnol, et, en tant que langue officielle de la France, se situe loin du contexte de langue minoritaire.
La traduction française de Caramelo : un retour au Mexique ?
L’étude de la traduction de la littérature chicano en français est un champ très peu développé. L’article « Réflexions autour de la traduction du récit “ethnique” : Gary Soto en “Castor Poche” » de Crystel Pinçonnat est à cet égard fondamental pour comprendre ses enjeux pratiques10. Dans cet article, elle analyse trois traductions en français des récits de Gary Soto publiées dans les années 1990. Son analyse se concentre sur des caractéristiques qu’elle considère comme problématiques pour la traduction du texte avec une langue riche en mélanges culturels. Parmi ces stratégies de traduction se trouve la suppression systématique des mots en espagnol qui effacent des traits subversifs importants du texte original (p. 6) ; l’inclusion de diverses notes de bas de page avec des explications pour des termes culturels difficiles à traduire (ibid.) ; la substitution de termes espagnols comme viejo et viejita pour les néologismes Papito et Mamita plus proches du français (ibid.) ; et la suppression de l’italique original après avoir expliqué qu’il aplatit la langue originale (p. 9). Pinçonnat conclut son analyse en suggérant que ces stratégies révèlent une suppression des traits ethniques originaux qu’elle assimile à des « reliques » culturelles (p. 9‑10) :
[…] faut‑il chérir le texte, le manipuler avec précaution, surtout lorsque surgissent les restes délicats que sont les reliques. Reliques gestuelles, vestimentaires ou simplement verbales, elles sont toutes les traces d’un passé fragile, fragilité qui habite d’ailleurs aussi les personnages, un passé qui mérite – si on le veut efficient – d’être traité comme un objet précieux, surtout en traduction. Les reliques – même un simple mot espagnol, une expression mexicaine – construisent un patrimoine qui s’enrichit au fur et à mesure de la lecture, un héritage commun aux personnages et aux lecteurs. En ce sens, le traducteur de ces textes est aussi conservateur, il doit assurer la circulation de ces petits fragments d’être, visée qui exige au préalable un travail de restauration. (Pinçonnat, 2010, p. 17)
Cette stratégie de traduction postule donc que le traducteur d’un roman comme Caramelo devrait jouer un rôle de restaurateur puisqu’il est devant un récit contenant une langue, des intrigues et des symboles fragiles.
Publiée en 2004 chez Plon, la traduction française de Caramelo par Rémy Lambrechts se situe dans un cadre vaste de restauration, mais il n’échappe pas à des écarts avec le texte original. L’un de ces écarts se trouve dès la couverture du texte qui possèdent une ambiguïté quant à la complexité culturelle de la littérature chicano. D’une part, la quatrième de couverture note que l’écrivaine est états‑unienne, qu’elle écrit en anglais et que son texte s’ancre sur la culture mexico‑américaine et l’immigration. D’autre part, la première de couverture présente la peinture Mi Rebozo de Jesús Helguera (1910‑1971), peintre mexicain devenu célèbre au début du xxe siècle pour son art sur des boîtes de cigares et des calendriers avec des représentations folkloriques et exotiques de la mexicanité (McCracken, p. 105). Sa peinture s’inscrit dans l’esthétique des travaux du peintre indien Raja Ravi Varma (1848‑1906) qui, à la fin du xixe siècle, créa l’imagerie stéréotype de la culture indienne dans des calendriers chromolithographiés qui mélangent l’esthétique de l’art pompier européen et des symboles de la culture hindouiste classique. En effet, Mi Rebozo dépeint une jeune femme brune, maquillée, portant des tresses de style amérindien attachées par des rubans, et une fleur rouge coincée dans l’oreille gauche. Ses bras levés, dénudés, tiennent un grand châle mexicain, le rebozo, avec lequel elle s’apprête à se couvrir la tête. Sa jupe et son chemisier à volants de style andalou mettent en valeur son corps et sa sensualité en perpétuant les stéréotypes de la féminité mexicaine pour un regard européen. À l’arrière‑plan on retrouve des feuilles d’agave ainsi qu’une poterie aux motifs précolombiens qui accentuent la mexicanité de la scène. En analysant cette même image qui illustre aussi la version britannique du texte, Ellen McCracken remarque pertinemment que nulle part dans le texte n’apparaît un personnage avec de telles caractéristiques et considère son utilisation comme une stratégie de commercialisation du livre et de l’écrivaine comme une commodité ethnique (ibid.). La finalité de cette couverture qui reflète des stéréotypes mexicains, est bien une tactique publicitaire qui rend encore plus « mexicain » le texte de Cisneros. L’écrivaine performe elle‑même publiquement cette représentation ethnique, ce qui accentue encore plus sa mexicanité dans une perspective commerciale (McCracken, p. 13). Sur sa photographie reproduite en quatrième de couverture, Sandra Cisneros porte un chapeau de style tex-mex et une tunique bariolée dont les motifs mimant un textile mésoaméricain. Mais si ce paratexte joue avec la stratégie des maisons d’édition, où pouvons‑nous tracer la ligne entre ce qui est acceptable d’exploiter comme « mexicain » et ce qui ne l’est pas et par qui ?
Un exemple de cette problématique pourrait être la suppression du sous‑titre original or puro cuento, phrase en alternance de langues qui incorpore une conjonction anglaise or et le terme polysémique espagnol qui peut signifier « juste une histoire » (littéralement), « que des mensonges » et également « à ne pas prendre aux sérieux11 ». Ce terme qui est d’ailleurs humoristique dans le roman peut donc servir comme un outil pour l’associer à la fiction en le séparant du récit non‑fictif, comme l’explique l’écrivaine même dans l’avertissement du livre :
La vérité : ces histoires ce sont que des histoires, des bouts de ficelle, de bricoles ramassés çà et là, mises bout à bout et enjolivées pour en faire quelque chose de neuf. J’ai inventé ce que je ne savais pas et exagéré ce que je savais pour perpétuer la tradition familiale des mensonges salutaires. Si au fil de mon invention, j’ai par inadvertance trébuché sur la vérité, perdónenme.
Écrire c’est poser des questions. Peu importe si les réponses sont vraies ou puro cuento. Après tout le reste, seule demeure l’histoire, et la vérité passe comme l’encre bleu pâle d’un mauvais patron de broderie… (p. 13)
La suppression du sous‑titre fondé sur l’alternance des langues élimine donc la subtilité drôle des mensonges salutaires du texte original et laisse seulement un titre en espagnol privé de cette présence d’une autre langue ; du « ou » (or) qui rappelle au lecteur que l’histoire se situe précisément dans un entre‑deux et non dans une réalité monolingue en espagnol. Il s’agit donc ici d’un cas de mutation du texte original qui favorise, comme le fait la couverture, sa présentation comme un texte moins hétérogène voire plus mexicain.
Dans la traduction de Lambrechts on retrouve également diverses stratégies qui visent non seulement à restaurer les mots espagnols du texte original, mais aussi à insérer de nouveaux hispanismes, comme le montre un extrait où le père essaie de rassurer la protagoniste qui pleure quand un coiffeur lui coupe ses nattes : « On les fera tisser en postiche pour quand tu seras grande, dit Papa quand nous sommes dans la voiture. Ça te plairait, n’est‑ce pas, ma reine ?… D’accord mi cielo ? Ne pleure pas, ma jolie12 » (p. 37). L’ajout du mot espagnol mi cielo pour traduire le mot anglais my heaven, que nous avons déjà qualifié comme un gage de drôlerie, peut paraître insignifiant, mais en contexte, la phrase semble contredire l’intrigue du roman. En effet, l’extrait se passe lors des vacances familiales de la protagoniste chicana au Mexique où sa grand‑mère l’oblige à aller chez le coiffeur. Celaya ajoute que c’est peut‑être parce qu’elle ne comprend pas bien l’espagnol qu’elle se fait couper les nattes contre sa volonté, et que conséquemment son père la console dans son anglais à lui, caractérisé par des emprunts comiques d’expressions mexicaines (p. 36). Aussi il est important de noter que le texte original explique l’origine du terme my heaven qu’une vingtaine de pages après son usage, dans le passage où la fille, après avoir vu tomber le faux plafond (cielo raso en espagnol) d’une salle de la maison de sa grand-mère à Mexico, comprend l’origine de ce terme affectif : « C’est alors que j’apprends les mots pour ce que je veux dire. “Plafond” et “cielo”. Cielo – le mot que Papa utilise quand il m’appelle “mon ciel”. Le même mot que le Petit Grand‑Père cherche quand il veut dire la même chose. Sauf qu’il le dit en anglais “Mon Sky”13 » (p. 73). Ici, la traduction réussit à intégrer les deux langues et les deux cultures de l’apprentissage de cette fillette chicano, mais cette stratégie trilingue est rare vu que le traducteur substitue l’anglais au français comme langue dominante. En tant que texte en français, la version de Lambrechts respecte l’intérêt pédagogique de l’auteure sur des mots en espagnol, une pratique qui selon le cadre théorique de Pinçonnat est judicieuse. Pourtant, plusieurs phrases écrites dans un anglais qui renvoie à des phrases en espagnol mexicain – un trait si distinctif de l’écriture de Cisneros – suivent d’autres approches de traduction révélant des problématiques importantes de la traduction française.
Dans la version de Lambrechts, l’anglais intentionnellement mexicanisé suit au moins trois types de traduction. Une première consiste à traduire littéralement ce langage comme dans le cas des noms anglais Uncle Fat‑Face et Aunty Light‑Skin (traduits par « Oncle Grosse‑Tête » et « Tantine Peau‑Claire ») qui expriment à la base les termes mexicains chato (personne ayant un nez plat, typiquement associé aux amérindiens) et güera (une personne aux traits Européens). Compte tenue de leur complexité linguistique, d’autres expressions en anglais non‑standard s’avèrent intraduisibles en français. Par exemple, les latinismes It’s that she has shame (p. 73), my queen (p. 24), ou how exaggerated (p. 38) sont simplement traduits littéralement par « c’est qu’elle a honte » (p. 85) « ma reine » (p. 37) ou « quelle exagération ! » (p. 51), phrases qui perdent leur excentricité originale vu la proximité de la langue française de la racine latine des phrases. Une troisième approche, qui est la plus employée dans cette traduction, consiste à « neutraliser » les termes en anglais hybride par des phrases en français standard. Un exemple de cette stratégie se trouve dans un passage où le texte original présente une dispute entre l’oncle et tante de la protagoniste avec un langage hispanisé et hyperbolique propre d’une telenovela mexicaine :
— My own husband! What a barbarity! A prostitute’s disease from my own husband. Imagine ! Ay, get him out of here! I don’t ever want to see you again. ¡Lárgate! You disgust me, me das asco, you cochino! (…) I’m going to kill myself! Kill myself!!! Which sounds much more dramatic in Spanish — ¡Me mato! (p. 11)
— Mon propre mari ! Quelle atrocité ! Une maladie de prostituée attrapée de mon propre mari. Imagine ! Ay, sortez-le d’ici ! Je ne veux plus jamais te voir. ¡Lárgate ! Tu me dégoûtes, espèce de cochino ! (…) Je vais me tuer ! Me tuer14 !! (p. 25)
Conformément à nos observations précédentes, la version française conserve tous les mots espagnols. Néanmoins, la phrase what a barbarity! issue de ¡qué barbaridad!, baroque à l’oreille anglaise, se traduit par la phrase standard « Quelle atrocité ! » (p. 25). Le même sort a la phrase And what am I, painted? (p. 55), dérivée de l’expression hispanique ¿Y yo qué, estoy pintado? littéralement « et moi quoi, je suis peint (comme peint sur un mur) », qui est traduite avec un langage plus formel : « Et moi je suis quoi, une image ? » (p. 67) en effaçant ainsi la métaphore de la peinture du texte en anglais. À notre avis, ces exemples auraient pu être traduits par les expressions plus dramatiques « quelle barbarité ! » et « et moi, je suis peint ou quoi ? » pour imiter et rétablir la langue interaméricaine de Cisneros. Ce refus de chicaniser le texte français atteste donc d’un détachement de la traduction à dépeindre des effets linguistiques en anglais de plus d’un siècle d’échanges entre la culture états‑unienne et mexicaine.
La substitution des termes hybrides en anglais par le français standard peut aussi provoquer des changements dans l’intrigue. À cet égard, le passage intitulé Spic Spanish? qui offre une critique de la langue anglaise et de la culture blanche anglophone, représente un défi pour la traduction française qui ne parvient pas à repérer plusieurs symboles culturels du texte original. En premier lieu, le titre que la traduction repère du texte original est une transcription phonétique d’un anglais utilisé par des Hispaniques non‑anglophones. Il faut mentionner aussi que le mot spic pour un Hispanique ayant vécu au xxe siècle renvoie au terme péjoratif employé par la majorité blanche pour s’adresser, insulter et exclure les Hispaniques des établissements privés. Le passage expose alors un monologue de la narratrice qui raconte l’expérience du père de Celaya quand il était en train d’apprendre l’anglais en utilisant le programme d’études par courrier Inglés sin Stress, clin d’œil à au programme d’études Inglés sin barreras largement promu à la télévision des États‑Unis de langue espagnole dont les publicités kitschs des années 1980 et 1990 sont aujourd’hui cultes dans cette communauté. La narratrice débute son monologue en évoquant un vieux proverbe espagnol qui compare l’anglais et l’espagnol : « Le vieux proverbe était vrai. L’espagnol était fait pour s’adresser à Dieu et l’anglais pour parler aux chiens » (p. 217). Venant d’une communauté minoritaire qui est insultée par l’emploi d’un mot dérivé de sa prononciation hispanique de l’anglais, ce dicton ethnocentré s’inscrit à dessein pour renverser les rapports du pouvoir. Le texte original se poursuit en montrant des transcriptions phonétiques d’un anglais accentué que le traducteur respecte en faisant des légers changements pour le lecteur français comme Goud mórning, ser ou Jháou dou ioú dou ? (ibid.). Mais la traduction se complique au moment de retranscrire le commentaire de la narratrice sur les phrases de politesse que son père apprenait telles que Sir, kindly direct me to the water closet ; des phrases en anglais poli que les Texans anglophones à qui le père s’adressait trouvaient néanmoins bizarres (p. 208) :
Comme l’anglais était une langue bizarre. Brutale et directe. Personne n’entamait une requête par un « Auriez-vous l’amabilité de me faire faveur de… » comme on le devrait. Ils demandaient simplement ! […]
C’était une langue barbare ! Sèche comme les ordres d’un dresseur de chiens. « Monsieur. » « Parlez plus fort. » Et pourquoi personne ne disait‑il : « Je vous en prie ? » Au lieu de quoi, ils grognaient « On‑hon », sans le regarder dans les yeux, et sans même un « Vous êtes très aimable, monsieur, et que tout aille bien pour vous ». (p. 217‑218)
Les diverses adaptations faites par le traducteur montrent encore une fois une omission des nuances de la langue anglaise de l’écrivaine. D’abord, les phrases en anglais formel water closet, sir et mister traduits en français par « les toilettes » et « monsieur » soustraient le caractère désuet des phrases anglaises dans un contexte populaire. De plus, la métaphore du dresseur de chiens qui, dans la version originale, inclut le mot Sit (assieds‑toi) est ici adaptée par le terme « Monsieur » et éloigne la phrase du sens qu’elle a en anglais. De cette tirade poétique sur la langue anglaise et la culture états‑unienne, les seuls mots en anglais conservés sont des transcriptions phonétiques en anglais avec une prononciation mexicaine, action qui efface l’effort de l’écrivaine pour critiquer cette langue qu’elle renouvelle en la retournant contre elle‑même.
Dans les extraits comiques et pédagogiques qui visent à apprendre au lecteur la réalité linguistique des Chicanos, les processus d’adaptation dans un français neutre masquent là aussi des phrases écrites à l’origine dans un anglais subversif ou espiègle. Par exemple, lors d’une critique de l’espagnol pocho (un type d’espagnol anglicisé utilisé par certains Chicanos) des cousines de Celaya : “— ¿Y la Amor ? — Amor se fue a la… library” (p. 290), le mot library est le noyau de la langue que la narratrice qualifie comme « leur horrible espagnol pocho émaillé de mots en anglais » (p. 301). Mais le traducteur opte pour le traduire avec le mot français « la bibliothèque » en perdant ainsi complètement l’alternance des langues. Cette stratégie est aussi employée dans la blague linguistique décalée de l’Oncle Ernesto qui demande, dans le texte original, comment utiliser les mots liver (foie) et cheese (fromage) dans une même phrase, et y répond en imitant l’accent hispanique Liver alone, cheese mine (laisse‑la tranquille, elle est à moi) (p. 369)15. Devant tel cas intraduisible, le traducteur évite complètement l’anglais et change le jeu de mots pour « matelas » et « balais » : « Matelas si tu veux, mais balais pattes » (p. 377), blague également ridicule, remplaçant l’humour du texte original
Les diverses stratégies employées dans la traduction française du roman de Sandra Cisneros exposent plusieurs défis dans la traduction de la littérature chicano. Tandis que certaines approches ont des bases linguistiques, d’autres telles que l’amplification de la composante mexicaine de l’identité chicano peuvent modifier les intentions du texte original. Certes, la restauration soigneuse des mots en espagnol par Lambrechts, stratégie souvent manquante des traductions des textes chicanos des années 1990, réussit à honorer les signes de la culture mexicaine célébrés par plusieurs personnages dans Caramelo. Mais l’imaginaire de ce roman chicano est plus proche d’une réflexion de la narratrice sur ses racines mexicaines, chicanos, anglophones, espagnoles, racines qui construisent son quotidien aux États‑Unis à la fin du xxe siècle. Ellen McCracken précise ainsi, dans une étude quantitative sur la chronologie complétant le roman, que la majeure partie de la chronologie se concentre sur une révision de l’histoire états‑unienne, et révèle ainsi l’importance que donne l’auteur à ce pays et cette culture dans son roman (p. 109)16. Et c’est pour cette raison que nous analysons le manque des traces de métissages linguistiques en anglais dans la traduction française comme une perte importante qui empêche le lecteur français de saisir la complexité du texte original. Nous pouvons donc proposer, à partir du cas de Caramelo de Sandra Cisneros, de nouvelles observations sur les traductions de la littérature chicano en France : la langue espagnole et la culture mexicaine dominent au détriment de l’anglais, et ces aspects, par extension, mexicanisent aussi l’image du Chicano. Stratégie publicitaire ou symptôme d’une société française qui considère les enfants d’immigrés comme des étrangers17 ?
Conclusion
À travers cette étude de la traduction française de Caramelo nous espérons avoir montré que traduire ce roman riche en nuances culturelles et en va‑et‑vient entre les États‑Unis et le Mexique consiste à naviguer dans des réflexions sur la langue, l’appartenance culturelle et l’État‑nation mais aussi sur la commercialisation de la littérature. Dans ce voyage, le traducteur devient l’instrument qui peut rendre visible ou effacer les traces des rencontres culturelles qui enrichissent l’écriture chicano. Mais c’est autant les « reliques » de la culture mexicaine qui rendent service à la représentation de la diaspora mexicaine aux États‑Unis que leur culture états‑unienne et leur langue anglaise, ainsi que leur métissage.
Le traducteur de cette voix Autre issue des États‑Unis fait donc face à une image subversive de ce pays qui va au‑delà de tout réductionnisme identitaire. En effet, pourquoi instaurer par la traduction une image plus mexicaine de Caramelo, quand le texte original repousse lui‑même l’illusion d’une identité pure ? La protagoniste nous invite, au contraire, à concevoir une véritable culture métisse, faite des connexions transnationales, en rendant le lecteur sensible à la réalité des sujets chicanos : « Pendant très longtemps j’ai cru que l’aigle et le serpent du drapeau mexicain étaient les États‑Unis et le Mexique qui se battaient. Puis, pendant plus longtemps encore par la suite, j’ai pensé à l’aigle et au serpent comme à l’histoire de Maman et Papa » (p. 245).