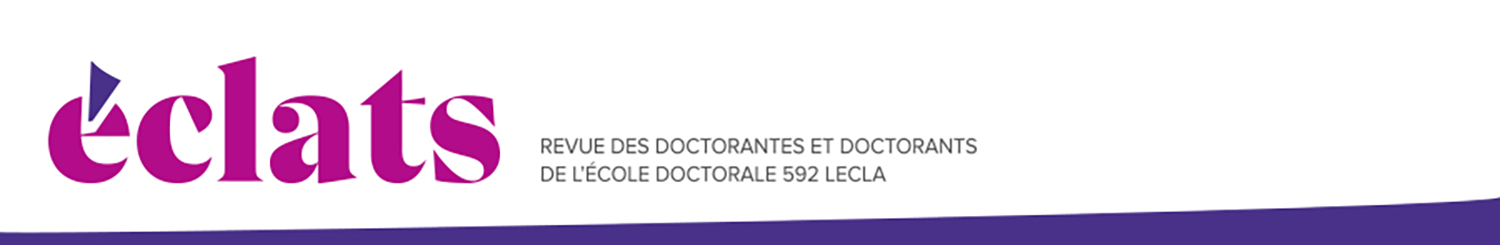Introduction. Le musée au prisme de la culture sensorielle
Depuis une dizaine d’années, certains musées se tournent vers une autre expérience muséale : ils se veulent des lieux de ralentissement, de contemplation, surtout de bien-être – une tendance développée particulièrement par les services des publics, qui croient en une institution linéaire, portée avec les visiteurs (SIMON, 2010). Émergent alors des pratiques de contemplation face aux œuvres, des expériences plurisensorielles et méditatives faisant appel à la pleine conscience et à l’hypnose, ainsi que la mise en place de protocoles de visite, comme la « cérémonie du regard » (ANTOINE-ANDERSEN, 2021, p. 21).
Ce phénomène s’inscrit plus largement dans le tournant de la culture sensible, observé par David Howes et Jean-Sébastien Marcoux (2006). Il s’aligne sur les études holistiques de l’expérience, d’une « médiation corporelle » (VERHAEGEN, 2008, p. 82). Dans cette perspective, les professionnels de l’architecture muséale et de la scénographie d’exposition considèrent, dès lors, l’espace muséal comme une forme possible de médiation spatiale (GRZECH, 2004), voire de médiation sensible (RISPAL, 2009). Ces questions sont tournées vers une culture du care (ROBERTSON, 2015 ; RISPAL, 2020 ; FALK, 2021) – lorsque le musée veut prendre soin –, ainsi que vers une compréhension du musée par le prisme de l’expérience muséale. Toutes ces tendances interrogent plus largement de nouvelles formes de muséologie. Nous pouvons par exemple évoquer les questionnements sur une possible muséologie des émotions (WITCOMB, 2015 ; VARUTTI, 2020), sur une muséologie de la réception (MAIRESSE, 2014), ou encore sur une muséologie du sensible (LEBAT, 2022). La maîtrise de la culture sensorielle serait-elle donc la clé pour une expérience muséale réussie ?
Si les éléments qui composent l’expérience muséale semblent aujourd’hui largement cernés, il subsiste pourtant une dimension sensorielle oubliée, largement absorbée par les questions de scénographie, ou encore par les enjeux techniques. Il s’agit de l’éclairage et de son potentiel médiatique (GOBBATO, 2023). Dans ce tournant muséal voué à la culture sensible, quelle est la part des éléments implicites, comme l’éclairage ? Depuis quelques années, nous nous intéressons à cette question et aux apports de l’éclairage dans la construction de sens (GOBBATO et al., 2020 ; GOBBATO, THEBAULT, SCHMITT, 2021 ; GOBBATO, 2022). Jusqu’à présent, nous avons adopté une affiliation épistémologique attachée à l’approche énactive (VARELA, THOMPSON, ROCH, 1991). Désormais, il nous paraît pertinent d’engager une réflexion plus vaste en direction des théories de l’embodiment (corporéité), encore peu développées en muséologie – et ce, spécifiquement à partir de l’environnement lumineux.
Sans avoir une vocation exhaustive, cet article tentera d’apporter des réflexions sur les liens entre la corporéité et l’environnement muséal par le prisme de l’éclairage et de ses fonctions. Il s’inscrit dans les disciplines de l’esthétique et des sciences de l’information et de la communication, qui nourrissent le champ de recherche de la muséologie.
Le soi et le monde : corporéité et cognition
Parmi les théories de l’embodiment, l’approche énactive révolutionne la compréhension de la construction de sens depuis le début des années 1990, dépassant le cognitivisme. Elle se focalise sur le lien biologique entre l’individu et son environnement, et remet en question diverses disciplines, dont la psychologie, la psychologie sociale et la linguistique. Cette approche, formulée par les neurobiologistes, considère la construction de sens comme incarnée dans l’organisme et située dans un environnement, intégrant les contextes biologiques, psychologiques, et culturels (VARELA, THOMPSON, ROCH, 1991 ; THOMSON, VARELA, 1991 ; VARELA, MATURANA 1994).
Pour cela, elle se fonde sur deux aspects « (i) la perception consiste en une action guidée perceptuellement et (ii) les structures cognitives émergent des schémas sensorimoteurs récurrents qui permettent à l’action d’être guidée perceptuellement1 » (VARELA et al., 1991, p. 173). L’approche énactive définit le système des êtres vivants comme étant autonome, générant des informations par les interactions continues entre le système nerveux et l’environnement. Ainsi, il n’y a pas de séparation entre l’individu et l’environnement extérieur. Le traitement de l’information est autonome, interprété selon le contexte. De plus, l’énaction considère la cognition comme une approche incarnée de l’action, émergeant de la relation de perception de l’environnement, soumise à la condition mentale de l’individu. Par conséquent, elle place l’expérience comme une activité centrale pour l’individu, ouvrant une perspective sur la corporéité au-delà de la traduction intellectuelle de la relation entre l’organisme et l’environnement. Dans cette perspective, Di Paolo et Thompson (2014) insistent sur l’importance du corps, définissant l’énaction comme un système auto-individuant et la cognition comme la création de sens par la régulation adaptative des états et des interactions. La création de sens implique donc l’incarnation de l’environnement par le corps, qui est subjectivement vécu : cela englobe les émotions, simultanément corporelles et cognitives, contribuant au processus de construction de sens incarné et situé (COLOMBETTI, THOMPSON 2007 ; 2008).
Ces réflexions donnent lieu à l’élaboration de théories perceptuelles de la connaissance en sciences cognitives et en neurosciences. Nous nous intéressons particulièrement aux travaux de Barsalou (1999), qui propose le modèle conceptuel de base des Systèmes de Symboles Perceptuels (PSS). Selon ce modèle, lors de l’expérience perceptuelle (sensorielle, motrice, ou introspective), les aires d’association du cerveau enregistrent des motifs d’activation ascendante dans les aires sensorimotrices. Ces mêmes aires d’association réactivent les aires sensorimotrices pour mettre en œuvre des symboles perceptuels. Pour Barsalou, ce ne sont donc pas les expériences perceptuelles holistiques qui sont stockées ou réactivées, mais les symboles perceptuels, entendus comme des composants perceptuels extraits de l’expérience. Les souvenirs du composant peuvent alors être réorganisés autour d’une nouvelle trame, mettant en œuvre un simulateur, qui produit des simulations illimitées du composant. Ils peuvent ainsi modifier la productivité de l’individu, ses propositions et ses concepts abstraits. Pour Barsalou, les symboles perceptuels sont alors schématiques et peuvent se combiner de manière créative pour simuler des entités imaginaires. De ce fait, ils impliquent la perception, la catégorisation, les concepts, l’attention, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, le processus du langage, les compétences de résolution de problèmes, de prise de décisions, de raisonnement, et même la créativité.
L’influence des neurosciences s’étend rapidement aux autres disciplines qui s’intéressent à la construction de sens, à l’individu et aux interactions avec son environnement. Par exemple, en psychologie sociale, la compréhension des symboles internes en tant que représentations mentales soulève des questions sur la définition de ces représentations et sur la manière dont elles acquièrent un sens pour l’individu (NIEDENTHAL ET AL., 2005), ainsi que dans la compréhension des processus régissant les interactions sociales et leurs représentations collectives (DE JAEGHER, DI PAOLO, 2007). Les théories de la corporéité remettent également en question la linguistique cognitive. « La parole est vécue par le parleur comme un engagement corporel improvisé et régulé, exactement comme une pratique sportive disciplinée telle que la gymnastique ou le tango » selon Bottineau (2011, p. 202) : elle agit ainsi comme un sous-système qui affine la perception, où la corporéité est présentée comme l’interface moteur-sensorielle qui connecte la relation établie par la parole.
L’anthropologie et l’architecture s’ouvrent également à ces réflexions, probablement influencées par le virage sensoriel des études contemporaines sur la culture matérielle dans les années 1990 (HOWES, MARCOUX, 2006). La question de l’incarnation des représentations spatiales est examinée (DUTRIAUX, GYSELINCK, 2016), mettant en évidence que la perception, la mémoire et le langage sont incarnés. La compréhension esthétique des objets, et donc de l’art, est autant repensée à partir du fonctionnement neuronal, de l’engagement humain avec le mouvement et l’incarnation, ainsi que de la reconnaissance des émotions qui peuvent en découler (FREEDBERG, 2009). En sciences de l’information et de la communication, le sensible est considéré dans un système d’esthésie-esthétique-éthique étudié sous la forme de l’expérience incarnée (BOUTAUD, 2016). Le premier concerne l’identification d’une manifestation sensorielle dominante parmi d’autres, le deuxième comporte l’interprétation des sensations immatérielles et des valeurs abstraites en motifs et en figures, et le troisième porte sur l’interprétation par l’image et l’identité.
En muséologie, le champ de recherche s’ouvre également à l’embodiment. D’abord, il s’agit de prendre conscience de l’espace du corps des visiteurs dans les musées. Helen Rees Leahy (2012) place, par exemple, le corps au centre de l’expérience muséale depuis le xviiie siècle. Elle considère notamment que ce corps suit des normes culturelles de consommation muséale – et surtout des pratiques normatives spectatorielles établies par les responsables des musées. On se souviendra notamment du concept de fatigue muséale (GILMAN 1916). Les théories de l’embodiment révèlent ensuite progressivement une nouvelle étendue du possible. Puisque c’est la cognition incarnée et située qui caractérise la relation entre l’organisme et son environnement, alors cet environnement ne déterminera pas seul l’expérience. Selon Harris (2015), l’approche incarnée de l’expérience assume désormais que les visiteurs mettent en scène leurs récits. De ce fait, au musée, l’énaction ouvre la compréhension « à travers la dynamique cognitive et émotionnelle du couplage du visiteur avec le monde tel qu’il le perçoit et fait sens pour lui » (Schmitt, 2018, p. 103).
Réévaluer l’environnement spatial et lumineux
Ces apports théoriques ouvrent un champ intéressant pour l’étude des relations entre l’individu et l’environnement muséographique par le prisme de l’énaction, tant pour l’épistémologie que pour la méthodologie. Le sujet de la lumière nous paraît ainsi particulièrement propice à ces réflexions. En effet, rappelons que le design de l’espace (espace, forme, volume et couleur) est déjà identifié pour son influence sur l’apprentissage des visiteurs, notamment par les émotions et la construction cognitive (FALK, DIERKING, 2000, p. 123 ; FALK, 2009, p. 157).
D’abord étudié dans l’environnement de l’architecture, l’éclairage se compose d’éléments visuels qui sculptent l’espace. Nous faisons notamment référence à la hiérarchie visuelle spatiale initialement définie par Richard Kelly (1952), puis par William MC Lam (1977 ; 1982 ; 1986). Les concepteurs lumière ne cessent, eux aussi, de répéter que l’éclairage peut favoriser l’interprétation des œuvres (Narboni, 2005). Pour Janet Turner (1994), par exemple, la lumière permet de guider tout au long du parcours et de créer un intérêt visuel. Lorenzo Cremonini (2000) propose, quant à lui, de combiner les couleurs et les ombres pour alimenter l’imagination du public. Alessandra Criconia (2011) considère que travailler les points lumineux revient à créer une interaction avec les visiteurs. Un autre moyen de stimuler l’imagination vient, selon Luc Courchesne, de l’obscurité (Bergeron, COSTAIN, COURCHESNE, 1992). Ce dernier suggère d’utiliser l’assombrissement pour les expositions à thématique ouverte, c’est-à-dire laissant plus de place à l’interprétation, et, au contraire, une quantité majeure de lumière pour les expositions à thématique fermée, c’est-à-dire avec plus de données stipulées par le commissaire. Enfin, Sandro Ranellucci (2016) assimile la lumière à une base et en même temps à une clé, qui peut raconter quelque chose au visiteur. Plus récemment, l’éclairage a fait l’objet d’une théorisation qui l’assimilerait à un langage et un système sémiotique par Jean-Jacques Ezrati (2010 ; 2014) et Thomas Schielke (2019 ; 2020). Ces principes amènent graduellement à concevoir l’usage de l’éclairage pour stimuler l’émotion et l’imagination. Toutes ces considérations font état d’une réflexion frémissante que les concepteurs lumière et les architectes développent dans leur pratique et qui va, graduellement, se traduire vers des tentatives de théorisation.
Si la littérature scientifique traitant de l’ambiance est abondante chez les concepteurs lumière et les architectes, peu de muséologues s’intéressent à l’éclairage comme une forme de langage visuel de l’espace muséal (GOBBATO, 2022 ; 2023). Cette logique intervient surtout dans le cadre d’une vision plus large qui englobe l’expérience du visiteur. Dans les années 1930, Henri Verne (1937) commente, par exemple, les nouvelles installations conçues pour le Musée du Louvre, où l’éclairage a été soigneusement conçu selon la nature des expôts. Mais il faut attendre l’après-guerre pour voir émerger une pensée théorique dans ce sens, notamment par les réflexions de Stephan De Borhegyi (1963) ou de Marshall McLuhan, Harley Parker et Jacques Barzun (1969). George Henri Rivière développe aussi une réflexion sur le traitement lumineux des unités d’exposition, comme indiqué dans l’ouvrage dirigé par Hélène Weis (1989, p. 275). Il suggère notamment de relier les expôts à l’ambiance et, pour ce faire, d’utiliser les principes de hiérarchisation des objets éclairés, en éliminant toutefois les contrastes trop nets. Ses principes se basent ainsi sur un équilibre des ambiances. Plus récemment, la littérature scientifique en muséologie évoque d’autres principes, qui amorcent la notion d’éclairage d’ambiance. Par exemple, André Gob et Noémie Drouguet (2014, p. 202) considèrent l’éclairage comme « un moyen de mise en valeur des expôts ». Selon Élisabeth Caillet et Évelyne Lehalle (1995, p. 276‑277), l’éclairage « modèle l’objet alors réellement donné à voir ». Enfin, Michael Katzberg (2009) questionne le langage de l’éclairage au musée à partir des œuvres mobilisant la lumière comme médium et il identifie une fonction formatrice de la lumière qui contribuerait à construire l’œuvre.
L’idée qu’un éclairage pourrait être un élément de structuration de l’espace et d’influence de l’expérience muséale n’est donc pas totalement inconnue dans le champ de recherche de la muséologie. Néanmoins, il faut reconnaître que l’intérêt reste essentiellement influencé par les disciplines techniques et architecturales. Cette vaste étendue du possible, décrite par les professionnels, reste alors essentiellement un terrain à découvrir.
Construction de sens et éclairage, une voie méthodologique
Les théories de l’embodiment ne fondent pas encore, à notre connaissance, un paradigme pour la compréhension de sens en lien avec l’éclairage. En matière de réception, les études portent davantage sur la notion de préférence de la lumière : préférence en matière de rendu des couleurs des œuvres (LIU ET AL., 2013 ; VIÉNOT ET AL., 2008 ; FELTRIN ET AL., 2020), préférence de la température de couleur de la lumière (BOUST, EZRATI, 2010 ; NASCIMENTO, MASUDA, 2014), préférence de l’intensité lumineuse (AJMAT ET AL., 2011). Plus rarement, il s’agit de questionner un apport émotionnel par la lumière (IANNONE, TELLINI, 2021 ; ONG THIAN CHAI, 2017). Pourtant, une méthode qui s’inscrit dans l’énaction semble propice pour explorer la question. Il s’agit du programme de recherche REMIND, développé par Daniel Schmitt et Olivier Aubert (2017).
Comme nous l’avons déjà évoqué (GOBBATO, THEBAULT, SCHMITT, 2021), ce programme questionne les séquences de l’activité signifiante du point de vue des visiteurs. Il vise à reconstruire la dynamique cognitive incarnée et située de l’expérience. Comme l’explique Schmitt (2018), REMIND hérite des méthodes de rappel stimulé (stimulated recall) initiées par Benjamin Bloom (1953) et Gerhard Nielsen (1962), et reprend les apports de l’autoconfrontation de Jacques Theureau (1992 ; 2006 ; 2010). Il s’inscrit dans l’épistémologie de l’énaction formulée par Francisco Varela et Humberto Maturana (1994), qui considèrent que l’esprit ne peut être séparé du corps ni de son environnement (GOBBATO, THEBAULT, SCHMITT, 2021). Comme évoqué supra, cet ensemble forme une cognition incarnée (embodied cognition), c’est-à-dire qui stimule les capacités sensorielles des visiteurs et qui contribue à leur construction de sens (DI PAOLO, THOMSON, 2014), donnant une importance particulière aux émotions (VARELA, THOMPSON, ROCH, 1991).
En pratique, la méthode prévoit d’équiper un visiteur d’eye-tracker pour enregistrer son point de vue. Ensuite, le visiteur équipé parcourt un espace muséal, à son rythme et en autonomie. En fin de la visite, il est déséquipé et accompagné dans une salle où se déroule un entretien de restitution qualitatif. La personne, placée devant un ordinateur, est invitée à raconter, décrire et commenter son expérience à partir de la perspective subjective enregistrée de sa visite. L’entretien peut être enrichi d’une échelle affective indiquant un état de mécontentement/déplaisir (-3), neutre (0) ou de satisfaction/plaisir (+3). Une deuxième échelle peut être utilisée, incluant des notions de corporéité et de communication (THÉBAULT ET AL., 2021). L’entretien est enregistré sous un format vidéo qui couple l’audio avec la capture d’écran de la visite commentée. Les données sont ensuite codées, synchronisées (audio-vidéo-verbalisation) et traitées avec le logiciel ADVENE (AUBERT, PRIÉ, SCHMITT, 2012). Le fichier final est analysé selon six composants définis par Jacques Theureau (2004, 2006) : (i) le representamen – ce que l’individu circonscrit à un moment de son expérience ; (ii) les attentes – ce que l’individu attend de la situation/representamen ; (iii) l’engagement – la manière dont le visiteur réalise ses attentes ; (iv) le référentiel – les valeurs, normes, croyances, connaissances du visiteur ; (v) l’interprétant – la connaissance créée au moment t, et (vi) la valence émotionnelle. Cette méthode vise à identifier les séquences élémentaires de l’activité significative du point de vue des visiteurs depuis une perspective énactive.
Nous avons appliqué la méthode REMIND à deux études sur l’éclairage et l’expérience des visiteurs qui ont eu lieu à la Grande Galerie de l’Évolution (GOBBATO et al., 2020) et au Musée d’Art moderne de Paris (GOBBATO et al., 2021). Ces études se sont révélées concluantes pour l’observation des apports de la lumière dans la construction de sens. Les deux enquêtes avaient pour objectif d’évaluer l’influence de l’éclairage artificiel et dynamique sur la construction du sens chez les visiteurs en vue d’établir une typification. Pour identifier le rôle de la lumière dans ce processus, une attention particulière a été accordée aux dynamiques et aux séquences émotionnelles, sensorielles, mémorielles, imaginatives et aux interactions avec l’espace. Dans cet article, nous n’avons pas l’intention de présenter les résultats qui ont déjà fait l’objet de publications citées supra. Notre objectif est plutôt de mettre en perspective ces contributions et d’identifier quelques fonctions possibles de l’éclairage dans une perspective de l’énaction. Une brève mise en contexte s’impose néanmoins.
À la Grande Galerie de l’Évolution, il s’agissait d’évaluer les apports de l’éclairage dynamique scénographique conçu par Paul Chemetov, Borja Huidobro et André Diot dans les années 1990, et rénové par Stéphanie Daniel en 2013-2014 (GOBBATO, SCHMITT, 2021). Cet éclairage se compose d’une ambiance générale dynamique reproduisant un cycle nycthéméral – simulant la lumière du matin au soir – d’une heure et quinze minutes, tournant en boucle. Le scénario propose ainsi sept séquences : le lever du jour, le matin, le ciel nuageux, l’orage, la journée, le coucher du soleil et la nuit. Il présente également quatre ambiances d’éclairage pour simuler des environnements naturels : les pôles, la savane, le désert et la forêt tropicale. Il dispose enfin d’un éclairage général et architectural. Selon les premiers concepteurs, ce spectacle son et lumière visait à favoriser l’expérience cognitive, émotionnelle, esthétique, physique et sémantique des visiteurs (GALANGAU-QUÉRAT ET AL., 2014). Dix entretiens ont été menés à la Grande Galerie afin de saisir la portée de cette expérience sur l’expérience des visiteurs (GOBBATO ET AL., 2020).
Notre deuxième terrain portait sur la réalisation d’une enquête expérimentale auprès des visiteurs de la Salle Dufy du Musée d’Art moderne de Paris (GOBBATO ET AL., 2021). À cette occasion, nous avons conçu une mise en scène d’éclairage dynamique superposée à l’installation existante en 2021, d’une durée de trois minutes environ. Cette mise en scène visait à focaliser l’attention sur un scénario dynamique de lumière, qui se composait d’une dizaine de projecteurs de focalisation alimentés par des led posées au sol. Le scénario a été conçu avec l’intention d’attirer le regard des visiteurs sur les points nouvellement éclairés, disposés, pour la plupart, sur la partie supérieure de l’œuvre, à l’époque peu éclairée par le système d’éclairage permanent existant. Ces scènes ont été choisies pour leur représentativité de la compréhension de l’œuvre. Elles permettent en effet d’accentuer l’évolution de l’électricité et de ses conséquences sur le progrès. Pendant ce deuxième terrain, nous avons réalisé vingt-six entretiens.
Pour rappel, les résultats nous ont permis d’observer comment l’éclairage impacte la construction de sens du visiteur (GOBBATO ET AL., 2021). Tout d’abord, il influe sur les choix du visiteur, déterminant ce qu’il observe, la durée de son attention et ses déplacements dans la salle. Ensuite, il joue un rôle crucial dans le processus de réflexion du visiteur, influençant sa compréhension de l’exposition et la construction de ses récits. Enfin, il engendre des réponses sensorielles, émotionnelles et esthétiques, soulevant la question d’une expérience qui va au-delà de la réflexion intellectuelle et ouvrant la voie à une approche corporelle de la construction du sens.
Les fonctions de l’éclairage : stimuler, interagir, interpréter
Nos observations nous permettent d’identifier trois fonctions de l’éclairage dans une perspective énactive : une fonction cognitive, une fonction ostensive et une fonction esthétique. La fonction cognitive, entendue comme liée aux « activités mentales telles que la pensée, la mémoire, l’apprentissage et le langage » (MAIRESSE, 2022, p. 108), contribue à des séquences stimulant la construction du sens, le raisonnement et la mémoire. L’éclairage s’assimile à un système de communication visuelle permettant de transmettre un message propre au musée, à l’exposition ou à l’œuvre. La fonction ostensive supporte la monstration, elle permet de voir, influençant la perception formelle de l’espace et l’appréciation de l’art. L’éclairage facilite ainsi la lisibilité et l’intelligibilité de l’œuvre, mettant en avant des aspects tels que sa taille, sa couleur, sa texture, ses éléments et sa composition. Enfin, la fonction esthétique, associée à la faculté de sentir et à la sensibilité, peut stimuler la réaction émotionnelle, sensorielle, voire imaginative du visiteur. Ces trois fonctions semblent agir de concert ou de manière indépendante. Elles participent à une forme de médiation que l’on pourrait qualifier de « sensorielle », car elle passerait essentiellement par la stimulation visuelle. Ces fonctions favorisent la rencontre du visiteur avec l’environnement en relation avec certaines variables et caractéristiques de l’éclairage, telles que la couleur de la lumière, la teinte de la lumière blanche ou le rendement de la couleur d’un éclairage (qui dépend de l’éclairement et de l’Indice de Rendu des Couleurs, ou IRC, de la source), l’étendue du faisceau sur une surface, le mouvement temporel des scènes, la distribution spatiale, comprenant les contrastes et le jeu d’ombres et de lumières, la texture de la lumière, la matérialité du faisceau, son adoucissement ou son étirement par des filtres. Nous proposons d’approfondir ces aspects ci-dessous.
La fonction cognitive – Les scènes lumineuses semblent favoriser la création d’une trame narrative. En effet, les visiteurs se rattachent aux éléments éclairés pour construire le sens de ce qui leur est présenté. Ils s’engagent dans les scènes pour les déchiffrer, que ce soit de manière individuelle ou dans leur ensemble. Ainsi l’éclairage agit-il comme un élément stimulant le raisonnement et la capacité à rendre intelligible l’œuvre et l’espace d’exposition. Les contributions liées à la fonction cognitive semblent émerger particulièrement à partir de trois caractéristiques du dispositif sensoriel d’éclairage : la couleur, l’étendue et le mouvement. La couleur de l’éclairage segmente l’environnement visuel. Dans l’espace, elle encourage l’association avec des images passées connues par le visiteur, contribuant ainsi à la contextualisation de l’environnement observé – les couleurs chaudes de la savane, par exemple. Le visiteur établit alors des liens avec des représentations vues dans d’autres musées, vécues dans d’autres sites culturels ou provenant de la réalité urbaine et naturelle qu’il connaît. L’étendue de l’éclairage, quant à elle, focalise ou élargit le regard. Elle permet de circonscrire le representamen, c’est-à-dire le sujet de l’attention du visiteur à l’instant t. Ainsi, l’attention est restreinte à un ou plusieurs éléments, ce qui permet au visiteur d’extraire l’élément de la réalité observée – l’exposition – et de questionner cette unité dans une vision d’ensemble ou particulière. Enfin, le mouvement de l’éclairage attire l’attention du visiteur sur une ou plusieurs séquences. Il stimule des intrigues et des questionnements à propos du fonctionnement technologique de l’éclairage, lorsqu’il est observé, tout en éveillant la curiosité sur le motif du phénomène. Ces trois caractéristiques de l’éclairage semblent donc jouer un rôle essentiel dans la construction de sens des visiteurs sur le plan étroitement mental de l’expérience.
La fonction ostensive – Le dispositif d’éclairage contribue également à la construction du sens via des séquences liées à la perception de l’environnement et de l’œuvre. Les visiteurs utilisent la lumière comme un élément participant à la réception spatiale et formelle, activant ainsi la fonction ostensive de l’éclairage. En ce qui concerne l’espace, plusieurs éléments d’influence peuvent être identifiés, reposant sur trois caractéristiques du dispositif sensoriel d’éclairage : la couleur, le mouvement et la distribution. La couleur segmente et renforce la trame spatiale de l’exposition ou formelle de l’œuvre, favorisant l’attention et l’interprétation des visiteurs, ce qui fait écho à la fonction cognitive. Le mouvement organise la trame spatiale ou formelle sur une séquence plus ou moins courte en fonction de sa durée, influant l’étirement ou l’accélération du rythme de visite. La distribution de la lumière et des ombres favorise la perception des propriétés de l’environnement ou de l’œuvre. En effet, les différences spatiales, de formes et de couleurs sont davantage remarquées en raison de la diversité des luminances. Les visiteurs sont donc attirés par des coins ou des éléments plus lumineux, concentrant ainsi leur attention sur les zones éclairées et leurs environs. Ces trois caractéristiques participent à la construction spatiale et visuelle de l’exposition, d’un groupe d’expôts ou d’une œuvre. L’éclairage interagit dans l’environnement, stimulant la proprioception du visiteur.
En ce qui concerne l’œuvre, le dispositif d’éclairage contribue à l’étude formelle sur plusieurs plans. Les réactions observées reposent sur trois caractéristiques de l’éclairage : la couleur, l’étendue et la texture. La couleur, entendue comme la couleur de la lumière, mais aussi le rendu des couleurs possible par la source, souligne et valorise les caractéristiques formelles de l’œuvre (style, geste artistique, dimension, couleur, texture). L’étendue, définie comme la focalisation ou la distribution spatiale du faisceau de lumière, circonscrit une portion ou la totalité de l’œuvre. Ainsi, cette dernière se trouve détachée du paysage visuel, favorisant sa mise en avant et la focalisation de l’attention pour son étude. La texture entraîne une conséquence perceptible des caractéristiques de l’œuvre. Elle peut séparer ou à l’inverse relier les éléments éclairés, ou l’œuvre elle-même, à son environnement d’exposition. Ces trois caractéristiques participent donc de manière significative à l’étude approfondie de l’œuvre, offrant des perspectives nouvelles pour son analyse formelle et esthétique.
La fonction esthétique – Le dispositif sensoriel d’éclairage semble enfin participer à la construction du sens via des séquences en lien avec l’environnement et la perception émotionnelle, sensorielle et imaginative des visiteurs. Ces derniers s’appuient sur la lumière comme un élément participant de l’ambiance et de leur expérience, activant ainsi la fonction esthétique de l’éclairage. Les apports observés reposent principalement sur deux caractéristiques du dispositif sensoriel d’éclairage : la distribution et la texture. La distribution de la lumière, en fonction des assombrissements et des intensités, favorise la détermination de l’ambiance d’exposition. Un environnement tamisé stimule principalement des états positifs. Il est perçu comme un élément agréable de l’expérience de visite. Cela favorise le ralentissement, l’observation attentive de l’objet éclairé et donc l’étirement du temps de visite. La texture de la lumière participe également de cette perception générale en inscrivant le visiteur dans un espace vécu sur une valence positive, stimulant des états de plaisir, de bien-être et de contemplation, notamment dans le cadre de l’expérience de visite en Salle Dufy, face à l’œuvre (valence positive). À l’inverse, des états de déplaisir peuvent se déclencher lorsque la lumière n’est pas suffisante ou gêne le regard (valence négative), entraînant une accélération de la temporalité de visite, car le public recherche des endroits ou des objets mieux éclairés. Ces séquences émotionnellement et sensiblement négatives comportent une fatigue du visiteur à l’instant t, en lien étroit avec la fonction de visibilité. L’éclairage intervient ainsi dans la sphère émotionnelle et corporelle du visiteur.
D’après nos recherches, l’impact de la lumière sur la construction de sens des visiteurs dans un contexte muséal est complexe. Mais, malgré la subtilité de cet élément expographique, l’impact de l’éclairage nous semble pouvoir être mesuré et ainsi étudié par des méthodes affiliées à l’énaction, comme le programme de recherche REMIND. Les résultats indiquent, en effet, que la lumière exerce une influence significative sur les choix, la réflexion et les réponses sensorielles des visiteurs. Ainsi la lumière muséale ne se limite-t-elle pas à une fonction utilitaire, mais devient un élément intégral de médiation, jouant un rôle significatif dans la manière dont les visiteurs construisent du sens à travers leurs interactions avec l’environnement et les expôts. Ces logiques intègrent l’identification de variables et de paramètres pour qualifier l’éclairage, telle une « grammaire ». Rappelons que les professionnels de la lumière ont déjà instinctivement identifié ces aspects formels. Philip Hughes (2010) a développé, par exemple, la notion de hiérarchie de l’éclairage et du sens de l’exposition, en faisant appel à l’usage de paramètres comme l’accentuation, l’ambiance générale, les contours, les couleurs, la direction. Jean-Jacques Ezrati (2010) a, quant à lui, considéré l’éclairage comme un co-langage de l’exposition, qui renvoie à d’autres références en tant qu’élément qui produit du sens. Ezrati a notamment identifié des variables lumineuses, appelées « photèmes » : les variables plastiques (luminance, chrominance), les variables géométriques (étendue, direction), les variables spatiales (ambiance, focalisation, jeu de brillance) et la variable temporelle. Associés, ces photèmes créent des unités de sens, qu’il nomme les « lumisignes ». Ces travaux professionnels, mis en perspective avec nos travaux scientifiques, semblent converger vers un consensus : l’éclairage peut agir dans l’environnement, comme une forme de langage qui sera vécu et interprété corporellement, émotionnellement et mentalement par le visiteur. Nous constatons aussi que l’éclairage devient un stimulus pour les symboles perceptuels (BARSALOU, 1999), impliquant la perception, l’attention, la prise de décisions, ou encore le raisonnement.
Une nouvelle étendue concernant les apports de l’éclairage dans les théories de l’embodiment s’ouvre en conséquence. Soulignons que les domaines architecturaux réinterrogent depuis une dizaine d’années le modèle d’interactions écologiques et biologiques systématiques par le prisme de ces théories (DOWNING ET AL., 2008 ; LUCK, 2014 ; MALLGRAVE 2013 ; ROBINSON, PALLASMAA, 2015). L’approche énactive est plus particulièrement adoptée dans la continuation de la théorie phénoménologique et de ses apports en architecture (JELIC ET AL., 2016). On en déduit que « toute ‘transmission d’informations’ entre l’esprit et le monde – et donc entre l’individu et la société – doit inévitablement passer par le conduit matériel de l’expérience incarnée »2 (HALE, 2013, p. 33). Ce tournant va jusqu’à formuler des théories en neuro-architecture, entendue comme la base neuronale de la perception humaine et de l’interaction avec l’architecture environnante (WANG ET AL., 2022). L’architecture patrimoniale rentre également dans le cadre interdisciplinaire des théories de l’embodiment, notamment au sujet des questions de création de sens, de lieu, de mémoire et de culture (JELIC, STANICIC, 2022). Dans cette perspective, nos recherches sur l’éclairage muséographique s’inscrivent dans des contributions plus vastes qui pourraient intéresser le domaine de l’architecture. Elles permettent d’observer une nouvelle dimension sensorielle qui pourrait enrichir la compréhension des mécanismes environnementaux dans la construction du sens – comme nous l’avons constaté au musée, mais également dans d’autres contextes.
Conclusion
L’approche énactive, élaborée dans les années 1990, révolutionne la compréhension de la construction du sens, dépassant le cognitivisme. Elle se concentre sur le lien biologique entre l’individu et son environnement, remettant en question des disciplines variées. Fondée sur l’idée que la construction du sens est incarnée dans l’organisme et située dans son environnement, elle intègre les contextes biologiques, psychologiques et culturels. Cette approche considère la cognition comme une action incarnée, soulignant le rôle essentiel du corps dans la création de sens. Depuis cette perspective, les neurosciences influencent diverses disciplines en sciences humaines, telles que la psychologie, la linguistique, l’anthropologie, l’architecture, les sciences de l’information et de la communication, l’esthétique, et remodèlent les théories perceptuelles de la connaissance. L’énaction offre ainsi une vision centrale de la corporéité, qui implique la création de sens par la régulation adaptative des interactions, élargissant ainsi notre compréhension de l’esthétique, de la communication et même de l’expérience muséale.
En matière d’environnement muséal, nous avons notamment évoqué la façon dont un élément implicite comme l’éclairage peut contribuer à l’expérience sensorielle et esthétique du visiteur. Il guide ses choix visuels, impacte sa réflexion et suscite des réponses sensorielles et émotionnelles. Les fonctions identifiées, cognitive, ostensive et esthétique interagissent pour créer une expérience sensible dans l’environnement. La fonction cognitive stimule la pensée et la mémoire par la couleur, l’étendue et le mouvement de la lumière, favorisant la contextualisation de l’environnement observé. La fonction ostensive, liée à la perception spatiale et formelle, utilise la couleur, le mouvement et la distribution pour influencer l’attention du visiteur sur des éléments spécifiques. Enfin, la fonction esthétique crée une ambiance via la distribution et la texture de la lumière, impacte émotionnellement et sensoriellement le visiteur, contribue à la construction de sens et à son expérience globale. Ainsi l’importance accordée au corps, à l’incarnation et à la perception dans l’approche énactive semble-t-elle pouvoir être appliquée de manière plus large à la réception de l’environnement spatial et lumineux. En intégrant cela, nous pourrons nous doter de nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques pour comprendre comment l’expographie et ses composantes implicites, dont la lumière, interagissent avec le corps et la cognition pour façonner l’expérience et la signification.
En conséquence, un champ de recherche propice émerge pour intégrer les contributions de l’éclairage dans les théories de l’embodiment. La méthode REMIND, appliquée à l’étude de l’environnement spatial et lumineux, nous semble appropriée pour enrichir les recherches dans le cadre d’une muséologie énactive. Un effort collectif et collaboratif interdisciplinaire nous apparaît nécessaire pour établir de nouvelles recherches et pour formuler de nouveaux protocoles afin d’approfondir et de préciser ces premières contributions, leurs cadres théoriques et leurs méthodologies. Cette perspective muséologique pourrait plus largement enrichir le champ de recherche des disciplines annexes qui s’intéressent à l’éclairage et aux interactions, comme l’architecture, l’aménagement de l’espace, la technologie ou encore les sciences de l’information et de la communication.