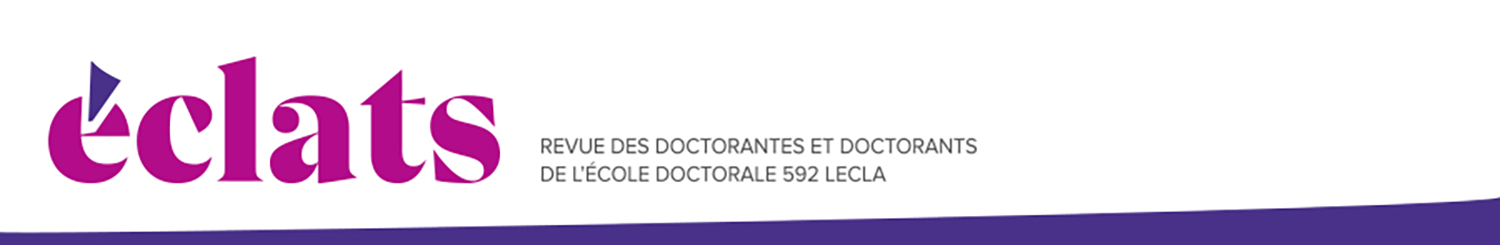Introduction
L’actualisation contemporaine de la science-fiction à travers des récits représentant des expériences transhumaines s’est accompagnée d’une concentration des intrigues sur les idées de souffrance, de sénescence et de mort. Cette focalisation est elle-même tributaire d’un changement de perspective donnant lieu chez certains écrivains à des reconfigurations formelles et thématiques majeures. Tandis que la science-fiction classique s’applique, à partir d’un novum1, à familiariser le lecteur avec le non-familier – ce qui l'inscrit dans le genre escapist –, la littérature du posthumain semble tendre davantage à étrangéifier2 ce qu’il y a de plus ordinaire. La mort et le corps sont ainsi marqués de nouvelles estampilles : ils sont réinterrogés et sortent de la prédestination et de la condition tolérable de l'individu. Un changement semblable s’opère depuis quelques années au niveau du cinéma ; comme le révèlent les travaux de Medhi Achouche3, les spectateurs assistent à l’émergence d’une « nouvelle science-fiction » beaucoup plus soucieuse de l’effet-réalité.
La question de l’apparition d’une nouvelle forme littéraire sous l’impulsion des réflexions transhumanistes et en réponse à l’espace important qu’occupe aujourd’hui la figure du posthumain – au moins dans l’imaginaire collectif – a déjà été traitée, dans le monde francophone, par quelques chercheurs dont Gilbert Hottois4, Maud Granger Remy5, Carole Guesse6, Amaury Dehoux7 et, dernièrement, Mara Magda Maftei8.
Dans cette étude, le curseur est placé sur deux romans francophones publiés très récemment : Risque zéro9 d’Olga Lossky (2019) et Le Lièvre d’Amérique10 de Mireille Gagné (2020). Dans ces deux textes où l’humain agit sur son corps et change sa condition, le médical ne se réduit pas seulement à une dimension thématique. Étroitement lié à un nouveau regard sur la mort, le médical – dans un sens large – fait office de fond structurant. Il constitue une partie essentielle de la rhétorique11 de ces textes. Il s’agit d’étudier les représentations littéraires nées de ce nouvel intérêt pour le posthumain et ce qu'elles peuvent apporter comme éléments de réflexion dans le champ des humanités médicales. Par une approche comparative des rhétoriques contradictoires prises en charge par les personnages centraux du corpus, cet article vise à mettre en lumière les savoirs transdisciplinaires que le texte littéraire véhicule via sa fonction gnoséologique12.
La littérature du posthumain dans la théorie francophone
Le transhumanisme est un mouvement pluriel dont les différentes tendances s’expriment à travers un ensemble hétérogène de textes. La perspective commune de l’émancipation de l’humain d’une partie de sa condition (mortalité, maladie, faiblesse et finitude du corps, déficits d’ordre moral ou intellectuel) grâce à la connaissance constitue néanmoins le fondement du mouvement13. Dans le cadre des transhumanismes, le posthumain14 représente le résultat possible des opérations d’augmentation de l’humain ou ce qui pourrait remplacer l’humain – une intelligence artificielle par exemple – dans le cas de l'extinction de notre espèce.
Les transhumanismes et le posthumain commencent à investir la théorie littéraire francophone. Précurseur de cette nouvelle tendance, Gilbert Hottois déplorait, dans un article intitulé « Le transhumanisme dans la science-fiction : la science-fiction à l’avant-garde des questions philosophiques et éthique15 », les simplifications et réductions trop nombreuses, opérées par les intellectuels, notamment dans le champ académique, de la pensée trans/posthumaniste et des interrogations éthiques relatives à notre monde technoscientifique et multiculturel. Ce constat est partiellement16 partagé par Carole Guesse qui regrette le manichéisme et la réflexion simpliste de certains essais écrits par un groupe d’intellectuels français se faisant appeler les « Nouveaux philosophes » (ou philosophes médiatiques) et qui ont longuement commenté le transhumanisme durant les années 200017.
Toutefois, des travaux d’ampleur publiés ces dernières années ont considérablement contribué à élargir et approfondir ce champ de réflexion. Dans Le Roman du posthumain18 (2020), Amaury Dehoux analyse les œuvres publiées par quinze auteurs de 1984 jusqu’à 2010 et qui sont traversées par la figure du posthumain. Il parcourt les littératures francophones, anglophones, hispanophones et japonaises avec, par exemple, les œuvres de Maurice Georges Dantec, William Gibson, Juan Eduardo Urraza et Kazuo Ishiguro. D’après le chercheur, le posthumain, par son décentrement et le renouvellement ontologique qu’il suggère, implique une nouvelle conception du roman. L’herméneutique de ce nouveau sous-genre littéraire est marquée par un caractère anthropologique paradoxal : c’est à partir de la certitude d’une différence foncière avec l’humain que le posthumain est interprété et représenté. Amaury Dehoux, tout en étudiant le posthumain, n’aborde pas – ou uniquement de manière périphérique – les transhumanismes. Cela dit, ses travaux entrent, dans une large mesure, en résonance avec ce qui a été initié par Gilbert Hottois et ce qui, en 2022, a été traité dans Fictions posthumanistes de Mara Magda Maftei19. La chercheuse y analyse les œuvres publiées par dix-huit auteurs de 1998 à 2020. Elle s'intéresse dans son ouvrage aux sources d'inspiration, aux interrogations et aux idéologies qui sous-tendent les imaginaires transhumanistes. Bien que l'étude de la chercheuse embrasse des auteurs de diverses nationalités, elle se focalise principalement sur la littérature française et aborde des auteurs tels qu’Antoine Bello avec Ada20, Michel Houellebecq avec La Possibilité d’une île21 – roman également étudié par Amaury Dehoux –, Pierre Ducrozet avec L’Invention des corps22 ou encore Gabriel Naëj (pseudonyme de l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganascia) avec Ce matin, maman a été téléchargée23. Ce n’est plus tant la figure du posthumain qui motive le choix du corpus – comme chez Amaury Dehoux – que la posture critique des textes vis-à-vis d’un transhumanisme que Mara Magda Maftei associe au « totalitarisme » et au « nazisme24 ». De Gilbert Hottois à Mara Magda Maftei en passant par Amaury Dehoux, les divergences sont sans doute nombreuses mais le constat de l’apparition d’une nouvelle perspective littéraire est le même. Tous ces travaux théoriques attestent de l’importance que revêt cette fiction dans la méditation et l’approche raisonnée de l’avenir de l’humain, de la technoscience et – pour ce qui nous intéresse le plus ici – de la médecine.
En considérant les apports théoriques évoqués, il convient à présent d'examiner le traitement du médical dans deux romans francophones contemporains considérés comme appartenant à la littérature du posthumain. Bien entendu, cette catégorisation ne se limite pas à une thématique. Elle répond à des critères liés au contexte, au fond et à la forme des œuvres. Ces romans brossent le portrait de l’humain qui se métamorphose et mettent en récit le dépassement de la médecine moderne. Si Risque zéro projette la pénétration toujours plus franche des corps par la technologie, Le Lièvre d’Amérique imagine le modelage, la transhumanisation salvatrice du patient souffrant.
Médecine et littérature du posthumain
Risque zéro, ou la fin de la praxis moderne
Risque zéro est un roman de l’écrivaine française Olga Lossky publié en 2019. Le lecteur y suit les aventures d’Agnès, une anesthésiste de l’hôpital universitaire Delcourt, à Paris, en 2039. L’essentiel du récit se déroule dans un cadre médical, les personnages centraux étant tous liés, de près ou de loin, à la médecine. Victorien, le mari d’Agnès, est le directeur multimédia de Providence : entreprise de médecine numérique comptant huit millions d’adhérents. Cette dernière, par le biais d’une puce sous-cutanée appelée « la plume d’ange », analyse en temps réel l’état de santé de ses porteurs. C’est le décès d’une cliente de Providence, entre les mains d’Agnès et de son collègue chirurgien Akim, qui constitue, d’un point de vue narratologique, l’élément perturbateur du roman. À travers la problématique de la responsabilité et de la culpabilité que se renvoient l’hôpital Delcourt et l’entreprise de médecine numérique Providence, Olga Lossky développe une réflexion sur la médecine, son évolution et ses limites. Une rhétorique comparée des différentes visions du médical et de l’humain mises en scène dans Risque zéro peut être établie à partir des discours et comportements adoptés par les personnages principaux.
Figures et positions
Il est nécessaire, dans un premier temps, de prendre en compte le regard « traditionnel » que portent Agnès et Akim sur la médecine. Agnès continue d’exercer dans un hôpital qui fait le pari de la médecine « à l’ancienne », gardant ses distances avec la médecine numérique. Son choix est largement motivé par l’intérêt marqué qu’elle manifeste pour les populations défavorisées et par sa foi dans le caractère thérapeutique du contact humain, de la relation médecin-patient. En effet, la nouvelle médecine que représente Providence, dans le roman, n’est pas accessible financièrement aux classes populaires et creuse, par conséquent, le fossé des inégalités sociales. Cependant, à la différence du chirurgien Akim, qui est plus catégorique dans son rejet de la médecine numérique, Agnès est tout de même abonnée à Providence. Elle, son mari et ses enfants jouissent de la puce sous-cutanée (« plume d’ange ») mais également d'autres technologies d’assistance : « WonderCooker » qui concocte des repas en fonction des besoins nutritionnels de chacun ou « Cinnamome », le robot ménager. Akim, quant à lui, demeure tout à fait hermétique à ce qui transformerait petit à petit l’humain en vulgaire machine : « Sous prétexte de sécurité on est en train de vider la vie humaine de ce qui fait sa substance : l’imprévu. La seule chose qui fait qu’on n'est pas encore complètement devenus des machines25 ». On doit noter, ici, que l’auteure insère une mise en abyme dans le récit par la voie un jeu vidéo conçu par Victorien et qui recrée dans le virtuel les personnes que ce dernier côtoie dans la réalité. C’est dans cet espace virtuel que la romancière exacerbe le caractère rebelle du chirurgien Akim, jusqu’à en faire un cyber-terroriste condamnant ce qu’il considère comme étant la destruction de l’humain par l’hybridation homme-machine. L’opposition d’Agnès est donc beaucoup moins radicale. Toujours dans une posture de méfiance, tout en s’inquiétant des dommages entraînés par leur essor et en critiquant l’aseptisation du quotidien, elle ne nie pas les bienfaits qu’apportent ces nouvelles technologies : « Le monde de Providence se résumait à cela : on se drapait dans une soie douillette à souhait mais n’en sortait jamais aucun papillon. Manquait un ciel où déployer ses ailes multicolores26 ». Enfin, Providence peut, par son suivi en temps réel et ses nombreuses notifications, provoquer une angoisse permanente chez le client et entraîner des dommages psychiques que l’entreprise ne prend pas en charge.
Dans ce roman, une perspective contradictoire se déclinant en deux tendances différentes est représentée par l’équipe Providence et le couple Le Ponti’ch – lequel a fait fortune dans le commerce des prothèses connectées. La communication de Providence s’appuie principalement sur l’amélioration considérable du confort, le nombre de vies sauvées et la promesse du risque zéro. Si l’entreprise se contente principalement d’un traitement des données grâce à la puce sous-cutanée de chaque client, de nouveaux projets de thérapie génétique préventive dès la gestation sont annoncés. Au-delà des critiques déjà évoquées plus haut, Providence est la cible des Le Ponti’ch qui sont ses concurrents. Reprenant les arguments d’un « transhumanisme dur », Helena Doukhovna-Le Ponti’ch pointe l’inefficacité des dispositifs de Providence appliqués à un corps humain trop faible, vulnérable et condamné à la finitude. Elle propose des solutions « extrêmes » telles que la dématérialisation et le téléchargement de la conscience :
Malgré les allégations et les slogans de Providence, le risque zéro n’est pas pour demain. Nos corps actuels sont trop fragiles, trop sujets aux multiples traumatismes qui les guettent pour rendre une telle utopie applicable. Le rêve du risque zéro ne pourra devenir réalité que lorsque l’humain aura trouvé une façon d’échapper à la dictature de sa propre finitude27.
Une troisième posture, plus inattendue, mais qu’une connaissance biographique d’Olga Lossky peut aisément éclairer, relève du christianisme orthodoxe. En effet, la romancière est issue d’une famille orthodoxe d’origine russe. Vladimir Lossky, arrière-grand-père d’Olga Lossky, est un des plus importants théologiens orthodoxes du vingtième siècle. Elle-même a consacré un ouvrage intitulé Vers le jour sans déclin28 consacré à la vie de la célèbre théologienne Élisabeth Behr-Sigel. Quelques points communs rapprochent, par ailleurs, la romancière et son ascendance du personnage d'Agnès et de ses parents : orthodoxie, origine russe, installation en France. La famille d’Agnès, dans sa quête de paix, s’en remet à la foi. L’interprétation religieuse des phénomènes contraste avec le discours scientifique qui domine le roman : « Au fond, j’aimerais pouvoir jouir de tous les avantages de Providence sans le savoir, se dit-elle en déverrouillant la porte d’un revers de main. Ça me dédouanerait de ces éternelles triturations de conscience. C’est la nostalgie de l’innocence d’Éden, dirait Mamaga29 ». À la « Providence technologique », les grands-parents d’Agnès répondent par la Providence divine.
Voix délibératives
Risque zéro, en mettant en scène le dépassement de la médecine moderne et son remplacement progressif par une médecine numérique – voire sa disparition par l’évacuation du corps et la dématérialisation de la conscience –, installe le lecteur dans une figuration problématique de la limite éthique. Dans le roman, toutes les postures présentées se révèlent chargées de dangers. Dès les premières pages du texte, le lecteur assiste aux vaines tentatives de sauver une patiente à l’hôpital Delcourt. Il assiste, ensuite, à l’utilisation abusive des « plumes d’ange » de Providence dans un cadre non médical : le mari d’Agnès parvient, en piratant les données de son épouse, à obtenir sur elle diverses informations : émotions, emplacements, activités. Horace, l’arrière-grand-père d’Agnès, en refusant tout suivi médical trop intrusif s’expose non seulement à tous les types de risques liés à son âge (cent huit ans) mais aussi à la prise en charge de l’État par la contrainte : un ultimatum est donné au centenaire qui doit choisir entre la prise en charge par un proche ou celle d’une instance spécialisée car il n’a plus le droit de vivre seul.
La praxis moderne peut-elle profiter du développement technologique sans perdre ses repères éthiques ? Dans quelle mesure les avancées médicales mettent-elles en péril l’humain ? Quelles sont les frontières de l’humain ? Comment séparer le soin de l’augmentation ? Chaque personnage semble placer la limite à un niveau différent. Les Le Ponti’ch appellent de leurs vœux l’élimination du corps. Providence s’arrête à l’hybridation et à la manipulation génétique. Agnès, sans totalement rejeter l’intrusion des technologies dans le corps, remet en cause les méthodes discriminatoires utilisées et l’efficacité même des dispositifs. Akim quant à lui considère que la technologie doit se limiter à son rôle d’outil sans toucher à l’intégrité physique de l’homme et sans lui subtiliser sa place : « Bien sûr qu’on a besoin de la technologie mais il faut la laisser à sa place. On a dépassé une ligne rouge. On en est venus à avoir avec le patient la même approche qu’une machine30 ». Enfin, dans un échange entre Agnès et Horace, son arrière-grand-père, la limite est largement antéposée : « Tu vois, une puce, c’est comme une broche, rien de plus. Tu es déjà un transhumain, alors un corps étranger de plus ou de moins dans le corps31 ». Cette comparaison met en relation directe l’objet médical utilisé et le degré d’humanité de la personne. De même, le parallèle entre la broche et la puce renvoie au débat sur la distinction qui serait ou non pertinente entre réparation et augmentation. En effet, selon la critique, la broche relèverait de la prothèse substitutive tandis que la puce serait plutôt une prothèse augmentative32 – encore faudrait-il que la puce entre dans la définition de la prothèse. Cette question n’est pas si simple compte tenu du caractère quasi vital que certains outils occupent aujourd’hui chez l’homme contemporain qui parvient de moins en moins à s’en passer. Dans la première moitié du roman, Agnès vit ainsi la privation de son téléphone comme une amputation lorsqu’elle se retrouve sans téléphone : « La priver de cet instrument qui, même si elle était la première à le déplorer, était devenu constitutif de sa personne, l’amputait de ses capacités élémentaires33 ».
Une thanatographie de la mort
Cette polarisation des perspectives ne serait-elle pas due au rapport particulier qu'entretiennent à la mort les transhumanismes et, en l’occurrence, la littérature du posthumain ? Un rapide survol des épigraphes – qui suggèrent souvent l’esprit du contenu – des œuvres traitant du posthumain donne une idée du caractère fondamental de la mort dans cette littérature. Les deux épigraphes de Risque zéro portent sur la mort (ou l’immortalité) : « La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort34 », et :
Dans l’autre qui change, si j’aime aussi ce changement, je pressens celui ou celle qui ne change pas. Je pressens son icône, sa vocation, comme si Dieu m’associait à l’amour qu’il a pour lui, pour elle, de toute éternité, à cet appel que de toute éternité il lui adresse. Alors l’autre, pour moi, existe non seulement dans le temps de la mort et de la discontinuité, mais aussi dans le temps ressuscité où l’on mûrit comme un étrange fruit d’immortalité35.
La première citation (de Xavier Bichat) est d’ailleurs reprise exactement de la même manière (en épigraphe) dans Transparence36 de Marc Dugain, un roman qui met également en scène des enjeux similaires (le posthumain, l’omniprésence de l’intelligence artificielle, la société de contrôle et de surveillance). Le roman de « science non-fiction » – comme le qualifie l’auteur lui-même – Une vie sans fin37 de Frédéric Beigbeder, qui raconte les péripéties d’un journaliste investiguant au cœur des cercles transhumanistes, ponctue ses parties d’épigraphes monothématiques sur la mort. Évidemment, la mort n’est pas abordée dans ces textes comme elle le serait dans ce qu’on appelle la « thanatographie38 ». Rappelons que ce concept désigne en théorie de la littérature tous les récits de mort ; souvent en rapport avec des biographies. Dans la thanatographie, la mort est explicitement traitée. Mais on peut faire le constat que la mortalité est toujours présente dans la littérature (tous genres confondus), ne serait-ce qu’implicitement : même si cela n’est pas narré, le personnage, dans l’esprit du lecteur, tend toujours vers sa fin. C’est peut-être aussi cela qui peut distinguer la littérature du posthumain et qu’elle opère comme bouleversement, selon la formule transhumaniste célèbre : « la mort de la mort ». Ainsi, de la thanatographie de la vie – osons le pléonasme – du roman traditionnel, la littérature du posthumain engagerait le lecteur dans une poétique thanatographique de la mort. De l’ontogenèse – qui de la vie tend vers la mort –, nous passerions à la phylogénèse39 de l’humain et du posthumain : de la mortalité vers l’immortalité. Cette différence de perspective n’est pas oubliée dans Risque zéro : « Montaigne affirme que philosopher, c’est apprendre à mourir. Providence prétend apprendre aux gens à vivre40 ».
Si, comme il est précisé plus haut, la mort d’une femme abonnée par Providence constitue l’élément perturbateur qui enclenche les péripéties, c’est un autre drame qui va modifier en profondeur le comportement du personnage principal. Agnès, suspectée d’être, d’une façon ou d’une autre, responsable du décès, est placée en garde à vue. C’est à ce moment que la matière religieuse orthodoxe se mêle au récit. Une autre idée couverte par le roman prend davantage de gravité dans cette séquence : la vulnérabilité de l’individu au sein d’une société de contrôle autoritaire. La narration utilise alors l’image du lapin pour représenter la détresse d’Agnès, « tournant en tous sens dans son clapier pour échapper à la main du paysan qui cherchait à le saisir par les oreilles41 ».
Le Lièvre d’Amérique, ou la médecine du transhumain
Second roman abordé par cette étude, Le Lièvre d’Amérique, publié par l’écrivaine canadienne Mireille Gagné en 2020, représente une société néolibérale où l’individu aliéné est, cette fois-ci, figuré non plus par l’image du lapin mais par celle d’un animal qui en est très proche : le lièvre.
Tensions corporelles et narratives
Tantôt qualifié de fable néolibérale42, tantôt de roman d’écologie43, ce texte partage quelques points communs avec Risque zéro. Le personnage principal est une jeune femme prénommée Diane. Son corps est aussi sujet à la modification : il ne s’agit cependant pas ici de l’intrusion d’une « simple » puce sous-cutanée comme dans le cas d’Agnès mais d’une action bien plus conséquente sur son substrat organique. Diane souffre dans un corps faible, fragile, à la merci de tous les maux :
Des semaines et des semaines et des semaines à sentir de la pression sur ses épaules sa tête dans un étau une fatigue physique et mentale persistante un manque d’énergie de nombreux réveils nocturnes de l’insomnie un épuisement mental une attention déficiente des cauchemars récurrents du bruxisme une perte d’appétit de poids des nausées des crampes répétées des raideurs des lombalgies la nuque tendue des douleurs aux jambes la mâchoire crispée des migraines des acouphènes des vertiges des palpitations cardiaques de l’hypertension un ulcère d’estomac récalcitrant une transpiration abondante la gorge sèche de l’hyperventilation une perte de cheveux des troubles visuels de l’eczéma des trous de mémoire un désintérêt pour tout un désengagement soudain de l’irritabilité une hypersensibilité44.
En ne ponctuant pas le passage et ne conjuguant aucun verbe, le narrateur place le lecteur dans une dimension temporelle figée qui renforce d’autant plus les effets du registre pathétique et les procédés d’intensification : répétitions, gradations, et concentration sur le motif de la souffrance. Tout le corps (épaules, tête, nuque, jambes, estomac, oreilles, gorge, cheveux, yeux, peau, poitrine…) est source de supplices. Le temps verbal n’existe plus ; c’est en traversant les espaces corporels nominalement listés que le lecteur saisit la dynamique de l’intrigue. Ces symptômes physiques et psychiques décrits sur plusieurs pages tout au long du texte sont développés dans l'axe « J- ». Mireille Gagné structure sa narration à partir de deux axes temporels alternés (J- et J+) et qui sont entrecoupés de deux autres séquences : une description documentaire du lièvre d’Amérique (l'animal réel) et des souvenirs qui remontent à l’enfance de Diane. Le « J », repère des deux axes principaux, correspond au jour de l’opération d’augmentation à laquelle le personnage se livre. Le fait médical est ainsi, à nouveau, au cœur de l’œuvre et constitue l’axe central d’une tension narrative principalement prise en charge par le récit des souffrances de la jeune femme.
Une opération augmentative salvatrice
En effet, Diane prend la décision radicale de se faire opérer dans la clinique médicale Génomixte. Elle y voit le seul recours possible pour survivre dans une ville où le culte de la performance et l’aliénation des plus faibles demeurent les maitres-mots. Une nouvelle collègue de travail aux excellentes performances ne fait qu’aggraver sa frustration. Diane est obnubilée par l’idée de s’améliorer : elle travaille méthodiquement chacun de ses muscles et aspire à une vie exempte de toute imperfection. Dans un premier temps, le lecteur découvre que sa métamorphose post-opératoire met, effectivement, fin à ses épreuves. Dans son cadre professionnel, Diane s’améliore considérablement et devient largement plus performante que ses collègues. Elle est admirée. Paradoxalement, ce nouvel être-au-monde plein de puissance ne fait qu’accentuer la sensation d’étouffement que le personnage ressent dans une ville bâtie sur l’aliénation. Elle ne se complaît pas dans son rôle de centre des regards, qu’ils soient inquisiteurs ou admirateurs. Elle prend la décision de quitter la ville et se réfugie dans la forêt :
Diane démarre, embraie et roule, roule, roule, encore et encore, pour sortir le plus rapidement possible de la ville. Dans son champ de vision, des immeubles plantés de chaque côté de sa voiture lui indiquent la direction à prendre45.
L’opération a fait de Diane un être hybride mi-femme mi-lièvre qui retourne finalement à un milieu naturel et sauvage. Incapable d’intervenir de manière conséquente sur son environnement afin que ce dernier s’accorde à sa façon d’être, la jeune femme s’applique au design de son propre substrat organique. Le design tel que défini par Amaury Dehoux suppose un double processus admettant non seulement l’aménagement de la sphère de l’homme mais également – et surtout lorsque cet aménagement se révèle insuffisant pour l’optimisation de son être-au-monde – le modelage de son propre corps46. Le lecteur peut légitimement s’interroger sur la raison profonde qui conduit Diane à se transhumaniser. Notons que le caractère animal de la métamorphose du corps féminin n’est pas sans rappeler Truismes (1996) de Marie Darrieussecq47 – bien que le cas de Diane soit nettement moins surnaturel : il s’agit bien d’une opération clinique et non d’une transformation magique.
Souffrant d’innombrables maux, la jeune femme s’en remet, pour se dépasser, à une médecine qui elle-même va bien au-delà de son domaine d’action traditionnel. Problématique amplement traitée notamment dans les travaux du médecin et neuroscientifique Hervé Chneiweiss48, les frontières de la médecine semblent être celles-là même qui marquent les limites de l’humain. En ce sens, toute intervention déshumanisante par le modelage, la manipulation génétique ou le remplacement sortirait du domaine médical. Par son choix de Génomixte, Diane n’a pas uniquement la volonté de guérir : elle cherche à s’affranchir de sa condition humaine pour enfin se délivrer – pour reprendre le titre d’une étude d’Alain Ehrenberg – de « la fatigue d’être soi49 ».
Limites d’un genre et d’une pratique
Entre Risque zéro et Le Lièvre d’Amérique se dessine toute une mosaïque de personnages (humains, transhumains, posthumains) et de pratiques médicales qui s’appuient tous et toutes sur des postures idéologiques spécifiques, un découpage singulier du monde. Dans Le Roman du posthumain, Amaury Dehoux propose justement une typologie de la posthumanité qu’il divise en trois catégories50 :
- L’être modelé et le clone – dont nous avons ici l’exemple avec Diane
- Le cyborg et l’être virtuel – projet du couple Le Ponti’ch
- L’intelligence artificielle – qui n’a pas dans ce corpus la consistance d’un personnage (actant) mais que l’on retrouve par exemple dans les œuvres de Josselin Bordat51.
En ce qui concerne la structure des textes, les auteurs procèdent à des constructions qui ramènent, au centre des récits, ce qui dans la science-fiction demeure souvent périphérique. Ici, il s’agit moins de motifs technologiques décorant une intrigue finalement « réaliste » que de fables méditatives sur l'avenir. Mireille Gagné n’évoque d’ailleurs dans son roman aucune technologie et décrit, elle-même, son œuvre comme fable néolibérale. Le Lièvre d’Amérique partage, par ailleurs, ce point commun avec The Fable of the Dragon-Tyrant52 de Nick Bostrom, professeur à Oxford et philosophe transhumaniste majeur. The Fable of the Dragon-Tyrant est un exemple édifiant de cette caractéristique formelle. Le philosophe ne s’embarrasse pas d’un monde imaginaire poussé : environnement ultra-moderne, foisonnement technologique, voyage intergalactique. Le spectaculaire technologique du cyberpunk, du post-apocalyptique ou du space-opera est évacué pour laisser place à un récit phylogénétique53 relatant la victoire contre le vieillissement – figuré dans la fable par un dragon allégorique qu’une équipe de scientifiques achève grâce à un missile métaphorique.
Conclusion
Sur l’étendue éditoriale qu’offre la littérature du posthumain, le savoir médical se décline en une nébuleuse de représentations qui traduisent autant d’espoirs d’avenir, de changement et d’émancipation que d’inquiétudes éthiques et d’apories philosophiques. C’est par le biais d’une gnoséologie de la limite que Risque zéro et Le Lièvre d’Amérique font la peinture de cette interdépendance rarement considérée entre l’anthropologie et la médecine, à travers la juxtaposition d’une certaine forme de conservation morale et organique avec une certaine acception du médical. Ces récits exposent ainsi le lecteur à des nuances d’humains qui résultent d’une variété de praxis elles-mêmes jaugées différemment selon tout un panel de regards relativement contradictoires, de l’hôpital Delcourt à Génomixte en passant par Providence, des Le Ponti’ch à Akim en passant par Diane.
De cette même façon, on ne peut que constater la complémentarité de la théorie du posthumain et des humanités médicales. Le récit permet d’approfondir la conception de la médecine et de l’idée de santé en relatant les expériences du lieu d’enchevêtrement idéal qu’est le corps humain. La frontière de l’humain est indissociable de celle qui permet de définir la médecine. À ce titre, le posthumain, en impliquant nécessairement la possibilité d’une « post-anthropologie54 », convoque l’extension de nos valeurs à de nouvelles réalités, touchant autant les sciences humaines et sociales que les sciences exactes, médicales et de santé. En projetant la fin de la maladie, de la sénescence et, par conséquent, de la médecine comme pratique de soin, la littérature du posthumain propose, singulièrement, une thanatographie de la mort et, par conséquent, de toutes les fins.