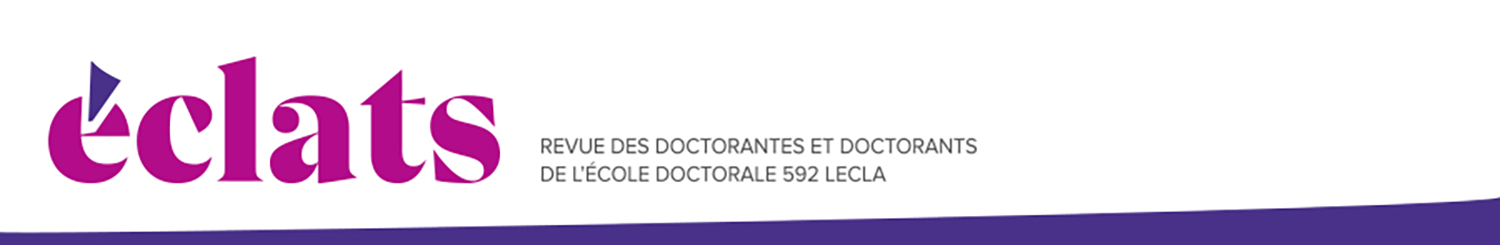Illustration : Affiche pour le spectacle Showgirl de Marlène Saldana et Jonathan Drillet au CDN de Besançon
©CDN Besançon
Cindy Gervolino (CG) : Votre pièce s’empare adroitement de la structure du film de Verhoeven sans la reproduire exactement. Le film, comme tout film de Verhoeven, place ses personnages dans ce qui semble être d’abord un chemin permettant une libération. Ici, Las Vegas : Nomi pense se libérer via la danse et la réussite au sein de l’industrie du spectacle. Verhoeven dérègle toujours cette trajectoire en détruisant littéralement les conditions de possibilité d’une libération, si bien que ses personnages construisent leur propre prison. Ainsi, comment avez-vous travaillé la structure de la pièce, la composition ? Avez-vous cherché à exhiber cette libération impossible par des temps où le personnage que vous incarnez se réfugie dans le volcan et est parcouru de tremblements, là où Nomi semble systématiquement sûre d’elle ? Pourquoi avoir dévoilé la véritable identité de Nomi Malone dès le début ?
Marlène Saldana (MS) : On n’a pas du tout pensé à construire la pièce comme le film. L’idée était de ne pas raconter le film de manière linéaire, précisément parce qu’il s’agissait d’évoquer également la trajectoire d’Elizabeth Berkley2. Tout ce qui est de l’ordre du tremblement représente ces deux trajectoires très différentes – et en même temps, si similaires –, celle de Nomi et celle d’Elizabeth, et les moments où elles s’entrechoquent. Le film propose un scénario très classique, typique du film de danse, de la fille qui sort de la rue et arrive à se hisser dans une société, avant de retomber, rejoignant ainsi les codes classiques de la fallen woman. Dans l’élaboration de la pièce, nous avons volontairement cherché à déjouer cette temporalité, à déconstruire ce schéma. La pièce propose trois modes de narration différents : une partie que nous avons appelée « Trapped in Showgirls », qui correspond à tous les moments où je raconte le film, sur le mode « je fais ceci, je fais cela », accompagnée toujours de la même musique. Les chansons de Rebeka Warrior proposent une deuxième forme narrative, et la troisième partie est composée des échanges que j’ai avec le personnage de Murray, incarné par Jonathan. On a mélangé ces trois narrations pour faire un spectacle qui n’est pas linéaire, qui fonctionne par rebonds : on ne sait jamais trop où l’on est. La partie « Trapped in Showgirls », où l’on raconte le film, suit cependant la chronologie de Verhoeven. Nous nous sommes concentrés plus précisément sur les scènes de loges.
CG : Vous partez d’un film qui reprend les codes de la fallen women. Avez-vous cherché à travailler la thématique de la déception à travers votre mise en scène, en cherchant à déstabiliser les attentes du public, par exemple avec la musique techno qui peut surprendre, ou dans le travail de vos éclairages relativement sombres, là où Vegas fait penser aux lumières ? D’aucuns emploient les termes de « kitsch », « baroque », ou « burlesque » pour qualifier votre pièce : qu’en pensez-vous ?
MS : Ce n’est pas tant de la déception que de la frustration. Le côté « Vegas » est surtout représenté dans les costumes, et dans la parole. C’est une esthétique qui est loin d’être kitsch ; d’ailleurs, cette bipartition entre le « bon goût » et le « mauvais goût » est tout à fait intéressante à explorer. Dans notre pièce, il y a seulement deux éléments de décor : le volcan, et le lustre en forme de phallus3. Nous sommes donc loin d’être dans le surplus, il s’agit plutôt d’un décor radical. Le côté « Vegas » a été traité autrement, et justement, c’est tout l’intérêt de jouer sur la frustration de tout le monde : les fans du film ne parviennent pas à retrouver exactement ce film dans notre pièce. Évidemment, car ce n’est pas le film ! Il y a déjà eu une comédie musicale sur ce film, qui est une parodie. De notre côté, nous souhaitions éviter à tout prix la parodie, car ce dont nous voulions parler nous semblait trop important. J’adore la parodie, ce n’est pas la question, mais ce n’est pas ce qu’on voulait faire ; en un sens, notre démarche se situe presque à l’opposé. D’un autre côté, il n’était pas possible de proposer une reconstitution du film, notamment pour des raisons techniques, mais aussi parce que nous souhaitions éviter la vidéo, qui nous semblait être un non-sens dans une pièce qui parle d’un film.
CG : Au niveau de l’écriture, à quel moment sont venus les temps de réflexion sur le cinéma, quel cheminement ont-ils suivi dans la genèse de la pièce ? Comment avez-vous décidé de la répartition entre parties chantées et narrées, et avez-vous procédé à des changements les concernant ?
MS : Nous avons beaucoup travaillé sur l’ordre, le déroulé, et initialement, nous ne savions pas comment rentrer dans le vif du sujet (c’est également le cas dans la pièce sur laquelle nous travaillons actuellement). Nous savions de quoi nous voulions parler, mais pas par quel bout le prendre ! L’idée initiale était que j’incarne tous les personnages. À la faveur d’un apéro de voisinage durant le confinement, un voisin incollable en rap m’a évoqué Trapped in the closet de R. Kelly. Il nous parle de l’époque où il est connu avec son titre I believe I can fly, c’est le moment où c’est une star mondiale qui vend énormément de disques R&B. Trapped in the closet propose une sorte de télénovela qui dure trois heures durant lesquelles il interprète tous les personnages, en chantant. Les autres font du playback, et c’est sa voix qui raconte l’ensemble de l’histoire. C’est là que je me suis dit : c’est exactement ce qu’il faut faire, il faut être enfermé dans Showgirls, se mettre à la place de quelqu’un qui est à l’intérieur du film et raconte ce qu’il s’y passe, ce qu’on pense au fur et à mesure.
Dans le résultat final, pour notre pièce, tu ne sais plus qui parle : l’actrice qui est sur le tournage, le personnage, ou moi-même. Nous nous sommes donc attelés à l’écriture de la « trapped », dans notre jargon, c’est-à-dire les moments où l’on décrit ce qu’il se passe. Au début, la pièce durait sept heures, il a donc fallu couper ! Plus on avançait dans ce processus d’écriture, plus cela nous a paru évident que notre propos principal portait sur l’actrice, c’est pourquoi les scènes de loges nous ont paru les plus intéressantes. Elles marquent également l’évolution du personnage de Nomi Malone dans le film, qui passe du Cheetah au Stardust. C’est aussi ce qui nous a permis d’aller voir ce qu’il se passe derrière le film. Nous avons travaillé avec beaucoup de plaisir avec l’artiste Rebeka Warrior, en lui passant des commandes pour certaines chansons, et en écoutant ses propositions.
CG : En effet, c’est ce qui nous frappe d’emblée dans la pièce : la musique, en l’occurrence la techno avec les splendides compositions de Rebeka Warrior. Le film présente des scènes de danse de haute volée, mais on peut dire que c'est un film dansant qui n'est jamais musical. Pourquoi avoir fait le choix de la musique électronique ? En tant que telle, cette musique est souvent fustigée comme n’étant pas de la « vraie musique » : est-ce une façon de tisser un parallèle avec la lap-dance du film, lui aussi souvent considéré comme n’étant pas de la « vraie danse » ?
MS : Rebeka Warrior, dont nous apprécions énormément le travail, nous a semblé dès le début être une évidence pour la création musicale de cette pièce. Rebeka compose ce que j’appelle des « haïkus punk » : elle fait « sujet-verbe-complément », et c’est toujours très pertinent. Je ne me voyais pas demander à quelqu’un d’autre. J’aimais aussi le côté « club », musique composée pour inviter à danser. Initialement, on souhaitait que le public regarde la pièce debout, afin d’avoir la possibilité de danser. Mais nous avons monté cette pièce juste après la Covid, c’était donc interdit. Nous n’avions pas nécessairement envisagé le parallèle entre techno et lap-dance … Mais nous allons peut-être tenter des représentations debout, comme il était prévu initialement. Cela dédramatiserait un peu la pièce, j’aime bien le côté « vous n’êtes pas obligé·e·s de regarder, vous pouvez juste danser ! ».
CG : Il me semble que la pièce privilégie des gestes évocateurs (par exemple en plaçant son personnage à cheval sur le décor-phallus), plutôt que de proposer un véritable numéro de danse. Quelles sont vos influences du côté de la gestuelle, de la mimique, du visage ? Comment avez-vous travaillé le rapport au corps, dans les temps chorégraphiés comme ailleurs ? Avez-vous cherché à déplacer les danses de Nomi faites pour donner du plaisir visuellement, vers une gestuelle qui montre sur scène un plaisir féminin ?
MS : Je ne voulais pas du tout chercher à imiter les danses du film : elles sont très complexes et réclament un haut niveau technique. Je ne voulais pas non plus faire une parodie. La lap-dance que Nomi Malone reproduit à plusieurs moments dans le film, toujours avec la même chorégraphie, est une danse de bar. Nous nous intéressons depuis plusieurs spectacles au butō, une danse japonaise qui est née dans les cabarets. Il s’agit d’une danse un peu sexy, très désarticulée, pas loin du burlesque, mais à la japonaise. Pour moi, c’était le moyen de concilier l’omniprésence de la danse, très marquée dans le film, et la théâtralité. Nous avons cherché à théâtraliser la danse, précisément en utilisant une forme radicalement différente du lap-dance. Le butō pourrait être en quelque sorte le lap-dance de l’art contemporain. Le butō est aussi une danse de visage, de grimaces. Dans notre interprétation avec Jonathan Drillet du couple Yves-Saint-Laurent et Pierre Bergé dans Fuyons sous la spirale de l’escalier profond4, nous étions très maquillés, avec beaucoup de prothèses. Le visage nu choisi pour cette pièce est plutôt rare par rapport à nos autres productions.
CG : Il est vrai qu’avec cette gestuelle, mais aussi avec vos échanges autour du cinéma, nous rions beaucoup face à cette pièce. Pourquoi avoir choisi l’humour et le rire, absents du film, sauf à le considérer comme un nanar, comme ce fut le cas pour une partie de la critique à l’époque de sa sortie ?
MS : Toutes nos pièces sont drôles, elles ne font pas rire tout le monde, mais c’est notre manière de nous exprimer ! On essaie toujours de mettre du rire dans les pièces, ce qui nous permet également de traiter des sujets plus graves. Prenons l’exemple de notre pièce sur la Françafrique5 : on ne se dit pas que cela va être drôle en y allant. C’est ce qui permet d’éviter une forme de moralisme, de catéchisme, et aussi d’éviter la pédagogie dissimulée au théâtre, que nous cherchons à fuir à tout prix. Mais il y a des rires variés dans le public… C’est aussi ce qui est intéressant.
CG : Vos décors sont absolument fascinants, notamment avec ce fameux volcan dont on a beaucoup parlé. Faut-il y voir l’image d'une Nomi flamboyante, ou celle de ce monde d’artifices dans lequel elle évolue ? Pourquoi avoir intégré le nom de Bernard Laroche, un temps suspecté dans l’affaire Grégory, sous un élément de décor ?
MS : Le nom de Bernard Laroche sous la pierre nous faisait rire, nous avions hésité avec Yves Rocher, avant de pencher pour le premier. Pour ce qui est du volcan, il représente ce que la personne qui le regarde a envie qu’il représente… Pour moi, c’était absolument nécessaire qu’il y ait un volcan. Le film est avant tout l’histoire d’une fille qui veut être celle qui sort du volcan, à la place de l’autre fille6. Initialement, nous envisagions un rapport au décor à la manière de la pièce Oh les beaux jours de Beckett : nous voulions tout faire dans le volcan, pour que le personnage soit véritablement coincé dedans. La pièce de Beckett est un monologue d’une femme seule dans le désert, avec son compagnon qui a une phrase toutes les heures, un peu comme Murray dans notre pièce ; c’est donc une sorte de dramaturgie de dramaturgie. Une des théories est que Beckett aurait écrit cette pièce en s’inspirant d’une photo réalisée par un Anglais des années 1930 d’une artiste de cabaret prise jusqu’à la taille dans un tas de sable, qui se regarde dans un miroir. Finalement, nous avons abandonné l’idée de faire toute la pièce dans le volcan, et développé dans la scénographie celle d’en faire un mini-bar qui puisse se retourner.
CG : « Nous ne cherchons pas à tenir un discours féministe », dites-vous dans le livret de présentation de la pièce. Le regard masculin est omniprésent dans le film de Verhoeven, et vous l’avez représenté dans le décor avec un énorme phallus qui clignote. Avez-vous cherché à faire de cet objet l’incarnation de ce regard masculin voyeuriste, finalement beaucoup plus passif que les femmes qui dansent autour ? De manière plus générale, votre décor cherche-t-il à représenter une « guerre des sexes » ou, du moins, une confrontation des points de vue ? Ou est-ce retomber à nouveau dans les catégories binaires stériles que vous dénoncez dans les premières minutes ?
MS : Depuis la création de la pièce, il y a eu beaucoup d’évolution sur ces questions-là. Les questions et les réactions autour du féminisme de la pièce ont évolué elles aussi au fil du temps, plus particulièrement récemment avec le Me too du cinéma français. Chaque public dépose son propre regard sur notre pièce. À mon sens, une « pièce féministe » ne veut rien dire en soi. Ce n’est pas qu’on ne souhaite pas en parler, c’est qu’on se refuse à en parler « vite », de manière superficielle, car c’est un sujet brûlant. Par cette affirmation, nous souhaitions souligner la nécessité de ne pas voir la pièce uniquement selon ce prisme. Évidemment, c’est une pièce féministe, mais ce n’est pas une pièce militante. Cela a d’ailleurs pu poser problème pour certaines personnes, notamment parmi la jeune génération. Par exemple, après notre première à Genève, nous avons rajouté certains éléments après la chanson de fin. Une classe de première nous a fait remarquer que les choses n’étaient pas dites assez clairement.De la même manière que le film Showgirls peut aussi bien être regardé comme une œuvre féministe que fustigé comme ne l’étant pas, je souhaitais que la pièce soit du même acabit. Le public y voit ce qu’il veut y voir, même s’il semble évident qu’il s’agit d’une pièce traversée par des réflexions féministes dans sa conception. C’est aussi pour cela que la discussion sur Woody Allen est très importante. C’est le personnage féminin que j’interprète, qui dit à Murray « Ah, c’est cancel culture woke ! », donc il n’est pas noir ou blanc, mais gris et ce, dès le début. J’adore ce film de Woody Allen7, et notamment la scène scatologique que nous évoquons dans la pièce, qui est hilarante. Je voulais parler précisément de ces contradictions. Nous ne proposons pas un verdict moral qui viendrait trancher entre « c’est bien » ou « c’est mal ». Nous souhaitions éviter le moralisme. Ce que nous sommes en train d’écrire actuellement soulève d’ailleurs des enjeux tout à fait similaires.
CG : Pourquoi avoir choisi d’ouvrir la pièce sur le personnage de Tony Moss, c’est-à-dire par un regard masculin, mais aussi par le sombre dans l’éclairage, à l’opposé des lumières de la ville qui ne dort jamais, et par un silence qui tranche avec les riches compositions musicales qui suivent ? Comment s’est posée la question de la voix masculine lorsque le film parle plutôt de regard masculin ?
MS : Le début, plus qu’une voix masculine, est davantage une voix du jugement. D’ailleurs, ce n’est pas uniquement Tony Moss, mais un mélange entre les scènes d’audition dans le film, des critiques écrites sur l’actrice Elizabeth Berkley, qui joue le rôle principal, et les sketchs du personnage de Mama au Cheetah. Jusqu’à l’année dernière, on ne savait pas si c’était ou non un homme qui parle : le texte cultivait justement un brouillage à ce propos. Mais c’était peut-être rajouter une complication qui n’était pas nécessaire à ce moment-là, et nous avons cherché à rendre l’écoute du spectateur plus aisée. Il n’était pas essentiel de cultiver un flou sur cette voix au début. Dans tous les cas, au moment où j’écris la pièce, ou quand je la joue, savoir si c’est ou non une voix masculine n'est pas ma première question.
CG : Comment avez-vous abordé la scène de viol du personnage de Molly ? Votre pièce fait en effet étalage d’un grand nombre de fluides (le sperme, les excréments avec la scène de Woody Allen), pourtant vous choisissez de laisser la scène vide à ce moment-là. Quel a été votre cheminement pour raconter ce moment central du film ?
MS : Effectivement, nous nous sommes beaucoup interrogés sur le traitement de cette scène, qui est tout à fait à part dans le film. Quand nous organisons des projections du film avant ou après la pièce, c’est la scène dont tout le monde vient nous parler à la fin, tant elle est marquante. C’est véritablement la scène qui rend le film intéressant, en offrant un tel contrepoint par rapport à la narration qui s’est déroulée jusqu’alors. Nous ne savions pas vraiment comment traiter le personnage de Molly, pour lequel nous avons travaillé plusieurs propositions. Il nous a fallu faire des choix par rapport aux personnages du film, ainsi nous avons retiré le personnage de James Smith, qui travaille comme videur dans le Holbank Pinks Club où Nomi et Molly vont danser, avant d’exercer d’autres emplois. C’est la chanson composée par Rebeka Warrior qui nous a guidés pour cette scène. Nous lui avions envoyé un grand nombre de notes, et elle a choisi de partir de « La veuve joyeuse » de Franz Lehár qui est la musique dans Oh les beaux jours pour composer sur ce moment.
Sur scène, nous étions partis de l’idée du viol du volcan. Initialement, le lustre-phallus (ou le « phallustre », dans notre jargon) descendait vers le volcan et faisait de brusques va-et-vient. Exactement comme dans le film de Verhoeven pour cette scène, tu te retrouves tout à coup face à une image que tu n'as pas envie de voir. Cependant, au théâtre St-Gervais en Suisse où nous avons fait la première de la pièce, les perches étaient manuelles, ce qui était beaucoup plus difficile à manipuler pour rendre l’effet voulu. Le régisseur du lieu nous a fait remarquer qu’il était possible de faire quelque chose d’autre dans l’interaction lustre/volcan, qui soit un peu moins premier degré. J’aimais beaucoup l’image initiale, qui était plus frappante, mais cette modification a également amené quelque chose de plus subtil, qui donne une autre couleur à la scène. C’est devenu un passage moins percutant qu’avec les perches mécaniques à Nanterre, qui propose un autre regard sur cette scène cruciale.
CG : Toujours pour faire le lien avec cette idée d’une histoire qui n’est pas simplement celle de Nomi Malone et d’Elizabeth Berkley, mais celle de tant d’actrices broyées par le système, il me semble que le film dépasse le seul horizon de l’opposition femme/patriarcat pour interroger plus en profondeur l’oppositions entre dominants et dominés selon des critères de genre, de classe, de race. La lisibilité des rapports de force à l’écran passe par un agencement inouï des corps dans le cadre, c’est dans la disposition des corps que se lit la compétition par exemple, ou la complicité de classe (comme c’est le cas dans la scène de Nomi et Al après son admission au Stardust). Comment avez-vous travaillé ces différentes problématiques ? Quelle a été la réflexion derrière la répartition des personnages, puisque vous jouez aussi bien Nomi Malone que Tony Moss, et Jonathan aussi bien Cristal Connors qu’un personnage masculin ?
MS : Oui, Showgirls est véritablement un film sur la lutte des classes, et c’est très présent dans notre pièce, par exemple avec les paroles dans la musique de Rebeka Warrior qui parle de « la lutte des classes à Las Vegas ». Cette scène est d’ailleurs tout à fait frappante. De mon côté, j’ai pu jouer également un grand nombre de personnages masculins comme Louis II de Bavière par exemple. Selon moi, genrer les personnages n’a aucun intérêt, et la répartition que nous avons choisie entre eux est tout à fait fonctionnelle. C’est également la magie du théâtre : il te suffit de rentrer sur scène en disant « Bonjour, je suis Hamlet », et tu es Hamlet.
La pièce a d’abord été construite comme un seul en scène, où j’incarnais tous les personnages, et Jonathan n’était pas présent avec moi sur scène. Avec le décor, nous avions décidé de faire sortir Nomi du volcan, il fallait donc une personne invisible pour bouger les différents éléments. C’est à ce moment là que nous est venu l’idée d’intégrer le personnage d’un régisseur, qui s’est fait une chirurgie esthétique – donc pas l’actrice, comme on pourrait l’attendre, mais bien le régisseur, ce que nous trouvions hilarant. Mais dans la pièce, c’est bien Murray qui joue Cristal qui est représenté, et non Cristal.
CG : À ce propos, pensez-vous que l'histoire de Nomi est davantage le combat d'un corps ou bien est que tout est affaire de regard, dans l'abstraction qui évide un corps féminin ? Étant donné que votre voix embrasse une pluralité de points de vue, celui de Nomi, d’Elizabeth Berkley et le vôtre, avez-vous cherché à mettre en corps et en scène non pas le film mais l’état intérieur de Nomi, ou plus généralement, un point de vue féminin ?
MS : Face à la pièce, il est impossible de savoir véritablement si c’est Nomi, Elizabeth ou moi qui parle. Nous avons laissé ce flou à dessein, car dans tous les cas, le personnage de Nomi n’existe pas, et nous ne savons pas ce qu’Elizabeth a ressenti pendant ce tournage. Il n’est pas nécessaire de clarifier cela pour que l’on s’attache à ce qui se déroule sous nos yeux.
CG : Enfin, pour terminer, une dernière question plus générale qui adresse plus directement les thématiques que nous abordons dans ce numéro de notre revue : le théâtre est-il selon vous plus apte à transmettre une sensorialité et/ou sensualité des corps que le cinéma ? En effet, au début, votre personnage réagit à une voix qui lui fait remarquer qu’elle en fait trop : est-ce une question qui s’est posée dans l’évolution de la pièce ?
MS : C’est quelque chose qui a été reproché à Elizabeth Berkley alors qu’elle fait précisément ce qu’on lui demandait. Verhoeven souhaitait qu’elle joue de manière expressionniste, en s’inspirant d’Ivan le Terrible d’Eisenstein, et c’est exactement ce qu’elle a fait. Une actrice qui en fait trop c’est insupportable, alors qu’un acteur qui en fait trop peut plus facilement passer. Ce sont des choses que j’ai pu ressentir moi-même dans mon métier : dès que tu es un peu en dehors des normes, et que tu parles trop fort par exemple, c’est remarqué, en bien ou en mal. Ce n’est jamais le cas pour un acteur. En faire trop, c’est un choix de ma part.
C’est pour cela que je suis très heureuse d’évoluer dans un milieu théâtral où ces choses-là sont permises, voire encouragées. Dans le théâtre de base, les actrices cherchent à ne pas en faire trop, pour ne pas devenir « kitsch » comme nous l’évoquions plus tôt. Si tu en fais trop, tu es tout de suite cataloguée dans un style. Mais « en faire trop », c’est toujours par rapport à quelque chose, et il intéressant d’examiner ces normes, ce référentiel. C’est aussi c’est que le théâtre nous permet d’explorer.
CG : Pour finir, souhaitez-vous évoquer la pièce sur laquelle vous êtes en train de travailler, puisque vous êtes actuellement en résidence d’écriture ?
MS : En ce moment, nous travaillons sur une pièce intitulée Les chats ou ceux qui frappent et ceux qui sont frappés, avec onze interprètes dont nous faisons partie, et nous en sommes à la phase d’écriture. La pièce va être chantée du début à la fin, et nous travaillons à nouveau avec Laurent Durupt pour la musique, Laurent Mercier, et Jean Biche pour les costumes. C’est une pièce qui parle de dix personnes enfermées ensemble, de leur plein gré, tous et toutes interprètes de comédies musicales des années 80. Elles glosent sur l’effondrement, l’écologie, la fin du monde, comment faire pour s’en sortir… La pièce évoque des sujets variés, de l’économie, de la politique, du capitalisme.