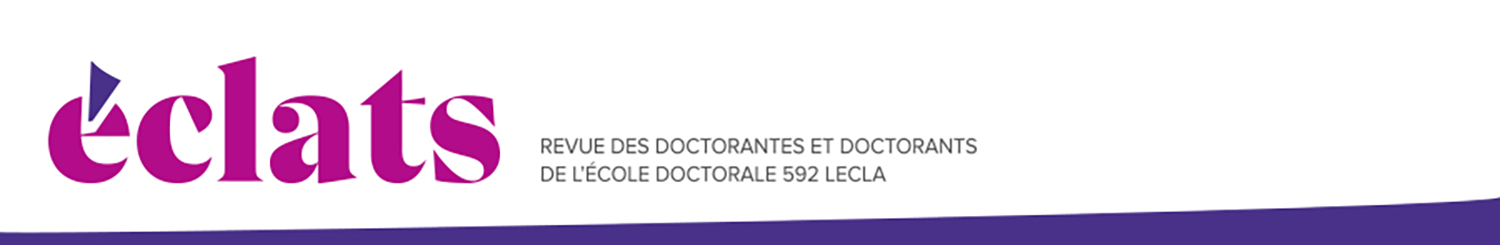De novembre 2015 à janvier 2021, j'ai été doctorante en traductologie à l’ESIT (École supérieure d’Interprètes et Traducteurs). Les recherches menées sous la direction de Mme Isabelle Collombat s’inscrivent dans le champ encore émergeant en France de la recherche‑création et l’intitulé de ma thèse est « La défamiliarisation d’une langue à l’autre : traduire la voix de l’enfant narrateur en français1 ».
Le cheminement au terme duquel je me suis inscrite en doctorat de traductologie a le caractère sinueux de la dialectique. Commençons par l’anti‑thèse, car j’ai toujours aimé jouer avec les mots. Il y a près de vingt ans, au terme d’études d’anglais qui me destinaient plutôt à la recherche, j’ai choisi de me tourner vers la traduction. La traduction littéraire m’attirait parce que j’y voyais une forme d’écriture créative qui demande aussi – peut‑être même avant tout – des qualités d’analyse et de rigueur. C’était aussi pour moi une façon différente de ressentir et d’éprouver des textes littéraires, plus intense et plus active que la lecture, une expérience que j’avais faite en m’entraînant à la version pour préparer des concours, et que je souhaitais vivre au long cours. Si j’ai alors tourné le dos à la possibilité de me lancer dans un doctorat, je n’ai cependant pas voulu me former « sur le tas » à la tâche du traducteur. Voilà pourquoi je me suis inscrite en DESS de Traduction littéraire professionnelle à l’Institut Charles V de l’université de Jussieu. Il me semblait important de donner une assise théorique à la pratique du métier que j’envisageais, mais aussi de bénéficier des conseils et du retour d’expérience des traductrices et de traducteurs littéraires professionnels qui assuraient cette formation aux côtés d’enseignants‑chercheurs2.
La décision de me lancer dans la recherche en traductologie est née des années plus tard de ma pratique de traductrice. C’est l’expérience concrète du métier qui m’a donné envie de développer une réflexion théorique et critique sur la traduction comme pratique culturelle, artistique et professionnelle. Parmi les traductions qui m’ont été commandées, certaines plus que d’autres m’ont amenée à réfléchir de façon conscientisée à ce qu’est l’opération traductive, à ce que fait le texte et à ce qu’on en fait, en écho, lorsqu’on le restitue en français. Il y a d’abord eu, avec L’Opale du désert3, de Janette Turner Hospital, et les Sautes d’humour de Jane Austen, la problématique de la traduction des citations – enchâssées dans un texte ou rassemblées en recueils. Plus tard, deux expériences de traduction particulièrement fortes ont cristallisé mon désir de me consacrer à la recherche : il s’agit de deux romans écrits – pour tout ou partie – selon le point de vue et avec les mots d’un narrateur enfant, alors qu’ils sont destinés à des lecteurs adultes.
Je me suis donc inscrite en Master 2 Recherche à l’ESIT en 2014‑2015 : je pensais qu’une école formant avant tout des praticiens de la traduction et de l’interprétation (pour ensuite les encourager à mener une réflexion plus théorique en M2 Recherche et en doctorat s’ils le souhaitent) offrirait une équipe d’accueil adaptée pour une doctorante qui avait d’abord été traductrice. Cette attente n’a pas été déçue ; à l’ESIT, Mme Isabelle Collombat, qui enseignait auparavant au Québec, encadre volontiers des doctorants qui se proposent de travailler en recherche‑création. Ce type de recherche s’est développé dans le monde anglo‑saxon, notamment dans le domaine des études théâtrales, littéraires et journalistiques. En revanche, c’est un champ encore émergeant dans les universités françaises pour ce qui concerne la traductologie.
J’espère que mon témoignage contribuera à tracer les contours encore flous de ce que peut être un doctorat en traductologie qui s’inscrit dans la mouvance de la recherche‑création. En effet, je conçois mon travail de recherche comme une synthèse dynamique entre théorie et pratique, un mouvement réflexif qui passe par plusieurs allers‑retours analytiques et critiques entre ces deux pôles, puisque la doctorante que j'étais restée, en parallèle, une traductrice.
Je vais donc présenter mon projet de thèse, aborder les questions de recherche qu’il soulève, et, enfin, décrire la méthodologie envisagée au stade initial de mon travail doctoral pour donner toute sa validité heuristique à cette recherche doctorale qui s’appuie sur ma propre pratique professionnelle.
Afin d’analyser les enjeux soulevés par la traduction d’anglais en français de textes romanesques écrits selon la technique narrative de la focalisation interne et qui ont pour narrateurs de jeunes enfants, j’ai choisi plusieurs romans contemporains et leurs traductions. Deux de ces traductions m’ont été commandées par les éditions Stock :
- Room, d’Emma Donoghue, Londres, Picador ; Toronto, Harper Collins, Canada ; New-York, Little Brown, 2010 ; Room, Emma Donoghue, Paris, Stock, 2011 ;
- Rock in the Belly, de Jon Bauer, Melbourne & Londres, Scribe, 2012 ; Des Cailloux dans le ventre, de Jon Bauer, Paris, Stock, 2012.
Room est le septième roman d’Emma Donoghue, écrivain et historienne irlandaise installée au Canada. C’est le récit fictif de Jack, né en captivité avec sa mère et retenu pendant plusieurs années par son ravisseur dans l’unique pièce d’un abri de jardin. Son évasion et la découverte du monde extérieur y sont également racontées dans une langue fortement marquée par le parler enfantin et l’étrange idiolecte d’un jeune garçon qui a vécu coupé du monde extérieur.
Rocks in the Belly est le premier roman de Jon Bauer, un écrivain britannique qui vivait en Australie au moment de la parution du livre. Le texte fait alterner deux époques : celle où le jeune adulte revient dans sa petite ville natale anglaise auprès de sa mère malade, et, vingt ans plus tôt, celle où ce même narrateur, âgé de huit ans, raconte comment l’arrivée de Robert – un garçon placé dans sa famille par les services sociaux – bouleverse l’équilibre familial d’une façon qui lui est insupportable.
Les deux romans sont destinés à des adultes, mais ils donnent à entendre les voix d’enfants. Ces voix ne sont pas uniquement restituées dans les dialogues, elles racontent l’histoire des jeunes protagonistes. Il s’agit donc d’analyser les spécificités et la singularité des voix narratives homodiégétiques par le biais desquelles Emma Donoghue et Jon Bauer présentent le regard d’un enfant sur le monde qui l’entoure, construisent sa représentation du monde et, en même temps, le récit romanesque.
Le passage au français soulève, à mon sens, la question de la recréation de ce « style mental » ou mind style4. Tout d’abord, la langue enfantine des deux jeunes narrateurs est empreinte d’une oralité fictive puisqu’elle est écrite et non transcrite. C’est un artéfact linguistique : quelles sont ses composantes lexicales, syntaxiques et discursives ? Pour la traductrice, comment trouver le ton juste, rendre la qualité émotionnelle propre à la parole enfantine ? Comment recréer l’effet défamiliarisant que produit sur le lecteur adulte une vision du monde qui lui est devenue étrangère avec le temps et la maturité ?
Dans leur analyse de ce qui constitue le style littéraire et le mind style, Leech et Short s’inscrivent dans la droite lignée du Cercle linguistique de Prague : ils recourent à des notions très proches du concept de défamiliarisation que l’on doit aux formalistes russes.
The Prague School of poetics has distinguished the “poetic function” of language by its FOREGROUNDING or DE-AUTOMIZATION of the linguistic code. This means that the aesthetic exploitation of language takes the form of surprising a reader into a fresh awareness of, and sensitivity to, the linguistic medium which is normally taken for granted as an “automatized” background of communication. (Leech & Short, 1981, p. 28)
Cette conception du style en littérature de façon générale et le mind style en particulier visent donc à défamiliariser le lecteur, pour reprendre le terme que l’on doit au formaliste Viktor Chklovski.
Selon Chklovski, « le procédé de l’art […] consiste à obscurcir la forme, à augmenter la difficulté et la durée de la perception », ce qui a pour effet d’engendrer un sentiment d’étrangeté (ostranenie, en russe) ; « le caractère esthétique se révèle toujours par les mêmes signes : il est créé consciemment pour libérer la perception de l’automatisme5 ». À la suite de Chklovsky, Leech et Short, décrivent le style littéraire comme « opaque ». Quels sont les enjeux et les défis traductifs qui découlent d’une telle conception du style ? La restitution d’un style défamiliarisant m’apparaît a priori comme un prolongement naturel de l’acte traductif, dans la mesure où la traduction vise à introduire l’étranger dans la langue et où le texte traduit est une fenêtre ouverte sur l’altérité. Cependant, l’opacité du style littéraire en général et le rendu du style enfantin en particulier soulèvent, entre autres, la question de la lisibilité du texte traduit. En tant que traductrice professionnelle, j’ai souvent reçu pour consigne d’écrire un texte fluide, qui ne présente pas d’aspérités et ne heurte pas la sensibilité ou l’horizon d’attente des lecteurs. Pourtant, dans ce cas précis, la gageure consistait à recréer un parler enfantin à la fois suffisamment authentique pour susciter l’adhésion du lecteur et assez défamiliarisant pour rester en adéquation avec le parti‑pris esthétique et discursif du texte source.
L’ajout d’un troisième roman et de sa traduction française à mon corpus m'a permis vraisemblablement d’aborder avec un plus grand recul analytique et critique des problématiques comparables à celles que posent les deux premiers récits. C'est pourquoi j'ai décidé d’ajouter à mon corpus, Pigeon English, premier roman de l’écrivain britannique Stephen Kellman (2010, Bloomsbury) et Le Pigeon anglais (Gallimard, 2011). Madame Collombat, ma directrice de recherche, m’a, elle aussi, encouragée à confronter mes premières conclusions à l’expérience d’un autre professionnel par le biais d’un entretien avec Nicolas Richard, le traducteur de ce roman.
Harrison, le narrateur ghanéen de Pigeon English, a onze ans et vient d’arriver en Angleterre. Il habite dans un quartier défavorisé proche de Londres. Comme le titre du roman l’indique, sa langue enfantine est créolisée (pidgin English) ; elle est aussi mâtinée de l’« argot des cités » qu’il assimile très vite. L’élargissement de mon corpus donne une dimension postcoloniale à ma recherche et soulève au moins deux questions supplémentaires :
- la langue enfantine est‑elle comparable à un sociolecte hybride, une langue métissée qui serait uniquement parlée par les enfants et vouée à céder progressivement la place à la langue plus normée des adultes ?
- À quels défis particuliers le traducteur a‑t‑il été confronté face à un parler « ethnicisé » et argotique et quelles stratégies a‑t‑il adoptées ?
Au terme d’une analyse stylistique et comparative approfondie de ces trois romans et de leurs traductions, l’entretien que je prévoyais de mener avec Nicolas Richard et ma propre expérience, associée à des lectures traductologiques, devaient me permettre d’apporter des éléments de réponse probants aux questions de recherches soulevées dans ce témoignage. La visée d’une recherche‑création en traductologie menée par une praticienne de la traduction avec un corpus qui soulève la question de la traduction comme re‑création me semble correspondre à l’objectif à la fois modeste et ambitieux que George Steiner assigne à une traductologie appliquée aux textes littéraires dans Après Babel, une poétique du dire et de la traduction :
Il n’y a pas de « théories de la traduction ». Ce dont nous disposons, ce sont des descriptions raisonnées des démarches. Au mieux, ce que nous trouvons et cherchons ensuite à énoncer, ce sont des narrations de l’expérience vécue, des notations heuristiques ou exemplaires de travail en chantier (work in progress). (Steiner, 1998, p. 21)
Pour autant, faut‑il affirmer avec lui :
Celles‑ci n’ont aucune valeur scientifique. Nos instruments de perception ne sont pas des théories ni des hypothèses de travail en un sens scientifique, autrement dit falsifiable, mais ce que j’appelle des « métaphores de travail » ? (Steiner, 1998, p. 21)