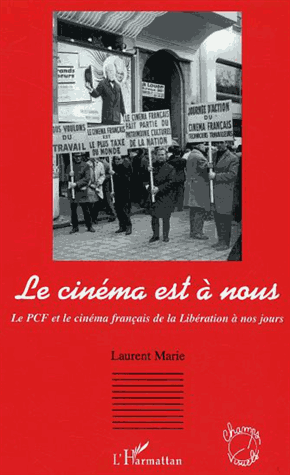En détournant le titre du film de Jean Renoir de 1936, La vie est à nous, l’historien Laurent Marie place d’emblée son ouvrage dans une double filiation, celle du communisme (parents militants et passage dans les rangs des Jeunesses communistes pour lui-même) et celle des salles obscures, délaissées par ses parents par manque de temps mais qu’il fréquenta, lui, assidûment. Cet ouvrage est issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2000, ce qui semble plutôt banal dans le monde des éditions publiant des travaux universitaires, sauf qu’à l’origine cette thèse fut rédigée en anglais et soutenue à l’Université de Warwick (Coventry, Royaume-Uni), puis ensuite traduite en français, et là, de la part d’un Français, c’est déjà plus inhabituel ! Egalement inhabituel est le fait de prendre les rapports entre le communisme et le cinéma comme « interlocuteur principal » d’une recherche, même si quelques balises jalonnent déjà ce domaine, articles ou communications, d’ailleurs, plus souvent que travaux de synthèse. On se bornera ici à citer, puisque ce n’est pas notre propos de tracer un bilan historiographique de ce champ d’études, quelques recherches comme par exemple celles de Tangui Perron qui intègrent les productions communistes dans l’ensemble plus vaste du « cinéma ouvrier » ou du « cinéma militant », celles sur les réalisateurs Louis Daquin, Jean-Paul Le Chanois ou sur le longtemps censuré et occulté Paul Carpita, de Olivier Barrot sur L'Écran français, revue de cinéma liée au Parti communiste, de Patricia Hubert-Lacombe sur les répercussions de la guerre froide dans le cinéma français, sans omettre les différentes interprétations à propos des fameux accords Blum-Byrnes du 28 mai 1946, prémices d’une guerre froide culturelle en gestation. A travers une approche chronologico-thématique, Laurent Marie se charge de « mettre en lumière le rapport dialectique entre politique et critique cinématographiques » (p. 11) de la Libération – moment où le Parti communiste, force politique incontournable, décide de surveiller très scrupuleusement et très jalousement le cinéma hexagonal – à nos jours, alors que ce même parti se retrouve quasi marginalisé, du moins sur le plan électoral. Trois axes structurent donc cette approche: Quel est le type de cinéma préconisé et privilégié par le Parti ? Quelle est l’évolution idéologique des positions de la critique cinématographique ? Que ressort-il de la confrontation entre les deux discours, politiques et cinématographiques ? Ont été écartés de la recherche de Laurent Marie les productions cinématographiques du Parti communiste ainsi que les représentations du communisme par le cinéma: avis à de futurs chercheurs ! Les sources utilisées sont, outre les différents organes de presse du Parti qui répercutent les décisions des dirigeants et qui impulsent toutes les campagnes idéologiques – en tenant compte toutefois du fait que L’Humanité ne possède pas les mêmes fonctions que France nouvelle ou bien sûr L’Ecran français –, les archives de la direction du PCF, ainsi que des archives privées, comme par exemple celles de Georges Sadoul, Jean-Paul Le Chanois ou Gérard Philippe.
Né à la toute fin du XIXe siècle, le cinématographe, devenu, à l’époque du capitalisme hégémonique, tout à la fois un « art » (le 7e suivant la formule consacrée), une industrie culturelle, un média de masse et donc un puissant vecteur idéologique, ne pouvait pas ne pas être l’objet d’une certaine attention de la part d’organisations révolutionnaires. Même si sa fonction propagandiste ne fut pas si aisée à être acceptée, d’une part, puis à se mettre en place, d’autre part, la révolution bolchevique en 1917 en Russie – référence commune à plusieurs générations de militants marxistes, orthodoxes ou dissidents – contribua fortement à le faire admettre, et pas seulement parce que Lénine aurait prophétisé que « de tous les arts, le plus important (…) c’est l’art cinématographique ». Délaissant la période de l’entre-deux-guerres, encore insuffisamment propice à ses yeux pour une mise en perspective satisfaisante du communisme français et des productions nationales, Laurent Marie s’attache donc dans cet ouvrage à retracer tous les épisodes majeurs de cette histoire, privilégiant néanmoins les années de la Libération et de la guerre froide, sans pour autant négliger, bien sûr les décennies suivantes. En effet, sur les dix chapitres que compte cette étude, il s’en trouve quatre (de la page 17 aux pages 133, soit environ 1/3 du total) qui traitent des différents événements attachés à la décennie des « galopantes années cinquante », pour reprendre ici l’expression de Dominique Desanti. Il est vrai qu’entre l’épuration, la bataille pour un cinéma français indépendant et le contrôle de ses structures, la lutte contre les accords Blum-Byrnes avec le Comité de défense du cinéma français (fondé le 19 décembre 1947 par la CGT et le PCF), les campagnes contre la « domestication des écrans » français par les Etats-Unis et contre la « chasse aux Rouges » à Hollywood, avec, en contre point, l’éloge appuyé au cinéma soviétique mais également à certaines productions réalistes socialistes à la française (ou à l’italienne), ces dix petites années furent plutôt bien remplies ! Dès la Libération, le Parti communiste pose les bases de positions esthétiques qui seront les siennes pendant toute la guerre froide : le cinéma est partie prenante du « front culturel » et les communistes s’en font « les gardes du corps (…) en permanence sur le qui-vive » (p. 325). D’où la création, fin 1947 (le 4 novembre précisément) d’une section du cinéma au sein du Parti, décision prise lors d’une réunion du Secrétariat. Ensuite, l’abandon du jdanovisme, plus ou moins rapide selon les militants, conduit par exemple à des divergences profondes d’appréciation, qui transcendent les générations militantes. Ainsi, alors que des « anciens » comme Sadoul ou des « jeunes » comme Cervoni saluent la Nouvelle Vague au début des années 60, d’autres voix communistes, mêlant également « anciens » (Daquin, Marcenac) et « jeunes » (par exemple le réalisateur Marcel Bluwal ou Philippe Esnault des Lettres françaises), fustigent un cinéma réactionnaire, individualiste, voire égocentrique, pur reflet selon eux d’un « désarroi réel des élites bourgeoises » (p. 165). Pourtant, selon Laurent Marie, les « velléités d’indépendance affichées par Sadoul, Cervoni et d’autres annoncent les discussions d’Argenteuil de mars 1966 [un Comité central se réunit les 11, 12 et 13 mars 1966 pour mettre au clair la philosophie politique du Parti] où seront revues les positions du Parti sur les intellectuels et les artistes » (p. 176). Pourtant, en souhaitant à la fois jeter le jdanovisme aux orties, tel un prêtre défroqué sa soutane, et ne pas « désespérer les masses », le Parti communiste court le risque, dans ce grand écart idéologique, de « se faire le défenseur de productions dont le contenu idéologique est inexistant » (p. 232). Lorsque les critiques de L’Humanité saluent des films tels Le corniaud, La grande vadrouille ou la série des Gendarmes aux prétextes qu’ils sont populaires, qu’ils distraient le public et donnent du travail aux techniciens et artistes français, Cervoni, dans France nouvelle, a beau jeu de monter au créneau pour dénoncer dans ces films la bêtise et la vulgarité des situations et des propos. Au risque de provoquer une réponse cinglante de la direction de l’hebdomadaire du Comité central, suivi d’une mise au point plus nuancée, suite à d’autres réactions favorables aux analyses de Cervoni. Ensuite, et en particulier dans les années 70, les communistes de La Nouvelle critique tentent un rapprochement avec d’autres revues marxistes, versant « gauchiste » fortement coloré de maoïsme, les Cahiers du cinéma et Cinéthique, autour de problématiques telles que celle-ci : Qu’est-ce qu’un film matérialiste ? Un film est-il une marchandise comme une autre, ou une marchandise à haute teneur idéologique ? N’oublions pas, ou rappelons-le, que les théories d’Althusser sur les Appareils idéologiques d’Etat sont alors dans bien des têtes.
Les décennies suivantes, qui voient à la fois l’amorce du déclin du PCF, le recul ou la disparition d’organisations d’extrême gauche ainsi que la mise au rencart de débats considérés au mieux comme obsolètes et au pire comme afféteries criminogènes, ne peuvent que laisser s’épanouir, sur un tel champ de ruines, ces trop fameuses campagnes pour l’exception culturelle. Un tel « consensus inquiétant » (p. 278) n’est-il pas la traduction ultime, pour le PCF, de l’abandon progressif d’un système de références communistes ? Laurent Marie semble le penser lorsqu’il conclut que le Parti communiste, en refusant de présenter des « dogmes culturels » et de « mêler l’art à l’idéologie » – sauf pendant la période « stalinienne » du jdanovisme triomphant, ce qu’on ne cessa de lui reprocher, de l’extérieur, et qu’il ne cessa de tenter d’expier, à l’intérieur – a « très tôt abdiqué son essence révolutionnaire » (p. 328). Rappelons toutefois que la défense acharnée d’un cinéma français comme rempart à la « colonisation yankee », dans ces années de guerre froide, même insérée dans une problématique anti-américaine de lutte de classes, ne pouvait que laisser de trop nationalistes traces…En reconnaissant que « le pouvoir du cinéma est immense » (Lounatcharski), le Parti communiste français a tenté, à travers les heurs et malheurs de la lutte de classes – se traduisant par une sorte de va et vient, voire parfois d’imbrications sournoises, entre deux conceptions de l’objet « cinéma », la première accordant la primauté à la technique (nationalisons ! vulgarisons !), la seconde à l’idéologie (déconstruisons !) – de maîtriser ce pouvoir. L’ouvrage de Laurent Marie, centré sur une période cruciale pour le PCF, aide à y voir un peu plus clair. Souhaitons que ses prochains travaux précisent et élargissent cette perspective, et contribuent à corriger le constat pessimiste de Laird Boswell sur les « impasses de l’historiographie du communisme français ». Et souhaitons surtout que ce type de recherches soit appliqué aux organisations d’extrême gauche par de futurs doctorants en histoire culturelle.