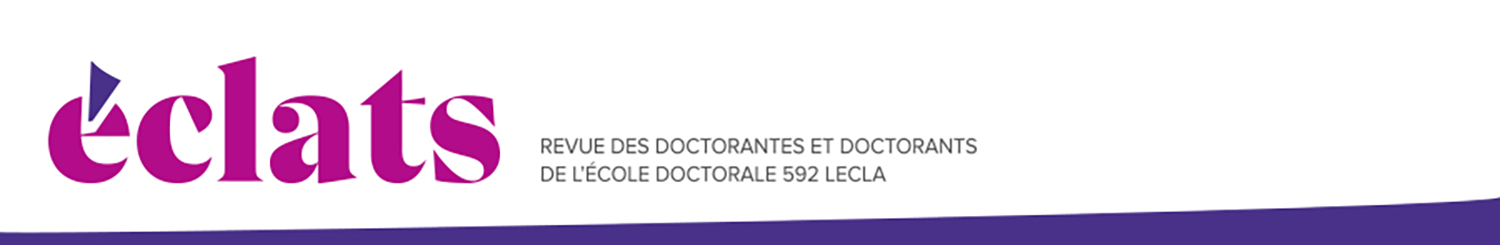C’est à la MSHE que se déroule depuis la rentrée 2023 le séminaire « Mettre en œuvre, donner forme », organisé par Laetitia Ogorzelec-Guinchard (PR de sociologie, LaSA) et Pascal Lécroart (PR de Langue et Littérature française, ELLIADD). Ce séminaire propose une réflexion pluri et transdisciplinaire autour des processus de création et de réception aussi bien scientifiques qu’artistiques. Il articule deux grands axes de réflexion : « Mettre en œuvre » envisage l’œuvre non pas comme une totalité close, mais bien comme une production culturelle, prise dans un devenir pluriel tant au niveau de sa création qu’au niveau de sa réception. L’hybridité constitutive de l’œuvre dans sa genèse, et la pluralité de ses modalités de réception (musée, lectures, adaptations, etc.) seront abordés aussi bien du point de vue des brouillons d’auteurs (Laurence Dahan-Gaida, 1re séance) que de celui des réceptions spectatoriales (chez François Royet, 3e séance) ou lectoriales (Axelle Grégoire, 2e séance). Le deuxième axe, « Donner forme », s’intéresse aussi bien au résultat de ces productions qu’à leurs mises en forme possibles : si l’œuvre est envisagée comme un objet vivant, il s’agit de s’y rapporter à partir des ressources mobilisées pour leur donner vie. La recherche artistique et scientifique ne produit pas uniquement des objets mais bien un archipel de formes qui permet aussi bien de structurer la pensée que de produire de nouveaux savoirs et de nouveaux regards. Au sein du séminaire, cet axe examine des manières de transmettre une expérience du monde qui prend forme dans les arbres de connaissance de Laurence Dahan-Gaida, dans les cartes d’Axelle Grégoire ou encore dans le travail cinématographique documentaire de François Royet. Cette attention aux formes nous guide vers un apprentissage d’une sensibilité particulière (sensibilité écologique dans le rapport aux sols, ou éthique et esthétique dans un documentaire engagé par exemple), soucieuse de ce qui modèle la pensée dans sa genèse comme dans sa réception. Les cartes ou les diagrammes sont autant d’objets qui font signe vers des espaces d’expérimentations dont les outils, loin d’être neutres ou transparents, façonnent un regard et entrainent à leur suite un ensemble de gestes propres à opérer une saisie particulière du monde qui nous entoure.
Laurence Dahan-Gaida : « Donner forme à la pensée naissante. Diagrammes et images de pensée » (12 octobre 2023)
La première séance de ce séminaire « Donner forme à la pensée naissante. Diagrammes et images de pensée » a été présentée par Laurence Dahan-Gaida le 12 octobre 2023. Professeure des Universités et spécialiste en épistémocritique et en diagrammatologie, Laurence Dahan Gaida y a proposé un ensemble de réflexions sur plusieurs formes d’expression graphique incluant l’écriture, les inscriptions, les listes, les schémas, les arbres et les diagrammes. Le point de départ de sa recherche est celui de Paul Valéry qui dans ses brouillons s’attache à saisir le stade à partir duquel les notations sont possibles, au niveau de l’informulé. Dans son Introduction à la méthode de Léonard de Vinci rédigée entre 1894 et 1919, Valéry développe l’idée que les sciences et les arts se rapprochent dans leur manière de saisir leurs objets pour ne se distinguer qu’au moment de leur expression, par un système de notation particulier (écriture, équations, formules, graphiques, etc.). Laurence Dahan-Gaida s’intéresse plus particulièrement à l’une de ces formes : le diagramme. Forme provisoire de la pensée qui se cherche, le diagramme développe une pratique de condensation et d’amplification de l’intuition. Dans son dernier ouvrage L’art du diagramme publié en 2023 aux Presses Universitaires de Vincennes, Laurence Dahan-Gaida revient sur les caractéristiques de cet objet complexe saisi aussi bien par des sémioticiens comme Charles Sanders Peirce que par des mathématiciens ou des philosophes comme Gilles Châtelet. Le diagramme propose une synthèse visuelle et spatiale qui permet une saisie synoptique et immédiate de son objet, souvent envisagée en contraste avec l’ordre logico-syntaxique du langage. Dans une perspective peircienne, il appartient à la catégorie des « icônes » (par opposition aux « symboles » et aux « indices ») en ce qu’il entretient une relation iconique avec l’objet représenté. Cette iconicité n’est pas celle d’une ressemblance sensible, mais celle d’une relation analogique, d’un lien abstrait ou structurel qui établit des liens d’identité partiels ou imparfaits. C’est justement dans cet interstice que quelque chose de nouveau peut être dit, qu’une nouvelle idée peut germer. Visualiser, en passant par le diagramme, ce n’est donc pas voir quelque chose qui existe, mais faire voir ce qui n’existait pas avant : le diagramme ne reproduit pas l’objet mais le construit par son tracé en formulant une hypothèse à son encontre. Pour le dire autrement, le diagramme permet de voir plus pour penser plus, il vise donc à une efficacité et doit être envisagé comme un système générateur.
La diagrammatologie s’emploie donc à analyser ces images opératoires qui constituent selon Jack Goody des technologies de l’intellect. Dans une perspective philographique et à la suite de la chercheuse Sybille Krämer, il devient possible d’appréhender l’écriture elle-même comme relevant d’une diagrammatique, dans ses gestes de scription, dans la matérialité de son tracé, au travers par exemple de l’étude des brouillons d’auteurs. C’est ce que nous propose Laurence Dahan-Gaida en parcourant une série d’objets à la loupe d’un regard diagrammatique : les carnets d’écrivains qui saisissent une pensée en train de naitre, l’écriture en tant que graphie dans la poésie visuelle (les calligrammes, les idéogrammes, etc.), les diagrammes arborescents qui cherchent à classer et à ordonner le réel, les diagrammes linéaires qui prennent pour base la ligne (aussi bien celle du dessin que celle de l’écriture), et enfin les diagrammes qui relèvent de la cartographie. C’est sur la troisième catégorie, celles des arbres, que s’est concentrée la deuxième partie de son intervention.
D’un point de vue diagrammatique, les arbres disposent en effet d’une variété fonctionnelle et figurative : ils présentent des qualités heuristiques et taxinomiques, ils suggèrent des propositions d’organisation topologique du savoir, ils disposent également d’une valeur symbolique qui les rend aptes à figurer une mémoire culturelle. Ce sont à la fois des outils mnémotechniques, organisationnels, et capables de penser les liens et les articulations sous un prisme hiérarchique (raison pour laquelle Deleuze et Guattari leur préfèreront le modèle du rhizome). Laurence Dahan-Gaida distingue les arbres de vie, dont l’organisation topographique met en exergue la singularisation des espèces et des êtres tout en pensant leurs liens, des arbres de la connaissance qui embrassent d’un geste commun les sciences et les arts. Parmi ceux-ci, elle développe l’exemple de l’arbre de Porphyre pour montrer comment il fonctionne comme une image synoptique, globale, qui introduit des divisions dichotomiques et établit des liens. Le philosophe néoplatonicien Porphyre qui l’invente au IIIe siècle le construit de la manière suivante : la colonne centrale, analogue au tronc, présente le genre le plus haut, celui de la catégorie, à partir duquel apparaissent deux colonnes de subdivisions à droite et à gauche, qui dessinent les différences, à la manière des branches d’un arbre. Ce système de classification est avant tout un système de subordination, qui place des espèces sous un genre supérieur que constitue le tronc de l’arbre. À partir de plusieurs exemples d’arbres de la connaissance (Lulle, Boèce, Descartes, Diderot et d’Alembert, etc.), Laurence Dahan-Gaida interroge les formes d’organisation du savoir, leurs modalités d’articulations des connaissances (statique/dynamique, horizontal/vertical, synthétique qui permet de saisir des totalités/en principe infini, etc.), leur capacité à montrer une continuité des savoirs et un tronc commun entre sciences et humanités, mais aussi, le risque possible de substituer à la dynamique de l’évolution portée par l’arbre sa structure prise comme substance. Elle applique ensuite ce modèle de l’arbre aux arbres généalogiques intégrés ou façonnés par des œuvres littéraires, à la manière de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. L’arbre permet ici de distinguer différents types de filiations possibles dans l’œuvre (naturelle, adoptive, légitime, incestueuse). L’arbre généalogique dans les sagas familiales modélise aussi la narration, montrant ainsi comment une forme de l’histoire naturelle offre à la fiction un double modèle de linéarité et de totalisation.
Cette séance inaugurale aura eu le mérite de poser un certain nombre des enjeux principaux de ce séminaire, en traversant des productions tant scientifiques qu’artistiques, envisagées non pas comme des objets finis mais bien dans leur processus d’élaboration. Les discussions qui s’en sont suivies témoignent bien de la multiplicité des terrains d’étude sur lesquels peuvent se déployer de telles réflexions : sciences cognitives, anthropologie des mathématiques ou encore les travaux de Lévi-Strauss sur le sorcier et sa magie.
Axelle Grégoire : « Terra Forma : retour sur un projet de cartographies alternatives et expérimentales des écosystèmes territoriaux » (30 novembre 2023)
La deuxième séance de ce séminaire intitulée « Terra Forma : Retour sur un projet de cartographies alternatives et expérimentales des écosystèmes territoriaux » nous a permis de découvrir le travail d’Axelle Grégoire le 30 novembre 2023. Architecte de formation, Axelle Grégoire est l’une des autrices de l’ouvrage Terra Forma. Manuel de cartographies potentielles (éditions B42) dont elle nous a présenté les enjeux et la genèse d’un projet interdisciplinaire, au croisement des sciences et des arts. Comme le souligne très bien le titre, il s’agit d’un manuel qui propose un ensemble d’outils s’adressant aussi bien à des lecteurs qu’à des utilisateurs. Dans son introduction à la séance, Laetitia Ogorzelec-Guinchard (Pr de sociologie / LaSA), organisatrice du séminaire, nous explique que l’ensemble des cartes qu’il regroupe nous invite à redécouvrir autrement un environnement familier, à repenser les relations écologiques d’un territoire, et à s’interroger sur leur apparence qui déstabilise nos repères habituels. Les cartes de Terra Forma frappent aussi bien par la beauté que par l’originalité de leur tracé puisqu’elles adoptent une forme circulaire – ou plutôt spiralaire : c’est qu’il s’agit de renverser une vision zénithale du terrestre, et de trouver le moyen de se réoutiller conceptuellement pour le faire. Ce geste fondateur et inaugural est présenté dans le premier chapitre de l’ouvrage, qui se propose de développer une anamorphose qui renverse notre manière d’envisager l’espace : l’atmosphère se retrouve au centre, et se déploie autour des différents niveaux de sol jusqu’à ce que notre regard se trouve englobé et enfermé par le centre de la terre. L’ensemble de la démarche cherche à déployer ce nouveau point de vie (et non point de vue) incarné par le dessin, qui nous déplace de la surface vers l’intérieur de la représentation.
Terra Forma se propose donc de partir en quête d’une continuité des formes sans exprimer un rapport d’échelles – en témoignent également la disparition du fond de plan, et le choix chromatique d’une dualité noir/blanc. Inspiré par l’hypothèse Gaïa (toutes les entités fabriquent le terrestre), le projet cherche à penser l’espace non plus à partir d’un cadran d’échelle mais dans un système de continuum (si bien qu’un champignon et un volcan peuvent être représentés à la même taille). Ces choix à l’origine du tracé permettent de révéler un invisible qui est aussi un impensé : les sols. Axelle Grégoire rappelle la difficulté qu’il y a à dessiner les sols pour l’architecte urbain, par ignorance de ce qu’il s’y passe réellement : trop souvent, ceux-ci sont représentés ordonnés et rangés, là où les cartes de Terra Forma soulignent leur caractère chaotique par une dualité organisation/désorganisation volontairement mise en exergue. Le dessin montre bien qu’on se situe dans une sorte d’artefact naturel coconstruit, et la réflexion autour de la hiérarchisation inhérente à toute légende rappelle cet incessant rapport entre organismes habitants et hébergés. L’enjeu de la forme spiralaire reprend également les idées de Bruno Latour sur le confinement dans le terrestre pour montrer que tout ce qui est rejeté dans l’atmosphère est loin de disparaitre dans l’infinité de l’espace, mais nous revient au contraire dans un effet « boomerang » capturé au centre du tracé.
La présentation d’Axelle Grégoire est d’abord revenue sur la genèse de ce projet composé à six mains (à l’aide notamment de l’architecte Alexandra Arènes et de l’historienne des sciences Frédérique Aït-Touati) : il ne s’agit pas de livrer un atlas mais bien une boite à outils. Le point de départ en est un ensemble d’interrogations, de freins et de blocages dans une expérience de première main de paysagiste : désarmé face à des commandes qui portent sur des paysages en ruine ou des paysages-fantômes, le paysagiste en finit par considérer le « paysage » comme une sorte de rustine capable de réparer tous les territoires. Ses outils semblent inopérants face à la compréhension des sols. Comment concilier alors le temps des vivants et le temps de la ville ? Comment regarder le sol autrement que du point de vue du foncier ? Toutes ces questions ont d’abord été développées en « et si », à coup d’hypothèses, avant d’être formulées en « comment », à grands traits de crayon. Le travail d’Axelle Grégoire s’inscrit ainsi pleinement dans l’axe de recherche de ce séminaire qui examine ici les formes de et dans la recherche scientifique, pour nous montrer ce que peut le dessin à l’endroit de la recherche. Il nous permet en effet de voir comment ces propositions ont été opérantes à d’autres endroits que le projet urbain, et dans d’autres disciplines, tout en intégrant ces regards extérieurs pour faire évoluer la démarche. Au croisement du projet urbain et de l’histoire des sciences, il repose aussi sur un ensemble de rencontres, avec notamment Frédérique Ait-Touati ou Bruno Latour, pour repenser un tracé de l’anthropocène nourri par la pratique mais aussi par tout un champ de pensée lui aussi fécond en outils conceptuels.
Quoiqu’en apparence déstabilisant, Terra Forma cherche bien à nous rendre transparente la construction de ses modèles que sont les lentilles optiques comme outils cartographiques à partir d’entrées qui interrogent aussi bien les catégories d’espace, de temps, de frontière, que de ressource ou de mémoire. Axelle Grégoire nous rappelle que depuis 2019 ces cartes ont largement voyagé, quitte à devenir progressivement des images fixes qui perdent peu à peu leur statut de prototype. Leur mobilisation dans le cadre d’ateliers, ou de discussions comme lors de ce séminaire, permet de leur redonner la vitalité de leur mise en mouvement : le dessin se doit d’y rester un mode de fabrication de la connaissance, et non uniquement une modalité de sa diffusion. C’est d’abord la multiplicité de ces ateliers qu’il nous faut souligner : la tentative d’être réceptif à la question du vent concernant les foulards d’évasion pour élaborer des cartes sur les foulards des parachutistes, celle de l’école urbaine de Lyon qui consiste à partir des descriptions des terrains de vie des participants en mobilisant des outils simples de dessin (point, ligne, surface) pour donner à chacun la capacité d’exprimer graphiquement son territoire, avant de fusionner l’ensemble des calques produits sur un même terrain pour traduire une expérience de vie collective dans l’articulation de cette pluralité d’expériences singulières, ou encore l’enquête cartographique menée sur les sols du Forez attentive aux retours des agricultures et des producteurs de lait qui part du dessin du carottage pour transcrire des mises en récit du sol à l’endroit de l’exploitation. Ces chantiers terra forma permettent de penser différents espaces de réécriture, en partant dans un premier temps de modèles, d’expériences singulières des participants, de données hétérogènes, de récits, avant de s’engager dans une voie qui accueille cette hybridité, qui cultive un travail sur des échelles généralement ignorées pour obliger à décaler un regard en partant d’un fond de plan décalé, qui réfléchit aux légendes, à la hiérarchisation et à l’organisation des informations, et qui se pose des questions sur la grammaire de la représentation (épaisseur d’une flèche, choix graphiques, nécessité d’une concertation entre experts et novices).
En écho avec les enjeux de ce séminaire, Axelle Grégoire souligne que c’est avant tout le processus d’élaboration collectif qui importe, une façon de visiter et de représenter le monde à travers des cartes qui offrent une compréhension singulière d’un territoire (et à une échelle plus vaste, de l’anthropocène), plus que le résultat. La carte devient un commutateur qui permet de passer d’une représentation à une autre, tout en restant opérante de là où elle est : les imaginaires en dessin ont bien des échos matériels, dans le passage d’un trait dessiné par l’architecte à la construction d’un mur par exemple. La démarche cartographique ainsi menée produit une méta-réflexivité permanente sur ses pratiques : en multipliant les mondes ainsi représentés, perd-on un rapport à la réalité qui résulterait d’une excessive fractalisation ? Comment retranscrire par le dessin les expressions d’exploitants qui habitent le lieu, comme l’idée de « goûter le sol » pour cette productrice du vin qui renvoie aux spécificités d’un sol basaltique ? Faut-il se mettre en scène en tant que cartographe dans sa carte, et auquel cas situer sa parole ? Tout porte à croire que les cartes de terra forma produisent une désorientation salutaire, propre à révéler une compréhension par le faire. Elles relèvent également d’un effet de traduction, au sein duquel une voix se dégage, un parti pris du crayon qui en font également des cartes d’artistes. Malgré une écriture sensible réalisée en coprésence des partis concernés (exploitants, habitants, experts fonciers, paysagistes, etc.), les cartes demeurent très peu normées (notamment dans leur travail des échelles), tout en conservant un pouvoir très pragmatique de preuves pour aborder des questions foncières. Puisque le dessin peut faire exister une pluralité de visions, il peut être le résultat d’une écriture collective qui pense la synthèse de tensions dans la description d’un espace. À l’heure où le style graphique homogénéise beaucoup de nos cartes, Axelle Grégoire prend le parti d’un travail de l’expression de ces tensions, d’un examen des interstices qui révèlent occasionnellement une incapacité de certains mondes à se superposer. Les figures accordées ou désaccordées qui en résultent deviennent un puissant outil heuristique, qui ouvre des voies de bifurcation entre sciences et arts, qui pense le dessin comme un terrain qui permet d’élaborer des systèmes de lecture différents, en lien avec une multiplicité d’acteurs ayant eux-mêmes une lisibilité différente des sols. Elles posent aussi la question du rôle du cartographe : tantôt celui qui révèle un invisible et qui déploie une expertise sur une question, tantôt celui qui opère comme médiateur dans la résolution de conflits.
Les lignes des cartes du projet d’Axelle Grégoire sont autant de façon de tisser des liens entre tous les partis mis en présence, mais aussi une manière de prendre en charge un « sol à défendre », en lien avec des problématiques liées aux gisements, à la fertilité des sols, à leur mémoire, aux connaissances qui résultent de leurs représentations comme réserves possibles. Ces travaux transdisciplinaires qui trouvent à s’exprimer dans plusieurs formes (conférences-spectacles, expositions, jeux collaboratifs, ateliers, etc.) font de « l’agir collectif » dans les écosystèmes territoriaux leur fer de lance. À leur suite, Axelle Grégoire évoque les projets à venir : la possibilité d’une carte cosmopolitique qui part de la question des sols en Île-de-France, mais aussi le prolongement du geste du dessin dans celui du tissu, de la couture, qui peut lui aussi faire territoire. Sa présentation nous aura permis de comprendre comment à partir d’un modèle prototypique peuvent émerger une multiplicité de développements possibles, à partir du dessin qui fonctionne comme une boussole d’exploration de l’inconnu, pour tendre vers une réflexion plus générale où il s’agit avant tout de poser les bonnes questions, et de les poser ensemble. L’historienne des sciences Frédérique Aït-Touati qui a également travaillé sur Terra Forma, manuel de cartographies potentielles compare la carte à une lentille optique, en rappelant la découverte du microscope par Robert Hooke. L’instrument et les images qu’il produit forment une sorte de complexe qu’il faut saisir dans sa globalité : en inventant l’instrument, Robert Hooke a publié ce qu’il voyait. Au même titre, la carte, qui peut rendre visible ou invisible des objets, des territoires, des couches sémiotiques, doit s’exhiber dans ses modalités de construction et de cadrage : tout l’enjeu est de montrer comment l’outil se façonne pour façonner à son tour. Il ouvre à sa suite la redécouverte d’une terre inouïe, qu’on croit connaitre, mais vue autrement.
Cette riche présentation aura soulevé une toute aussi riche série de questions de la part d’un public rassemblant étudiants et enseignants en géographie, sociologie, littérature et sciences. Un biologiste a notamment proposé d’envisager ce jeu de formes comme relevant d’un modèle aréolaire en biologie végétale, en rappelant qu’en biologie, c’est la forme qui commande la fonction. Une composition identique qui diffère dans des configurations spatiales variées pourra engendrer des propriétés médicinales susceptibles aussi bien de sauver que de tuer. À l’échelle des écosystèmes, la forme conditionne là encore un fonctionnement : la configuration d’une forêt détermine l’organisation des flux. Il relève à juste titre que les cartes de terra forma constituent des redéfinitions d’espaces qui sont en soit des créations, qui exhibent le lien forme/fonction comme un impensé. Une autre intervention suggère une comparaison avec l’approche sociologique, où la tentative de mettre la complexité du monde en dessin tend habituellement à la figer, et requiert un travail au temps long, sur plusieurs années, pour faire apparaitre des évolutions. Elle s’interroge sur la possibilité de réécrire ces cartes des années après pour cerner des mutations tant sur le territoire que dans la méthodologie du dessin employé. Axelle Grégoire revient à sa suite sur la genèse du projet en soulignant l’impossibilité d’utiliser des outils traditionnels qui n’offrent aucune lecture possible de l’état des sous-sols : certes la carte fige, mais elle réalise la photographie d’un territoire à un instant t. Elle souligne la capacité du dessin à mettre en relation des temporalités différentes, à intégrer cette évolution dans son tracé, tout en reconnaissant que le projet est encore jeune et doit s’atteler à plusieurs objections de ce type. Elle relève notamment l’effet transformateur qu’il suscite, principalement à l’endroit des individus, et moins à l’endroit des territoires en eux-mêmes. Enfin nous notons également une troisième intervention concernant le modèle épistémologique et heuristique de la sphère ou de la spirale et sur ses potentielles limites. Axelle Grégoire insiste sur la fécondité du modèle de la spirale, qui ouvre le cercle à une multiplication des regards, et qui pense un point de vue qui n’est pas lisible d’un unique endroit, pour asserter une nécessaire absence de hiérarchisation des données. Si sur la question des ressources le cercle ne semblait pas tout à fait opérant, la spirale a le mérite de faire passer ce modèle d’un régime bidimensionnel à un régime tridimensionnel, et surtout d’excentrer l’humain : bien que le point de vue qui réalise la carte se doit d’être assumé et situé, il devient possible d’envisager d’autres centres potentiels, comme le soleil dans la carte des agriculteurs.
François Royet : « Documenter et donner forme à la vulnérabilité » (6 février 2024)
La Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement a eu le plaisir d’accueillir pour la troisième séance de ce séminaire le réalisateur François Royet le mardi 6 février 2024 pour une intervention intitulée « Documenter et donner forme à la vulnérabilité ». Dans son film documentaire Des nouvelles d’ici-bas (100 min, 2006), François Royet nous livre le quotidien durant cinq années d’une infirmière de santé publique (Jeanine) dans son suivi de personnes en situation d’extrême précarité et en lutte avec leurs problèmes d’addiction. Le visionnage du documentaire filmé à Pontarlier s’est accompagné d’une analyse à trois voix, celle du réalisateur, accompagnée de celle de Yannick Favory (enseignant et formateur en cinéma/audio-visuel) et de celle de Christian Guinchard (socio-anthropologue, LaSA) pour tenter d’analyser le rôle de la forme documentaire dans la restitution des interactions entre les professionnels des services sociaux et leurs usagers.
La présentation inaugurale de Yannick Favory et de Christian Guinchard a d’abord mis l’accent sur le statut autodidacte du réalisateur François Royet, menuisier de formation. Son travail axé sur l’art et le geste (il a notamment filmé des peintres dans leurs ateliers) se veut le témoin d’une époque et d’un milieu à un instant t, en atteste son choix d’une petite caméra numérique portative qui lui permet de suivre plus aisément les rencontres qui dessinent la trame de ses films – rien n’est écrit par avance, comme Royet le rappelle lui-même. Dans un long métrage qui a pris en tout six ans à être tourné et un an à être monté (travail qu’il a réalisé en solitaire), François Royet accorde une part prééminente à l’expérience de première main. Le réalisateur ne connait rien de son sujet par avance, et revendique la nécessité d’être au plus proche possible de la réalité observée, dans une forme d’objectivité qui fera dans la suite de la séance l’objet d’une discussion animée. Il développe notamment l’impératif quasi éthique qui consiste à ne pas déplacer les plans pour souscrire à une esthétisation du réel lors du montage. Dans sa réalisation, c’est le sujet qui oblige à trouver une forme particulière pour être dit (notamment dans son travail de la lumière, avec la volonté de conserver le plus possible une lumière naturelle). Force est de constater, comme l’affirme Royet, que « cela fait cinéma au bout du compte ».
Ce sont bien sûr les échanges qui ont suivi avec le réalisateur qui ont constitué le centre de cette séance. Une première question, concernant un passage du film où l’on voit que celui-ci a été projeté aux concernés, portait sur les effets produits par ce film sur un temps court et sur un temps plus long. Ce fut l’occasion pour François Royet de revenir sur une particularité de ce tournage, puisqu’il n’a pas demandé l’autorisation des concernés à utiliser leur image au moment de commencer à filmer. Cette projection avait donc pour double fonction de présenter une forme plus ou moins aboutie et de leur demander l’autorisation de la diffuser. Un des participants du film a ainsi dû être retiré du montage final, car le réalisateur n’a jamais réussi à le joindre pour lui montrer le projet. Il y a donc eu d’une part des projections intermédiaires, notamment avec des proches de Jeanine et de François pour obtenir des avis et décider de la suite du projet, mais aussi pour récolter les regards de personnes hostiles au social (des habitants du quartier, qui voyaient initialement d’un mauvais œil Johnny, un des participants, auraient apparemment changé d’avis à l’issue d’une de ces projections), et d’autre part, des projections à plus large échelle une fois le projet abouti, notamment dans le festival du documentaire de Montréal. Les réflexions qui s’en suivent concernent aussi bien le rapport à l’addiction, palliatif qui aide à se focaliser sur un problème présent pour échapper à des traumatismes passés évoqués en filigrane au fil du film, que sur les modalités de prise en charge des personnes trop souvent abandonnées aux marges de la société. C’est que le projet dans son ensemble questionne la place du doute dans la réalisation d’un documentaire : un des plans à l’orée du film nous laisse entendre, sous fond d’un arpentage de nuit des rues de Pontarlier, la voix de Jeanine qui se demande si un tel documentaire est réellement capable de s’emparer d’une réalité aussi complexe. Pourtant, par la suite, le personnage de Jeanine ne se laisse jamais emporter par le désespoir, là où le réalisateur nous confie ses interrogations au fil de ces six années sur la pertinence et du projet et des petites séquences qu’il réalisait, comme l’anecdote autour de la télévision volée de Johnny. Il comprend peu à peu, et surtout en passant par le faire, que ce qu’il voyait comme un immobilisme et une réitération perpétuelle du même pouvait tout aussi bien se lire comme une suite de petites avancées, quasi invisibles à l’œil du profane, mais encouragées par une implacable Jeanine qui salue les progrès de Stéphane ou de Johnny. François Royet, accompagné d’une Jeanine qui s’est débarrassée du doute, a lui aussi fait évoluer son regard sur sa vision des « gens qui vont bien » et sur la nécessité d’accepter que les choses n’avancent pas si facilement.
Concernant le dispositif global du film, François Royet n’a pas cherché à le dissimuler : bien au contraire, laisser le micro apparent sur Jeanine est un moyen de souligner la présence du réalisateur hors-champ. Mais celui-ci a également été amené à réévaluer sa place sur le terrain d’expérimentation que constitue son documentaire : ayant demandé à Jeanine de l’appeler dans le cas où « quelque chose se passe » (notamment la résolution de l’affaire de la télévision), il se heurte à un refus de sa part. C’est à lui de se débrouiller pour être là, pour capturer ces moments de vie au moment où il s’y trouve, sans intervention extérieure. À la question de savoir si François Royet ne s’est pas retrouvé personnellement investi dans la mission sociale de Jeanine, il nous confie les difficultés qu’il a pu rencontrer dans son positionnement éthique. Comment ne pas aider Stéphane qui cherche à rejoindre une ville à moins de 2h de route de Pontarlier pour réaliser une cure ? Après que celui-ci se soit décider à un départ en stop, François Royet l’a accompagné une partie du chemin : c’est d’ailleurs avec de magnifiques plans de Stéphane en parapente que s’achève le film, répondant ainsi à la question de savoir « quand arrêter de filmer » dans un tel projet. L’aboutissement du projet de Stéphane (pourtant maintes fois réitérés à l’occasion de plusieurs cures) a signé ce qui semblait être un aboutissement du projet, une fin de tournage qui aurait pu autrement se poursuivre sur encore plusieurs années.
La trinité des personnages Stéphane/Johnny/Jeanine a donné lieu à plusieurs échanges, concernant la touche d’humour qu’apportent certains d’entre eux (Johnny qui tente de se familiariser avec les euros notamment), mais aussi sur la dimension très genrée de la prise en charge de Jeanine comparée par une chercheuse en littérature à une sorte de Sœur Teresa bienfaitrice. Le rôle du réalisateur a lui-même fait l’objet d’une évolution au cours du tournage : là où Jeanine le faisait initialement passer pour un stagiaire, il s’est ensuite affirmé auprès des personnes qu’il suivait comme réalisant un film « avec » eux (et non « sur » eux). Concernant la réception du film, des questions ont soulevé l’éventuelle neutralité d’un regard sur ce que le film désigne comme des « accidentés de la vie ». François Royet défend la position d’un témoin muet qui tente d’accompagner sans construire un regard militant, qui cherche à provoquer quelque chose de particulier dans un film qui suit des personnages sans jamais les lâcher. Il relève que certains spectateurs eux aussi travailleurs sociaux ont pu porter un regard désapprobateur sur Jeanine qui s’investit énormément dans son travail, là où une telle charge serait peut-être impossible à mener aux temps d’aujourd’hui.
La forme du documentaire s’est trouvée elle aussi interrogée à plusieurs reprises, notamment par Yannick Favory qui a relevé le cadrage très serré fréquemment utilisé pour faire du visage l’unique occupant d’un plan. À la question de savoir s’il y avait là une intention particulière dans cette façon de s’emparer des visages, Royet a expliqué qu’un échange dans le cadre d’une réunion lui semblait être porté principalement dans les expressions des participantes, au milieu de lieux qu’on ne connait que trop bien (murs blancs, chaises en plastique, éléments visuels dont personne ne se souvient et qui ne marquent pas l’attention). Une discussion peut ainsi très bien se passer de corps et se situer entièrement dans des visages. Yannick Favory a d’ailleurs rebondi sur l’importance d’un cadrage qui suffit à faire comprendre des scènes, en relevant que le réalisateur filme « au niveau des gens » (il s’assoit lorsque son sujet est assis), et travaille savoureusement le dédoublement des encadrements en utilisant une porte entr’ouverte lors de l’appel de Jeanine qui semble démontrer l’aporie d’une démarche administrative sans fin. François Royet explique à sa suite son refus de l’utilisation d’un pied pour filmer, pour que son film demeure « fait main », mais aussi son questionnement incessant sur « où se mettre » pour bien voir ce qui est en train de se passer. À ce titre, il souligne l’importance de Jeanine comme « révélateur » au sens presque photographique du terme, en expliquant que lorsqu’il venait filmer Johnny sans Jeanine, « il ne se passait rien ». Christian Guinchard a clos cette après-midi de discussion en soulevant la possibilité, reconnue par François Royet, d’envisager ces rushs non exploités comme à la fois des documents, et un matériel artistique, au même titre, lors des séances précédentes de ce séminaire, que les diagrammes de Laurence Dahan-Gaida ou les cartes d’Axelle Grégoire.
Ce séminaire s’est prolongé en soirée à l’occasion d’une projection grand public de quatre courts métrages de François Royet : « Chaque instant, une peinture de Charles Belle » (2018, 9 min), « Intra-muros mouvements » (2004, 26 min), « Crayon, terre, savon et rouille… Jean Daligault » (1995, 11 min) et « Courbet, la tourmente » (2000, 11 min)1. Ces quatre films apportent un regard original sur la création artistique (peinture, danse) et ses processus dans des contextes extrêmement différents, allant d’ateliers pictural réels ou fictifs au camp de concentration, en passant par la danse dans un univers carcéral. Le court-métrage « Crayon, terre, savon et rouille » sur la vie de l’artiste Jean Daligault aura suscité des échanges très intéressants, notamment avec le dicteur du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, concernant par exemple la multiplication des mêmes œuvres par Daligault dans plusieurs lieux carcéraux différents. La forme du court-métrage a également fait l’objet d’une discussion sur les refus qu’elle suppose, comme celui de choisir des acteurs décharnés dans la veine de La liste de Schindler de Spielberg. Nous retenons tout particulièrement les échanges autour du court métrage « Intra-muros mouvements » qui présente le travail d’un chorégraphe, Franck Esnée, qui propose des ateliers de danse en milieu carcéral. Le traitement de l’image par un filtre s’explique par une volonté de flouter les détenus et surtout par le refus d’isoler uniquement leur visage dans cette modification. Mais comme le remarque l’audience du séminaire, le filtre finit par offrir une dynamique au film, par consigner une impression de mouvement dans l’image par contagion des scènes de danse. Les rushs s’assemblent en un morcellement assumé pour rompre définitivement avec la lourdeur de la continuité du temps carcéral, dans un espace qui se propose de faire exister un autre rapport au temps. François Royet nous confirme qu’au contact de Franck, les détenus et danseurs avaient l’impression d’être amenés ailleurs le temps d’un atelier. Plusieurs résonnances se sont tissées avec le long métrage de l’après-midi, notamment sur le traitement de l’espace en situation de grande précarité, qui tend à se réduire dans les scènes d’intérieur du film Des nouvelles d’ici-bas là où il s’ouvre grâce au travail du chorégraphe – et Royet de confirmer un changement d’attitudes et de rapport au corps au fil des ateliers de Franck. Le réalisateur nous confie également, à l’issue de cette projection, une des anecdotes qui ont ponctué son tournage : il a été pris pour un détenu par un des gardes après être arrivé en retard aux ateliers, et a laissé faire l’expérience en se voyant confiné dans un espace à part pour un temps indéterminé, avant d’être reconnu par un Franck surpris par son absence et jetant un œil à l’extérieur de la pièce. Ce passage du cinéaste au détenu, puis du détenu au cinéaste tandis que les gardes étonnés de son silence le laissent rejoindre l’atelier (séquence qui n’est pas filmée mais bien narrée par François Royet) insiste une fois de plus sur une volonté du cinéaste de capturer « l’image des choses dans la société » en partant du regard porté sur elles.