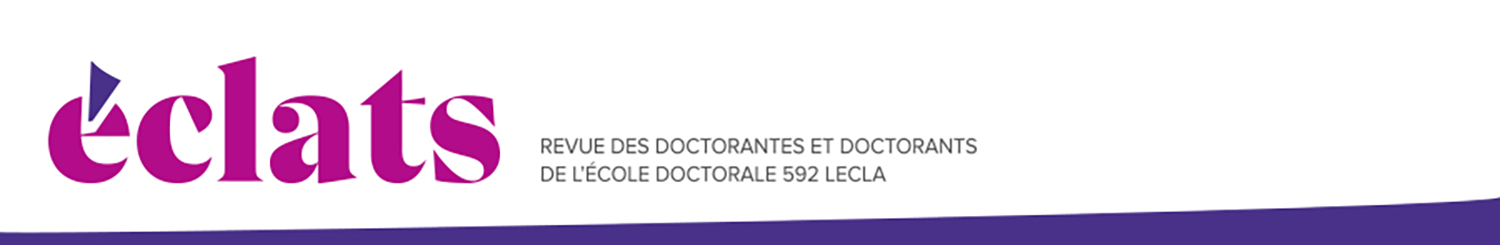Introduction
Dans son introduction à « Les ennuis, c’est mon problème », Raymond Chandler écrivait en 1934 que « la bonne intrigue, c’est celle qui fabrique de bonnes scènes1 ». Comparant quelques lignes plus tard l’art du policier au cinéma, celui qui codifia le roman noir à l’américaine, dit hard-boiled, par contraste au roman à énigme britannique2, il saisit déjà l’essence de toute une cinématique sensible fondée sur le rythme des images, la pulsation des phrases, les captivants silences. Né en 1937 dans le Bronx, Jerome Charyn, fils d’immigrants juifs d’Europe de l’Est, grandit dans un mutisme selon lui caractéristique de son milieu pauvre et analphabète. Il fut toutefois abreuvé toute son adolescence des technicolors hollywoodiens, qui le marquèrent moins par leur force narrative que par l’éloquence de leur « musique visuelle quasi hypnotique » (Frederic Tuten in VALLAS, 2014, p. 1143), l’illusion optique de la salle noire opérant pour lui une fascination haptique, un rapport immédiat engageant tous les sens. Véritable oiseau de nuit, Charyn trouvait dans les pièces souterraines des movie theatres de son quartier une étrange quiétude, une sorte de somnolence régénératrice qu’il comparera plus tard à la puissance de la fiction :
[J]’ai compris qu’il y avait quelque chose de plus puissant que la narration elle-même : une foi inébranlable dans le langage, et l’idée que la rhétorique serait comme un long serpent qu’on aurait placé là pour captiver le lecteur ou la lectrice, dans une séduction qui tendrait vers une sorte de sommeil merveilleux, pour que nous puissions traverser le livre par la seule force du rêve. (Frederic Tuten in VALLAS, 2014, p. 1144)
On situe généralement en 1975 le début du succès de Charyn outre-Atlantique, avec la publication de Blue Eyes, premier volume d’une saga policière qu’il a clôturé en 2017 avec Winter Warning, le douzième d’une série qui aura été largement traduite et rééditée. Blue Eyes marque un pivot dans le travail de Charyn qui, à ce moment-là, publie déjà depuis une bonne décennie des histoires (principalement inspirées des vestiges d’une culture juive en voie de disparition dans le Lower East Side) ainsi que quelques romans (dont la veine expérimentale ne lui aura pas gagné l’enthousiasme du public américain). Charyn inaugure en effet dans ce premier opus une formule certes éprouvée, celle du polar à l’américaine, avec la noirceur de ses bas-fonds, la crudité de ses scènes d’action et de sexe, les méandres de son intrigue douteuse et pas vraiment centrale, mais au sein de laquelle il développe les éléments idiosyncrasiques qui traverseront tout son œuvre de manière significative. Son héros, Manfred Coen, jeune flic mélancolique que Charyn achève dans le tout premier volume, donne ainsi le ton à cet univers très charynien où le rythme soutenu des courses-poursuites ménage néanmoins des espaces incongrus pour la lenteur et la réflexivité.
Phénoménologie du polar, ou l’univers sensible de l’idiot
Au sein d’un texte censé répondre à des attentes relativement spécifiées, celle d’une action à bout portant et d’un ton à la noirceur amère, Charyn imprègne en effet le langage d’une fonction inattendue, créant un hors-champ de l’action per se pour entraîner le texte au-delà de ses contraintes génériques. L’univers sensible du personnage de l’idiot, que la corporalité exacerbée et le retard intellectuel semblent rendre particulièrement enclin à la sensorialité5, s’exprime par le biais d’une synesthésie aussi inattendue qu’inexpliquée. Aussi, dans cet extrait, Jerónimo, alias le Bébé, et Zorro, surnommé le Renard, deux frères d’une famille de mafieux péruviens, les Guzmann — qui sont, dans la saga, une des menaces pesant sur l’ordre moral du Bronx (plutôt mal) régi par la police locale — se retrouvent dans une étreinte pleine d’odeurs, de saveurs et de caresses :
Dans la voiture, le Renard serrait Jerónimo dans ses bras. C’était une étreinte gourmande. Il voulait sentir la soudure des os de son frère, le protège-oreilles dans sa poche, les boules de naphtaline que tous les Guzmann écrasaient dans les revers de leurs poignets de chemise (ces boules de naphtaline pouvaient combattre l’odeur nauséabonde du diable). Zorro n’avait pas peur de le perdre. Jerónimo n’allait pas sauter de la voiture. Le bébé regardait Zorro dans les yeux. Il ne gémissait pas. Il n’agitait pas les bras. Il se lovait contre la poitrine de Zorro. […] Zorro pouvait éprouver les battements de cœur de son frère. Ils étaient aussi forts que le curry, aromatisé aux épices venues d’Uruguay, que Papa faisait à Boston Road. C’était l’arôme des crypto-Juifs, fort, acide, celui des Marranos fous dont la crainte et l’amour avaient la même odeur puissante. La chemise du Renard était mouillée. Jerónimo faisait-il ses dents contre l’estomac de Zorro ? Le bébé regardait du coin de l’œil les escaliers de secours de la Neuvième Avenue. Il méditait les idéogrammes dans les vitrines des poissonniers et des volaillers, souriant quand il reconnaissait un museau d’espadon, des plumes de poulet, les pieds palmés d’un canard. (Kermesse à Manhattan, p. 527-5286)
L’odeur de Jerónimo est aussi complexe et insaisissable que le passé inextricable de la famille Guzmann, gouvernée par les lois contradictoires de son patriarche, Moses. Venus historiquement de la péninsule ibérique, forcés à se convertir au catholicisme et à pratiquer les rituels juifs dans le secret, les marranes incarnent une culture palimpseste, issue de mélanges et de mascarades — la référence au diable, ici, ne précisant pas s’il s’agit d’exorciser les frères d’une menace extérieure ou au contraire de dissimuler l’odeur impure des membres de ce clan aux yeux des autres Américains. Dans l’habitacle de la voiture, les deux frères rejouent une scène quasi-matricielle, où la promesse de deux corps unis, peau contre peau, jusque dans les battements de cœur, dans une seule et même identité, achoppe finalement contre les mystères du nouveau monde et de ses signes indéchiffrables. Dans leur étreinte, ces deux hommes adultes restent enfants, prisonniers de l’état in-fans, arrêtés au seuil du Bronx réel, puisqu’imprégnés de leurs odeurs ataviques, ils peinent à pénétrer la réalité américaine dans sa brutale matérialité. Paradoxalement, la sensorialité toute animale des Guzmann, par ailleurs décrits dans le texte comme abondamment poilus et noirauds, ne les enferme pas dans le présent de la sensation, mais signale une tradition ancestrale de refus de la société qui les entoure. Dans ce sens, Jerónimo, l’idiot de la famille, ne souffre pas que d’un dysfonctionnement physiologique — quand il bave sur la chemise de son frère et que son visage s’arrête en un sourire béat, c’est toute une communauté d’immigrants hébétés qui pourrait renoncer avec lui à maîtriser l’alphabet américain. Les inscriptions impénétrables sur les vitrines sont pour lui des images, des « idéogrammes » qui ne prennent sens que lorsqu’ils sont assortis des objets correspondants, ces volailles qui certes l’attendrissent, mais qu’il ne comprend pas — la correspondance visuelle, graphique et acoustique des signes lui échappant bel et bien. Pour les Guzmann, qui portent sur eux les marques de leur matrice d’origine et vivent le rêve américain à leur propre sauce, les États-Unis ne seront jamais ni un lieu de naissance, ni un lieu où recommencer à neuf. Le texte les ramènera d’ailleurs, à la mort de Jerónimo qui clôt ce volume, en Europe, à Barcelone, marquant l’échec du récit linéaire du rêve américain, remplacé par un récit cyclique de retour aux origines.
La question des origines, toutes douteuses et honteuses soient-elles, hante aussi le personnage de Manfred Coen, cet orphelin qui trouve sa vocation de flic au moment du suicide de ses parents, lorsqu’Alfred et Jessica Coen, juifs ashkénazes sans excentricités, décident de demander au frère simplet d’Albert, Sheb, de les aider à enfourner leur tête dans la gazinière. Ce geste rejoue en miniature la tuerie des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale et rappelle par conséquent la compulsion ou « contrainte de répétition » détaillée par Sigmund Freud dans le troisième chapitre d’Au-delà du principe de plaisir (2010, p. 17). Leur fils Manfred, héritier de cette série traumatique, devient l’ultime descendant d’une lignée de juifs végétariens, sages, blonds aux yeux bleus, candidats d’élection à l’américanité que les Guzmann, au physique sombre et à la moralité obscure, ne seront jamais. Coupé de ses racines, Manfred erre du côté de la police et tombe sous la houlette du commissaire Isaac Sidel, ennemi juré des Guzmann aux côtés desquels le jeune flic a grandi dans le Bronx. De sa famille biologique, il ne reste que Sheb, son oncle (prétendument) demeuré, interné dans une maison de retraite où il surprend son monde par sa lucidité :
Hors du Bronx, […] l’oncle prospérait. Il avait fait son éducation grâce aux manettes d’un four. Manfred Coen, de la brigade criminelle, avait vu des macchabées arriver à l’hôpital en tirant une langue longue comme ça, des bébés carbonisés, une prostituée de Chelsea avec une tringle à rideau enfoncée dans le vagin, un rabbin de Brooklyn qui avait des nids de vermine là où auraient dû être ses yeux, un trafiquant de drogue qu’on avait repêché avec des crapauds dans les poils du pubis, il avait fait la tournée des morgues, il avait touché des épidermes plus épais que l’écorce, il avait vu des médecins légistes découper des crânes à la scie. Mais il n’avait pas allumé le four pour le compte de son père. Que savait-il d’Albert et de Jessica ? Jusqu’où peut-on se pencher pour humer son potage avant de se brûler la figure ? (Zyeux-Bleus, p. 357)
L’énumération colorée permet de niveler les horreurs toutes relatives d’une journée typique dans la vie d’un flic, ce qui a un effet magnifiant sur la référence au suicide des Coen, simplement suggéré par l’image du four, mais que la position en fin de paragraphe rend particulièrement saillante. Plus Coen fils s’est endurci à la brigade criminelle, moins il semble capable d’accéder aux souvenirs familiaux, mis à part de « vagues détails fragmentaires » (p. 358). En fait, la voix narrative conclut que Manfred ne se souvient pour ainsi dire de rien, ou du moins « rien qui lui aurait permis de les revendiquer comme ses parents. Il aurait aussi bien pu être né Guzmann que Coen » (p. 358). Cet écueil de sa mémoire signale effectivement une zone d’ombre, incompréhensible, aussi magnétique que repoussante. L’image du visage humant le potage au point de se brûler rappelle en effet un des exemples choisis par Freud pour illustrer la répétition traumatique, dans lequel la sensation de brûlure sert de rappel à la vie7. Ici, la crainte de répétition, qui se rapporterait au fait de se brûler dans le liquide familial, et donc à revivre une douleur devenue atavique, est dans une certaine mesure évincée par la possibilité de se détacher du potage, de s’en tenir à quelque distance — en d’autres termes, d’être sensible à cette histoire sans pour autant la revivre comme expérience présente. En refusant, malgré lui, de s’inscrire dans la lignée de la famille Coen, puisqu’il « aurait aussi bien pu être né Guzmann que Coen », Manfred esquive la réitération (mais finira quand même par mourir dans le feu, comme on le verra).
À l’inverse de Coen, l’oncle Sheb est pleinement conscient de l’événement tragique dont il a été partie prenante, et sa personnalité aberrante apparaît comme un antidote salutaire au calme plat de la mémoire desséchée, un peu trop factuelle, du neveu, qui du souvenir d’un portefeuille paternel ou d’un peigne maternel ne parvient pas à tisser une histoire familiale structurante. Du fait que papa Guzmann charge Jerónimo de porter à Sheb quelques dollars et un rouleau de papier toilette hebdomadaires, en guise de pension familiale (ou pour acheter son silence, le texte laissant entendre une possible responsabilité de Moses dans la mort d’Albert), les deux « idiots », qui se côtoient depuis toujours, s’épanchent donc régulièrement dans des accès de larmes qui restent intraduisibles pour les spectateurs ébahis de l’hospice :
Sans préliminaires ni transitions, sans explications, le vieux et le bébé se prirent mutuellement par les poignets et se mirent à pleurer à chaudes larmes. […] Ils pleuraient sur leur enfance prolongée, […] à cause des petites humiliations qu’ils essuyaient dans le Bronx et leur faisaient serrer les poings et rentrer la tête dans les épaules, […] à cause des rêves qui hantaient leur sommeil lourd et épais—rêves de blizzard, d’égoûts qui débordent, d’escaliers d’incendie qui s’effondrent, de toits en flammes, de volcans faisant éruption dans le Bronx—, à cause de la peur qui ne les quittait pas un seul instant quand ils étaient éveillés. (ZB, p. 406-407)
À la mémoire lacunaire de Manfred répondent celles, excédentaires, car gouvernées par des sens en plein dérèglement, de Sheb et de Jerónimo, qui pourraient abriter dans leur communion une histoire partagée, autant commune que collective. Là encore, les personnages d’idiots semblent agir comme témoins de leurs deux familles immigrantes, dont ils auraient absorbé l’histoire transgénérationnelle, moins dans sa dimension factuelle qu’affective. Les attitudes psychosomatiques que prennent leurs corps renfrognés viennent cristalliser l’inadéquation du greenhorn dans son nouveau milieu, tandis que leurs rêves où les éléments se déchaînent transposent les réalités sordides de leur environnement (en 1972, quelques années avant la parution de Zyeux-Bleus, la partie Sud du Bronx se met littéralement à brûler) en un vaste panorama catastrophique. Tout se passe comme si les événements traumatiques du passé, des persécutions en Europe du Sud et de l’Est au suicide du couple Coen, en passant par la sélection douloureuse sur Ellis Island, trouvaient à s’exprimer dans l’imaginaire débridé et débordant des deux idiots. Le fait que Sheb et Jerónimo soient perçus par leur entourage comme des êtres « arrêtés », demeurés, stupides dans leur dépendance vis-à-vis des autres membres de la communauté, pourrait signaler une sorte de stérilité insidieuse frappant d’une impossibilité l’avenir collectif du groupe tout entier. L’idiotie, depuis le Benjy Compson de William Faulkner, est après tout souvent associée à la consanguinité et à la dégénérescence. Toutefois, le texte envisage aussi le potentiel libérateur des larmes sans paroles : là où Coen ne parvient pas à mettre des images, et encore moins des mots sur son passé disparu, la logique idiote permet à Charyn de mettre en scène une rationalité spatio-temporelle de la sensation et de l’émotion.
Quand la mort de l’idiot fait sensation
Dans Les filles de Maria, sixième volume de la saga Sidel, Teddy Di Angelis est un tueur à gages, fils d’un des patrons de la mafia que les hommes de Sidel, Carroll Brent et Joe Barbarossa, sont chargés de cerner. Baptisé Nose (« nez » en anglais) à partir du sobriquet yiddish schnozzola (« grand nez »), Teddy souffre d’une érection constante qui fait de lui un grotesque au croisement de Priape et de Pinocchio. Comme les autres personnages d’idiots dont il partage les aberrations (son priapisme faisant écho aux masturbations publiques et intempestives de Sheb, par exemple), Teddy est vulnérable, dépendant, et donc singulièrement sensible, ce qui participe à faire de lui un grotesque, dans le sens que Flannery O’Connor donne à ce terme dans son essai « De quelques aspects du grotesque dans le roman du Sud » (O’CONNOR, 2008, p. 8308). La « voie de la distorsion » (8319) formulée par O’Connor passe en effet par un remaniement de la réalité au prisme des sens, ce qui permet à l’œuvre d’« atteindre aux franges du mystère » (83110). De tels personnages sont construits par « des vides et des ellipses » (830) là où en attendrait des détails réalistes, et fonctionnent à contre-courant des attentes pour obéir à leur propre « cohérence interne » (830). Le personnage de l’idiot, comme le grotesque selon O’Connor, « s’éloigne des schémas sociaux habituels pour [se] rapprocher du mystère et de l’inattendu » (830), ce qui induit des logiques textuelles surprenantes. Le corps monstrueux et lon comportement non policé de Nose signalent en effet chez lui un dérèglement général et contagieux, jusque dans sa mort silencieuse qui est l’objet d’une mise en scène spectaculaire. Sous les tirs des hommes d’Isaac, Nose est un animal fragile qui tombe à terre sans un bruit, et ce silence magnétise la lecture :
Barbarossa expédia une balle dans le minuscule morceau de front qui demeurait visible. Isaac entendit l’os craquer, mais Teddy Boy ne tomba pas. Ses genoux fléchirent. Isaac avait du sang sur le côté du visage. Le Tarin s’était fait glocker en pleine tête, et il refusait toujours de s’asseoir. Il tira sur Barbarossa. Il essaya de tirer sur Caroll. Mais ce dernier se laissa tomber à terre, fit le tour d’Isaac en rampant et vida son pistolet de service dans le Tarin qui se mit à danser sous l’impact des balles, serra les bras autour de sa poitrine, comme s’il pouvait essuyer ses blessures, s’enfonça dans les bois en tournoyant sur lui-même, en tendant une main pour agripper le ciel, à la manière d’un ours de cirque, et bascula dans l’herbe sur le ventre, la tête la première. (FM, p. 34611)
Dans le rythme effréné des tirs portés lors de l’affrontement, une lenteur émerge peu à peu, à mesure que le style paratactique permettant aux actions de s’enchaîner (en anglais, le prétérit est le temps privilégié de l’action brève) laisse la place à une phrase interminable qui passe en slow motion la chute de l’idiot. Dans sa dernière danse, comparée à une valse en solitaire, ce dernier se retrouve au cœur d’un spectacle textuel, effets sonores compris (le crissement des os broyés), qui le place en position de faiblesse. Le détail du front percé par la balle renvoie en effet au mythe ashkénaze du golem, ce colosse de glaise créé, et plus tard détruit, d’un revers de la main par son maître, seul capable d’effacer la lettre sur son front qui distingue les mots hébreux « vie » (emet) et « mort » (met). De golem à ours, Nose cumule les attributs du géant fragile et impuissant, et devient donc énorme au sens étymologique du terme latin ex-normis, une créature extraordinaire capable d’habiter le hors-champ cognitif du lectorat. C’est paradoxalement dans sa chute « idiote » que Nose devient attendrissant, et qu’il ouvre un nouvel espace dans le texte. À la phrase suivante, Barbarossa jure amèrement devant son arme encore fumante qu’il a bel et bien abattu l’ennemi, et donc catalysé la résolution de l’intrigue, mais qu’il « ne s’est rien passé » (p. 346). Trompé par ses sens et par ses attentes, le flic vivant reproche à l’idiot mort d’être « rien », d’avoir disparu sans un bruit, et de quitter le texte avant que son mystère ne soit élucidé. L’idiot charynien semble assurément remplir une fonction presque métaphysique12 dans la mesure où son fonctionnement décalé et irrationnel rend vaines toutes tentatives de maîtrise : on peut tuer même l’idiot le plus récalcitrant, mais il reste impossible d’enquêter sur l’énigme qu’il représente.
Ce n’est pas par hasard que l’entourage immédiat de Jerónimo passe son temps à le chercher, « Où est Jerónimo ? » étant une question récurrente dans tout le volume Kermesse à Manhattan. Qu’il s’agisse de sa famille, censée le protéger (il a besoin d’assistance pour se nourrir, se laver et se vêtir), ou de la police, chargée de le débusquer (il est, à juste titre, soupçonné de tuer en série des jeunes garçons sur les toits du Bronx), tous les yeux sont braqués sur lui, mais du haut de sa gigantesque carrure, il échappe à tout le monde. Quelques instants avant la mort de ce personnage, le texte le met en scène en liberté, hors d’atteinte de son tuteur irlandais Patrick et loin du contrôle absolu de son père Moses. À ce moment, livré à lui-même dans un monde qui lui est de toutes parts hostile, Jerónimo devient un peu le dernier Indien que son nom rappelle indirectement. Immobile, Patrick guette l’arrivée de son protégé, dont il vient de comprendre les agissements meurtriers :
Combien d’heures s’écoulèrent — cinq ? Deux ? Une ? Il aurait pu neiger en plein mois d’août. Patrick ne voulait pas bouger. Ses cheveux blancs s’étaient mis à frisotter. À part ça, il était tout gris. Un gars voûté tourna le coin de Riverside Drive. Ses cheveux étaient de la même couleur que ceux de Patrick : blancs avec un frisson de bleu. Il rasait les murs des immeubles qui brûlaient d’un orange violent dans la lumière du soir. Le gars galopait dans cette brume orange. Rien ne pouvait bloquer les coups de poignard de ses genoux. Patrick appela Jerónimo. […] — Jerónimo. Le bébé leva les yeux des briques orange. Sa bouche frémit et s’ouvrit. Autour de ses yeux, sa peau se contracta. Il se voûta encore plus. Il se mit à reculer doucement en se balançant sur ses talons, puis il plongea dans Riverside Drive. (KM, p. 52613)
L’étrangeté de la scène, pour le lecteur habitué à voir Jerónimo apathique, prostré sur un tabouret dans la confiserie de son père, tient à l’agilité inattendue de cet homme en fuite comme un cheval sauvage au galop. Charyn rend ces quelques instants très cinématiques, empruntant au gros plan hollywoodien son sens du détail, jusque dans les ridules du visage, et misant sur une palette de couleurs dramatique, contrastant le gris bleuté avec un « orange violent » (« orange furieux » dans le texte anglais), pour cristalliser la tension de l’intrigue — quelques phrases plus tard, l’idiot perd la vie et quitte le texte, encore une fois dans le plus grand des silences. La temporalité, rendue quasi onirique par l’évocation de la neige en août, vient parfaire ce portrait suspendu — à ce titre, il est curieux que la traduction française ait compris « stooped boy » (« un gars voûté ») au lieu du terme original, « stopped boy », certes plus incongru (et peut-être erratique, la coquille étant ici envisageable). Arrêté, Jerónimo l’est bien, tout autant dans son mouvement que dans sa croissance intellectuelle et que, finalement, dans sa trajectoire narrative, sur le point d’être interrompue prématurément.
Au détour des sens, l’épiphanie, et le trauma
Certes, les codes du genre policier banalisent dans une certaine mesure les descriptions explicites de l’agressivité, mais régulent moins précisément les ellipses narratives qui servent parfois à rendre la mort encore plus indicible. Le sacrifice de Jerónimo sous la main de son propre père, scène abrahamique qui vaut en violence symbolique la plus rude des chasses à l’homme, est en effet traité sur le mode du silence, un non-dit d’autant plus évocateur qu’il passe par le regard d’un témoin incrédule. Par un glissement énonciatif discret (procédé par ailleurs impossible au cinéma), Miguel, le chauffeur familial des Guzmann, s’approprie en effet la voix narrative pour la défaire de toute sensualité affective. Là où Zorro enserrait amoureusement son frère dans un moment de synesthésie épiphanique, tout n’est désormais que précision technique et détails visuels :
Les doigts de Papa se crispèrent sur la brique. Il ne voulait pas qu’Isaac fourre Jerónimo dans la prison de Tombs. […] Jerónimo ne regarda pas la brique d’un air méfiant. Il tourna la tête vers Papa. Il frotta l’épaule de Zorro avec son cou de Guzmann. Il pensait à tous ses frères. Le bébé ne possédait pas le mot au revoir dans son vocabulaire. Ses narines aspirèrent de l’air en reniflant. Sa langue recourbée était posée sur sa lèvre. (KM, p. 53014)
Comme le lecteur a de toute manière déjà compris le sort qui attendait Jerónimo, il n’est plus ici question de suspense et de tension dramatique, et il serait tout à fait possible de continuer la description de manière linéaire et chronologique. Pourtant, au moment du coup fatal, la narration semble se disjoindre :
Sa tête effleura le bas de la vitre juste à temps pour regarder la brique de Papa. Il aurait juré sur el dia de los inocentes que Papa avait défoncé d’un baiser le crâne de Jerónimo. Ou bien Miguel était fou, ou bien le coude de Papa n’avait pas bougé de plus de deux centimètres. Moïse toucha Jerónimo entre les yeux. Le bébé s’écroula, le front ridé, dans les bras de Zorro. […] Señora, ils avaient transformé son taxi en corbillard. (KM, p. 53015)
Techniquement, la brique ne touche le crâne qu’une seule fois, mais le texte fragmente le récit de ce contact fatal, s’arrêtant dessus comme un disque rayé et bégayant, peut-être par mimétisme de l’incrédulité grandissante de Miguel, témoin non consentant du sacrifice. L’enchaînement cognitif des images introduit ainsi d’abord la brique, puis le « baiser », puis le petit mouvement de coude, et enfin le « toucher » final. Par petites touches, le texte décompose la scène, comme par instantanés photographiques, et brise sa continuité. La voix de Miguel, d’ailleurs, entretiendra pendant quelques paragraphes encore l’illusion d’une possible happy end, avec une résurrection christique du Bébé sous l’emprise des magiques invocations marranes…
Mais, dans la tradition du western américain, où le plus « sauvage » des crimes finit toujours par être confronté aux lois de la civilisation, Charyn ne peut pas laisser Jerónimo, ce tueur en série angélique, survivre à ses méfaits. Entre le laisser libre, et le livrer à la police, il reste la justice alternative de l’infanticide, d’une violence aussi inouïe qu’elle est salutaire pour le principe de loi morale. Dans le rythme général du volume, cette scène frappe par sa tranquillité, une quiétude qui n’en perd pas sa force sensationnelle. Là encore, la description ne recule pas devant l’explicite de l’hémorragie interne provoquée par la brique assassine : « Il y avait deux Guzmann dans son rétroviseur. Zorro et le bébé mort. Papa n’était pas dans la voiture. La cervelle de Jerónimo était surtout bleue. Il avait la tête enflée. Il était assis contre l’épaule de Zorro, comme un gamin vivant. Miguel hurla en silence » (MG, p. 530). L’horreur du chauffeur de taxi n’en est pas pour autant celle du lecteur, qui est entraîné dans la suite de l’intrigue sans trop de ménagement, mais sans soulagement non plus. L’univers du polar n’est pas le lieu où décider du bien et du mal, et Charyn renonce effectivement à faire de son roman un whodunnit, récit policier s’achevant sur la résolution de l’enquête et la saisie du coupable. Au lieu des prouesses intellectuelles du détective à la britannique, il propose un texte résolument sensoriel, voire sensuel, même aux moments les plus inadéquats, la violence empruntant à l’idiotie son esthétique déstabilisante, lorsqu’elle est ainsi stylisée au-delà des frontières de la morale.
Lorsque Manfred Coen meurt, à la fin de ce premier volume de la saga, c’est le même silence qui envahit une scène qui devrait pourtant, en toute logique, être assourdissante. Au moment où Chino Reyes pénètre le club de ping-pong souterrain où Coen vient se réfugier une fois son service terminé, toute la brigade de Sidel le talonne. Les armes à feu sont dégainées et, une fois que Chino lance le bal en tirant sur Coen, un massacre général s’ensuit, qui détruit au passage toute l’infrastructure du club. Quelques instants plus tôt, Coen est représenté au faîte de sa gloire, en plein exploit physique, quoique ridicule, dans son short bleu un peu large et son bandeau jaune. Si Charyn ne range pas Coen dans la même classe d’idiots que Jerónimo, Teddy ou Sheb, il ne le considère pas moins comme un de ses personnages ontologiquement fragiles, un de ceux que Gilles Deleuze, dans sa typologie de personnages melvilliens, décrivait comme « ces anges ou ces saints hypocondres, presque stupides, créatures d’innocence et de pureté, frappés d’une faiblesse constitutive, mais aussi d’une étrange beauté, pétrifiés par nature » (DELEUZE, GUATTARI, 1993, p. 102-103). Coen est à la fois l’Américain original, ce blond aux yeux bleus sportif et séduisant, et l’Idiot insaisissable, voué à disparaître dans un monde qui ne le considère pas comme important : comme Jerónimo, Coen est sacrifié par une figure paternelle, Isaac Sidel en personne, qui le jette peu ou prou dans les griffes du diable quand il l’envoie en mission chez les Guzmann. Et dans les deux cas, leur mort survient dans un silence total, oblitérateur. La balle qui tue Coen le prend en plein match, qu’il est d’ailleurs en train de gagner :
La raquette lui siffla aux oreilles. Coen eut l’impression que quelque chose le broyait, une onde de choc qui lui ébranlait les dents, se propageait à son bas-ventre et à ses jambes. Il eut un goût de sang dans la bouche. Ses chaussures se collèrent à sa figure. Il ne comprit pas comment il se retrouvait projeté contre le mur. Maintenant, il avait soif. Il se rappelait une pêche qu’il avait achetée pendant les maneuvres, à Worms, une énorme pêche rouge, une « colorado » qu’il avait payée l’équivalent d’un demi-dollar parce que le marchand lui avait juré dans un anglais sans défauts qu’elle était venue d’Amérique du Sud dans un caisson de glace. Il l’avait rincée à l’eau de sa gourde, il avait effleuré du doigt les aspérités de sa peau duveteuse, rouge et jaune, il y avait enfoncé son couteau, stupéfait qu’une pêche, indépendamment de sa nationalité, ait la chair vineuse autour du noyau. La dégustation lui avait pris une demi-heure. Il en découpait de petites tranches, léchant le jus qui coulait sur ses doigts. Du sang jaillit de ses oreilles quand il essaya de déglutir. Ses yeux virèrent au rose. Une écume rougeâtre dégoulina de son menton. L’air ne sortait plus que par une seule de ses narines. Isaac arriva avec sa troupe après le second coup de feu. (KM, p. 38716)
Du coup de feu à la dernière expiration, il ne se passe que quelques instants, que le texte incarne avec force détails sur les sensations internes de Coen — ses dents secouées par le choc, ses organes et toute sa structure osseuse qui s’ébranlent, le goût du sang et le contact de l’air sur ses muqueuses. Mais le temps semble bizarrement s’étirer alors que, dans un retour en arrière significatif de sa mort imminente, Coen tombe en anamnèse. Le sang sert ici de fluide conducteur aux associations imprévisibles de la mémoire, qui connectent la sensation de sécheresse dans la bouche (« il avait soif ») à celle, apaisante, éprouvée en dégustant une pêche bien juteuse, puis, dans le sens inverse, opérant un retour vers la déglutition difficile d’un Coen exhalant son dernier souffle. Le texte disjoint délibérément les temporalités, juxtaposant l’urgence de l’hémorragie à la lenteur de l’instant savouré, détaillant pour cela le lieu du goûter, le prix et l’aspect du fruit, les gestes délicats de la main et du couteau. Ce détour surprenant du texte, mimétique du phénomène de dissociation assez courant en cas de choc ou de douleur intense, a surtout pour effet narratif de repousser la disparition de Coen, la rendant ainsi plus marquante — le lecteur averti de Charyn sait que son départ prématuré hantera tous les autres volumes de son absence-présence, notamment sous la forme d’un ver solitaire ayant établi domicile dans l’intestin de Sidel et matérialisant de façon très corporelle la culpabilité de ce dernier.
Ce lecteur sera d’ailleurs interpellé par la référence à « Worms », lieu introuvable sur la carte new-yorkaise, mais permettant un improbable clin d’œil à la ville allemande de Worms, un des anciens centres de la culture ashkénaze avant les bombardements américains de 1945. Le texte ne précise nulle part que Coen a fait partie des troupes de la libération — il faudrait pour cela qu’il fût né au plus tard en 1925, ce qui n’est pas vraisemblable étant donnée la chronologie du récit — mais sous-entend néanmoins que le souvenir se rapporte à un pays non-anglophone d’outre-Atlantique, où la devise n’est pas le dollar et la langue nationale n’est pas l’anglais. L’hypothèse allemande, si elle n’est ni logique ni chronologique, s’aligne en outre avec la sensibilité du personnage de Coen, ce fils orphelin de parents juifs suicidés, pour qui le flou des origines identitaires revient à l’absence d’un « noyau », d’un centre sur lequel construire son récit individuel — la mort de ses parents dans la gazinière, avec l’aide de l’oncle Sheb, frappe ainsi le passé de Coen d’un sceau traumatique, que ce retour à la ville rhénane permettrait de réactiver. Dans la perspective freudienne de la « contrainte de répétition », l’événement traumatique provoque un refoulement qui se manifeste par l’oubli : Coen, à plusieurs reprises, souffre de ne rien se rappeler de ses parents, et c’est précisément cette mémoire lacunaire qui, selon Freud, contraint le patient à « répéter le refoulé comme expérience vécue présente » (FREUD, 2010, p. 17), à « vivre passivement quelque chose sur quoi il ne lui revient aucune influence » (21) mais qui « ne [lui] fait que revivre toujours la répétition du même destin » (21). Le texte paraît ici recréer ce mécanisme de la mémoire dans lequel la pêche permet de se détourner du souvenir traumatique de la mort par carbonisation. Si l’épiphanie fruitée se place au premier plan, elle dissimule néanmoins des sensations chargées de sens, comme la soif et la sécheresse de la bouche, sensations qui rappellent indirectement la chaleur meurtrière du four, et qui rendent d’autant plus jouissives l’évocation de l’eau fraîche et de la chair juteuse et glacée. La remarque sur la « nationalité » de la pêche sabote en effet le plaisir de la scène, puisqu’elle fait pendant à l’antisémitisme qui est à l’origine de la série traumatique des Coen (de la chambre à gaz au four de cuisine à la mort par arme à feu). Le texte glisse en effet, d’une phrase l’autre, des tons rose-orange de la chair sucrée à la coloration « rougeâtre » d’un visage hémorragique, essuyant en quelques mots les dernières bouchées de fruit comme de la vie du flic. Enfin, le nom « Worms » prélude effectivement au tapeworm, ce ténia qui fait irruption dans le système digestif de Sidel quelque temps après la mort de son protégé, et convoque aussi, de façon certes plus ténue, l’iconographie de la vanitas, cette nature morte illustrant, par l’image du ver (« worm » en anglais) venu corrompre le fruit, l’éphémère de la vie et de ses sensations. Ce ver solitaire installé dans les entrailles d’un commissaire qui, en fin de compte, est responsable de cette mort prématurée, participera lui aussi de cette série traumatique dont il forme un ultime épisode : jusqu’à ce que le ver soit lui-même assassiné par une balle destinée à Sidel, le ténia incarne la voix post mortem et spectrale de Coen. Pour reprendre les termes de Cathy Caruth dans L’expérience inappropriable, la blessure physique qui est étymologiquement à l’origine du terme grec trauma, occasionne « une voix paradoxalement livrée au travers de la blessure » (CARUTH, introduction). Qu’elle soit physique ou mentale, cette blessure peut devenir parlante, donner à entendre une histoire, faire parler un mystère qui autrement resterait sourd et muet. Lorsque Coen meurt, il pourrait être l’archétype de toute une communauté juive dont il répète le destin tragique. Mais dans cette répétition se lit aussi une possible continuité, celle d’une voix insistante qui transite d’un corps à l’autre pour subsister, à la manière du microbiote de Sidel. Certes, ici, la mort effective de Coen infirme la possibilité d’une survie au sens propre, mais, comme l’écrit Cathy Caruth, la vie après le trauma n’implique pas seulement la survie, dès lors que derrière « l’urgente et inquiétante question : Que signifie survivre ? » en émerge une autre : « Que signifie survivre, pour la conscience ? » (CARUTH, chap. 3). Ici, le trauma collectif macroscopique (celui de la Shoah) se transpose à une autre échelle, celle de la blessure individuelle (de Coen), et même microscopique, celle du parasite intestinal (de Sidel) qui viendrait incarner la « conscience » de Coen, et plus largement une conscience collective. Le ver qui se rappelle à Sidel, dans la douleur la plus aiguë, aux moments critiques de sa vie de commissaire constituerait à lui-même une sorte de voix corporelle, sensitive, qui servirait à la fois une fonction mémorielle (un retour sur le passé) et perturbatrice (un appel à changer pour continuer). Ce remaniement des grandeurs opéré par Charyn grâce à une écriture hyper-sensorielle centrée sur le détail pourrait donc être lu comme une réponse originale à la question de l’impossible « catharsis collective » après la Shoah (COQUIO, 2011 ; DARMON, 2014).
Conclusion
Tout en investissant à sa manière certains aspects génériques du polar américain — la figure ambivalente du flic, la criminalité des bas-fonds, la violence gratuite ou rédemptrice —, Charyn déjoue les fonctionnalités de l’intrigue policière, celles qui visent principalement à créer une tension narrative, à donner une direction à l’enquête et à générer une résolution satisfaisante, pour développer un sous-texte imagé et poétique. Plutôt que d’être explicatif, le texte semble en effet opérer selon le mode affectif, ce que la prédominance de la synesthésie vient souligner. Alors que l’expérience sensorielle prend le dessus sur la compréhension intellectuelle, de façon particulièrement intense et concentrée au moment de la mort du personnage, une circulation s’établit, à la lecture, entre souvenir traumatique et présent de l’action, pour mieux en réagencer les différents items émotionnels. Ce sont alors un visage crispé, un corps tendu vers le ciel, une bouche humide, qui servent de points de bascule entre le vécu individuel du personnage en train de mourir et la mémoire collective de communautés historiquement persécutées, qu’il s’agisse du génocide amérindien contenu dans la référence oblique à Geronimo, de la Shoah, présentée comme lointain arrière-plan à la famille Coen, ou des populations marranes tourmentées dans l’Europe ibérique du xve siècle. Convoqués de manière simultanée, voire épiphanique (les trois morts sont comparées à l’instant ultime d’une danse, d’un baiser, d’un fruit goûté), les sens relaient la mémoire de façon corporelle, neurologique, cellulaire, sans passer par le biais du savoir articulé en concepts.
Certes, Charyn, féru d’histoire, a réalisé de savantes recherches sur l’histoire de l’immigration états-unienne, ce que viennent illustrer ses personnages d’idiots, qu’il s’agisse du péruvien Jerónimo Guzmann, de l’italien Teddy DiAngelis ou du slave Manfred Coen. Mais c’est bien traversée par un état de « rêve » que la lecture vient régénérer, par ses détours, ses digressions et ses dissociations, un inconscient collectif américain.