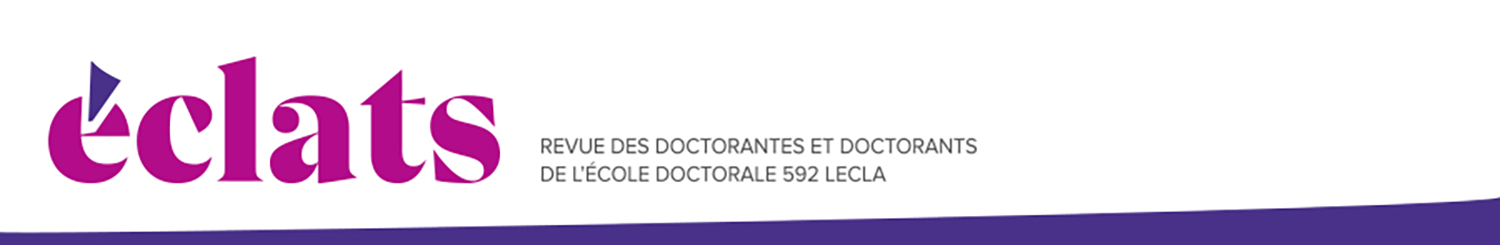Illustration 1 : Portrait de Sylvain Begon.
© Sylvain Begon, Le Pôle de l’oralité.
François-C. Rey (FCR) : Sylvain Begon, vous êtes doctorant en sociologie-anthropologie. Comment a débuté votre parcours académique avant de devenir aussi un parcours entrepreneurial ?
Sylvain Begon (SB) : J’ai commencé par un baccalauréat général Économique et social obtenu à Saint-Etienne avec une option en Sciences politiques. J’étais intéressé par la chose publique et le domaine public ; et, à 17 ans, la notion de citoyenneté attirait déjà ma curiosité. Ça m’a donné envie de poursuivre en licence de Sciences politiques et d’Histoire que j’ai obtenue à l’Université Lumière Lyon 2. Durant la dernière année universitaire de licence, en parallèle, j’ai effectué un Service civique en animation culturelle dans le lycée Sainte-Marie La Grand’Grange. C’est là où j’ai découvert le domaine de la pédagogie, de l’animation et de l’éducation populaire. C’est aussi là où j’ai obtenu par la suite mon premier CDD, et enchaîné à la rentrée 2020 avec un CDI. Dans le cadre de cette année de Service civique, j’avais monté un ciné-club et un club de débat, et j’ai fait pas mal d’animations autour du débat, autour des films. J’ai également co-organisé une disputatio dans laquelle j’ai mis ma patte avec une dimension assez citoyenne, assez valeurs républicaines aussi. Robert Mounier1 m’a ainsi proposé de continuer en me donnant l’opportunité de créer de toute pièce quelque chose qui puisse former et aider les jeunes autour de l’oralité. Il m’a donné carte blanche sans trop savoir ce que je pourrais proposer. J’ai alors pu créer un Pôle de l’oralité avec des formations, des projets, et plein de choses qui se sont agrégées au fil du temps.
FCR : Vous avez publié un livre sur la disputatio. Pourriez-vous nous rappeler brièvement ce que c’est, et préciser si ce livre est une sorte de manuel pour l’oral du baccalauréat ?
SB : Eh bien, une disputatio c’est une joute oratoire historique qui a ses origines chez Cicéron, qui a été reprise ensuite par les collèges – les écoles monastiques, devrait-on dire –, et qui est rentrée plus tard dans un côté plus historique et aussi plus religieux, puisqu’on la retrouvait entre les débats et les disputes qu’il y avait entre catholiques et juifs, et entre catholiques et protestants pendant la Réforme. La Disputatio2 est plus un livre universitaire d’enquête de sociologie de terrain pour les enseignants et les spécialistes. En revanche, Vive le débat3 est un autre livre beaucoup plus accessible pour les jeunes lycéens : il est préfacé par Jean-Pierre Obin qui a beaucoup travaillé sur ces questions de laïcité du débat, de fraternité, de valeurs républicaines ; et postfacé par Bertrand Périer qui est l’un des grands spécialistes de la prise de parole en public en France, et qui est aussi l’un de mes mentors. Ce petit livre-ci est vraiment tourné sur « comment en tant que citoyen je m’informe », « comment je peux sortir de mes préjugés », « comment je débats face à quelqu’un qui n’est pas d’accord avec moi », « comment je peux moi-même remettre en question mes propres opinions », « comment je vais produire une pensée qui part de mon opinion pour atteindre l’universalité et l’esprit de la collectivité ». Son ambition est qu’il soit un petit manuel pédagogique sur l’oralité, mais aussi sur la citoyenneté. Il est souvent offert aux jeunes en année de terminale pour les amener vers le Grand oral.
FCR : À partir de là, comment êtes-vous arrivé jusqu’en thèse ?
SB : J’ai été accepté à Sciences-Po Lyon, mais on ne m’y a pas laissé l’opportunité de monter le Pôle de l’oralité à côté, ce qui m’a fait refuser d’y étudier. Finalement, c’est l’Université Jean-Monnet qui m’a recruté en master Sociologie, sous l’égide du professeur Pascal Vallet qui m’a fait confiance. Il m’a dit : « Sylvain, tu auras l’opportunité de travailler sur l’oralité ; puisque l’on pourra te permettre de prendre du temps pour faire tes travaux aussi sur l’oral ». En master, Pascal Vallet nous accordait énormément de liberté. Il nous emmenait faire des visites de l’hôpital, des analyses sur le terrain. Il nous amenait aux musées, et il allait faire des déambulations dans la ville. Dès le master, j’ai commencé à faire mon mémoire de recherche sur l’oralité, et j’ai participé à deux colloques en tant que conférencier : j’ai fait la première conférence sur la disputatio et ses potentialités comme débat citoyen renouvelé, et j’ai fait la seconde sur la prési-lycéenne comme projet pédagogique d’éducation au politique au lycée. Pour la thèse, c’est le professeur Ahmed Boubeker qui est le troisième homme important dans mon parcours. En milieu-fin de master, il me disait : « Bon, Sylvain, pour vous, faites-moi ce que vous voulez ; et faites-moi quelque chose de bien », parce qu’il prévoyait que je pouvais le surprendre. C’était parfois trop de liberté parce que j’avais un peu de mal à être canalisé ; mais je préfère ça à quelqu’un qui balise tout. C’est lui qui m’a proposé la suite. Il m’a dit « Il faut que tu puisses faire un doctorat. Je te dis : « fais-le sur l’oralité ». C’est ta passion. Ça te plaît, donc nous te proposons de faire ça ». Cette passion m’a fait valider le master major de promotion, mais je n’ai pas obtenu le financement de la thèse en CIFRE ; et pourtant me voici maintenant en quatrième année de thèse sur l’oralité. Donc cela fait six ans que j’étudie ce domaine très large, dans ses perspectives, dans ses modèles éducatifs, dans sa phénoménologie, dans son anthropologie, dans son historique, et parfois dans ses productions sociales d’inégalités.
FCR : À quel moment avez-vous vraiment emprunté le chemin de l’entrepreneuriat ?
SB : C’est dans le même temps que j’ai développé le côté professionnel et le côté entrepreneur. La formation à l’entrepreneuriat est plus une opportunité proposée par l’université, par les réseaux Pépite qui sont des centres d’entrepreneuriat d’étudiants. C’est en première année de doctorat que j’ai découvert qu’il y a des formations doctorales obligatoires ; et, comme je travaille beaucoup au lycée Sainte Marie et que j’ai déjà mon activité mais non formalisée sous forme d’entreprise, j’ai décidé, à ce moment-là pour des motifs d’emploi du temps chargé, de faire une formation le temps de l’été, quand tous les jeunes dont j’avais à m’occuper étaient en vacances. J’ai fait la formation doctorale qui s’appelait la Summer School – école d’été « sensibilisation à l’entrepreneuriat ». J’ai choisi cette Summer School en me disant que ça allait me faire découvrir un autre monde, et j’ai, pourquoi pas, tenté une petite semaine pour sortir aussi de ma zone de confort, et découvrir un peu le monde professionnel, parce que je ne le connaissais à l’époque pas si bien que ça : j’étais resté plutôt dans le monde académique. Je suis quelqu’un de très curieux ; et ça allait être une découverte.La Summer School durait une semaine : j’y ai été en contact avec Valentin Joannet, qui en était l’organisateur, et qui m’a fait découvrir le réseau du Centre d’Entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne. Avec d’autres doctorants, nous nous mettions dans la peau d’un entrepreneur, et j’y ai créé une entreprise fictive. C’était une sorte de défi : pendant trois jours nous avons été immergés dans le climat entrepreneurial avec d’autres doctorants, et nous avons pu découvrir ce que c’était de créer une boîte ; et pris conscience que nous doctorants avions des compétences entrepreneuriales dans tout le sens du terme, pour préparer une création d’entreprise, ou même un projet citoyen ou une association. Il se trouve que nous avons gagné le concours de pitch devant un jury d’entrepreneurs. J’ai adoré faire ça. Je me suis révélé visiblement suffisamment bon orateur, puisque l’on m’a demandé de revenir. Je me suis dit : « mais... en fait, je suis capable ! » ; alors que, pour moi qui suis fils d’ouvrier, l’a priori était que nous sommes tous des fonctionnaires et salariés de classes moyennes et populaires. Là, je me suis dit : « L’entrepreneuriat, ça a l’air sympathique. Pourquoi pas ?! ». J’ai commencé à intervenir à l’extérieur de mon travail salarié, en bénévolat. Je n’avais pas encore l’entreprise, mais j’avais déjà cette idée là ; et je me suis dit : « Effectivement... S’il y a une demande... Pourquoi pas créer mon entreprise ? ». J’ai fait cette formation, et c’est là que j’ai vu que c’était proposé par le Centre d’Entrepreneuriat, et qu’à la suite de cette formation on me proposait de passer le diplôme d’étudiant entrepreneur, ce qu’on appelle le « D2E ». Moi, je ne savais même pas qu’il existait un diplôme d’entrepreneuriat. J’ai été assez surpris. Je me suis rendu compte qu’il y avait des compétences entrepreneuriales, que c’étaient des vraies compétences : ça n’a rien à voir avec le salariat ; rien à voir avec le côté professionnel. C’est vraiment un métier à part entière ; et d’ailleurs un métier très exigeant avec des compétences très larges dans plein de domaines. Il faut savoir tout faire : il faut savoir vendre, savoir créer, savoir innover, savoir marketer… Il faut savoir vraiment tout faire. C’est vraiment le coté multicartes et transdisciplinaire qui m’a aussi beaucoup plu.J’ai donc entamé un an de diplôme Etudiant-entrepreneur (D2E), compatible avec la thèse. J’ai fait la Summer School en juillet ; en septembre j’en étais au D2E ; et ensuite, en plein milieu de cette formation, en mars 2023, j’ai créé mon entreprise en me disant qu’ils allaient continuer à m’accompagner. J’ai continué le D2E un an de plus pour pouvoir bénéficier d’une année d’accompagnement supplémentaire. Quand j’ai eu une formation à un moment donné, je n’étais pas très disponible ; et j’ai mis un peu ma première année de thèse de côté parce que je ne pouvais pas tout faire. Je ne suis pas venu à toutes les formations la première année, mais il y a eu vraiment un déclic qui m’a fait dire : « Tiens, voilà quelque chose où il faut que je sois vraiment présent à 100 % », et ça a bousculé un peu la hiérarchie de mes priorités. C’est quand j’ai fait une formation sur la vente et que j’ai vendu pour la première fois, grâce à cette formation, que j’ai eu le déclic ! Ce n’est pas toujours évident de vendre un service à un groupe, et quand j’ai fait cette formation avec plein d’astuces et que je suis tombé face à un très gros client, qui est aujourd’hui un de mes plus gros contrats que je renouvelle depuis trois ans, et que j’ai réussi à vendre une grosse palette de formations d’un coup grâce à cette formation que j’avais eu quasiment la veille, eh bien je me suis dit : « Tiens, mais là, il ne faut vraiment pas que je sous-estime les perspectives et les opportunités, les potentialités de ces formations ». Donc, j’ai demandé un redoublement, comme un cadeau. La deuxième année m’a encore plus apporté, parce que je savais vraiment pourquoi je venais cette fois-ci. J’avais compris l’enjeu. Parce que j’ai redoublé, j’ai eu deux mentors avec qui j’ai pu échanger. J’ai eu énormément de contacts. J’ai vécu des formations dans ce cadre qui m’ont permis de me former aux compétences entrepreneuriales, de faire du réseau ; et qui m’ont permis aussi de découvrir mes potentialités qui étaient un peu enfouies, comme le plaisir pour la vente ; de découvrir aussi des petites astuces, des petits conseils. Ça a été une opportunité incroyable et une sorte d’événement déclencheur pour me dire : « Allez ! Je me lance ! J’y vais ! ». Et me voici depuis quatre ans en thèse et depuis deux ans et demi, entrepreneur.Aujourd’hui, le Centre d’entrepreneuriat est mon partenaire (voir illustration 2), et je donne une formation qui s’appelle « Oralité et entreprenariat ». Elle prend la forme d’un challenge dans lequel les jeunes, par groupes de 4, créent une entreprise de manière fictive, en vivant dans la peau d’un entrepreneur les différentes étapes oratoires, comme « passer un coup de fil » ou « négocier un prêt avec un banquier ». C’est un peu la formation que j’ai vécu à la Summer School, mais j’y ai apporté un côté un peu plus éducatif, un peu plus sensibilisation et découverte, et puis le côté de l’oralité. Et puis, maintenant, le Centre d’Entrepreneuriat intervient avec moi pour faire quelques présentations du D2E et sensibiliser un peu les jeunes. Et comme ils sont au lycée en général, ou en première année de l’université – le D2E recrute souvent à partir de la fin de la licence –, ça me permet déjà de faire une pré-sensibilisation, et de leur rendre un petit peu ce qu’ils m’ont donné, aussi, humblement.
Illustration 2 : Sylvain Begon (premier plan) à la table des jurés du challenge de création d’entreprise en 2023.
© Sylvain Begon, Le Pôle de l’oralité.
FCR : Que fait votre entreprise ?
SB : Le Pôle de l’oralité est un organisme de formation qui s’adresse d’abord aux jeunes de 14 à 25 ans : des collégiens de fin de collège, des lycéens quel que soit leur lycée, professionnel, technologique ou général, des étudiants, BTS, école des mines, faculté de médecine, etc. C’est un organisme qui vient proposer des formations, des ateliers, des accompagnements personnalisés, pour les aider à développer des compétences oratoires, afin de réussir leur vie. Que cela soit une vie académique avec un oral académique, ou une vie professionnelle puisqu’à 25 ans on peut déjà commencer sa vie professionnelle – un entretien d’embauche, une insertion (ce que l’on appelle l’onboarding, soit le fait d’entrer à bord d’une entreprise). Ça peut être aussi émotionnel, voire social, comme ça a été mon cas, pour développer des compétences de gestion des émotions et des compétences de relation. Le Pôle de l’oralité est labellisé depuis maintenant deux ans par le ministère de la Culture via le pass Culture. J’ai créé un concours qui s’appelle « On est tous orateurs », et c’est pour ça aussi que je fais une thèse : pour rendre ces travaux accessibles à tous.
FCR : Sous quelle forme avez-vous créé l’entreprise Pôle de l’oralité ?
SB : En termes de statuts, c’est une auto-entreprise, on dit maintenant microentreprise, sous la marque « Pôle de l’oralité ». L’une de ses spécificités est d’être une entreprise culturelle. C’est un tout petit secteur d’activité, puisque le secteur culturel correspond parfois à des troupes de théâtre, à de l’événementiel, ou à des entreprises qui travaillent parfois sur de l’éducation populaire.Le Pôle de l’oralité vient former à la prise de parole en public sous toutes ses formes. Le parti-pris est de ne jamais laisser la prise de parole en public seule et pour elle-même, alors que c’est souvent le cas dans le cadre de la formation professionnelle à la prise de parole en public, qui forme en fait à ce que l’on appelle l’éloquence ; c’est à dire que l’on vient y parler pour parler ; et c’est de la belle parole, c’est un art, effectivement ; mais ce n’est pas exactement ce que j’enseigne. J’enseigne plutôt de l’oralité pour ses potentialités. Ça peut être pour une découverte ancrée dans la réalité immédiate, telle que gérer ses émotions, mais aussi pour des choses plus intellectuelles, cognitives, comme dépasser des biais cognitifs, revenir sur certaines de ses croyances, s’ouvrir à des intelligences multiples, ou tout simplement réussir quelque chose que l’on veut entreprendre, comme le baccalauréat, un oral du brevet. Par exemple, j’organise actuellement un projet qui permettra aux jeunes à la fois d’être sensibilisés aux métiers d’avenir, notamment autour de la transition numérique démocratique et écologique, et de se former à l’art difficile et oratoire de l’entretien d’embauche. L’idée est de vivre les entretiens d’embauche du futur.
FCR : Avez-vous des collaboratrices et des collaborateurs ?
SB : Ma marque de fabrique est de tout faire moi-même. Je préfère une communication « faite main », moins professionnellement stéréotypée et plus authentique. Ça me distingue de grands organismes parisiens de formation, qui parfois font de l’ingénierie dans un bureau à Paris, ont des coachs en province, et viennent finalement dupliquer les formations. Je fais du sur-mesure et à la carte. Après, ça ne m’empêche pas d’avoir un réseau de jeunes qui s’appelle « les alumni du Pôle de l’oralité ». Ce sont des anciens élèves qui obtiennent, pour ceux qui le souhaitent, un statut d’ambassadeur de l’oralité pour un an : ils continuent à intervenir dans le cadre du Pôle en venant faire passer des oraux à mes côtés, et deviennent parfois co-conférenciers durant un temps de parole que je leur laisse notamment dans le cadre des conférences que j’ai pu lancer à partir de janvier 2024. Ça leur met le pied à l’étrier en continuant d’apprendre gratuitement sur le terrain durant une année... deux années pour ceux qui le souhaitent. Ils sont une quinzaine cette année.
FCR : Vous participez comme candidat à des concours oraux, et vous en organisez vous-même...
SB : Le concours le plus récent auquel j’ai participé en candidat est celui de « Ma thèse en 180 secondes », en mars, parce que je voulais remettre mon oralité personnelle en scène, et parce que je rouille parfois en ne restant qu’à ma place. Depuis le début de l’année 2024, j’ai entamé un cycle de conférences : « L’oralité pour réussir ses vies » : il s’agit de faire prendre conscience aux gens de l’importance de l’oralité dans leur vie professionnelle, sociale, citoyenne et personnelle, jusque dans leur voix intérieure. Le cycle sera décliné pour tous les âges, avec des histoires de vie que j’ai vécues ou que mes étudiants et adultes coachés ont vécues. Certains aspects seront développés de manière plus spécifique.
FCR : Le Pôle de l’oralité propose un menu de services comme des simulations d’entretiens, débats-concours, projets radio, bilans de compétence ou « Développer l’oralité d’entreprise et l’entrepreneuriat » ; mais vous acceptez aussi des commandes ad hoc puisque récemment vous avez animé un café-débat pour une municipalité. Quelles sont donc vos prestations les plus représentatives ?
SB : Je distingue quatre types de services que je peux proposer aux partenaires (je ne les appelle pas « clients » parce que j’ai choisi de les accompagner sur du long terme) : les formations, ateliers, projets et accompagnements individuels. Une formation, c’est un produit intellectuel, avec une ingénierie de formation. Je planifie en amont un service où je vais être à la fois dans du magistral et dans la démarche d’interaction orale avec les jeunes, mais aussi avec les professionnels. Les plus choisies vont être les formations de base de l’oralité : celles pour les classes de seconde au lycée notamment ; et aussi celle qui est en train d’être développée pour les troisièmes pour l’oral du brevet. Ensuite, en termes de projets, il y a des concours et des journées types « oralité ». C’est de la création de projets. L’un des plus choisis cette année a été le « Concours de l’oralité », parce qu’il a été représenté à l’Université Jean Monnet. C’est un partenaire prestigieux pour moi, puisque ceux qui me prêtent leur confiance en tant que doctorant me la prêtent aussi en tant que professionnel. Et puis, en termes de coaching et d’accompagnement personnalisé, ça va être des bilans de compétences à la base, qui continuent aussi sous des formats d’accompagnement. Le plus récurrent est celui que j’appelle « l’accompagnement émotionnel ». Par le biais de l’oralité, il y a des personnes qui vont se sentir intéressées pour être accompagnés. Ça commence souvent par un besoin lié à un oral que l’on va passer – le Grand oral du bac, l’oral du brevet –, et ensuite les jeunes ou notamment les adultes trouvent finalement intéressant de continuer après l’oral préparé, de trouver leur voie et se former davantage à des compétences émotionnelles. Parmi les partenaires, il y a des universités, des lycées qui représentent au moins la moitié de mes clients, mais aussi des collèges qui sont la nouveauté de cette année ; des centres de formation par alternance Maison Familiale et Rurale ; et des entreprises et des salariés, dont certains s’engagent parfois même en dehors de leur temps de travail : ce sont des compétences qui vont être bénéfiques pour le professionnel, mais aussi pour eux dans le social et dans l’individuel.
FCR : Comment faites-vous la part des choses entre vos activités d’enseignement auprès de jeunes en tant que salarié, vos activités de thèse, et vos activités de formation de jeunes et de professionnels via votre entreprise ?
SB : J’ai bien trois activités qui portent sur l’oralité : la recherche doctorale, une petite activité salariale, et mon entreprise. Ce sont des logiques à la fois complémentaires et bien distinctes. Il y a une activité dans la logique de la thèse, qui est de la recherche, de l’analyse et aussi des résultats de terrain. Cette recherche est corrélée à mon salariat à Sainte Marie La Grande Grange. Et le Pôle de l’oralité est ce que j’ai entrepris et fondé au départ pour les jeunes de ce lycée, qui est toujours ma propriété intellectuelle et que j’ai formalisé en microentreprise, et dont je continue à développer les concepts et à mettre en œuvre les actions, maintenant bien au-delà de ce lycée. Mon poste salarié est la partie où je suis responsable de formation oralité, animateur culturel au lycée, dans un espace cohérent qui s’appelle simplement le Pôle. J’y impulse moi-même la majorité des projets, et je favorise une cohérence sociale et un espace d’ouverture avec ceux des autres enseignants. Avec l’entreprise, il y a aussi l’ouverture sur les autres établissements : les professionnels, le monde de l’entreprise. Avec la thèse, il y a pour moi une cohérence qui est très importante : c’est-à-dire que la théorie vient nourrir la pratique. J’ai besoin de fortes bases théoriques que j’ai apprises grâce à la thèse : un cadre de lecture, un cadre conceptuel, un cadre d’analyse, et aussi un cadre et des compétences de réflexivité, tout en étant distant, puisque le travail de thèse débouche sur un écrit ; tandis que la qualité de mon travail actuel c’est plutôt de la production orale. Donc, en salariat on me « paye » pour parler et enseigner, alors qu’en thèse on me « paye » avec de gros guillemets puisque l’on ne me paye pas pour écrire avant tout [rires].
FCR : Pourriez-vous revenir sur la relation entre le Pôle de l’oralité et votre doctorat ?
SB : Étant donné que le Pôle de l’oralité existait déjà, le doctorat se fonde sur le terrain qu’est Sainte Marie La Grande Grange ; ce qui permet de former des jeunes, de pouvoir aussi les étudier. Ça s’est encore ouvert sur la fin de la thèse avec la création de mon entreprise. C’est une recherche-action dans une temporalité ; et je ne peux donc pas faire comme si je n’existais pas, comme s’il n’y avait pas eu un tournant, comme si je n’avais pas changé d’ouverture d’esprit aussi sur l’entrepreneuriat. Le lien est avant tout pédagogique et dans l’incarnation que je peux avoir. Le doctorat vient être une sorte de complément qui permet en premier lieu d’acquérir des connaissances en tant que personne, d’avoir une base de lectures, de données, de raison, de réflexivité et recul sur mes travaux. Et en même temps, le doctorat est aussi une forme de légitimité, qui est très forte parce que c’est celle de l’université, qui permet de donner au Pôle de l’oralité une dimension scientifique à laquelle je tiens énormément ; et je tiens à montrer avec ma thèse qu’un travail a été fait, et qu’il peut être valorisé scientifiquement. Si je fais une thèse, c’est justement pour la rendre accessible à tous.
FCR : Quel vécu avez-vous du passage d’étudiant-salarié vers étudiant-entrepreneur ?
SB : Ce n’est pas un passage comme dans une course de fond avec relai : le coureur est toujours le même. Le salariat a continué pour moi. En fait je suis étudiant-salarié-entrepreneur. Côtoyer trois formats différents – académique, professionnel engagé pour quelqu’un d’autre, et engagé pour soi-même devant les autres – c’est un point de vue qui est intéressant, qui me va plutôt bien : j’aime la diversité de points de vue, et par nature j’ai du mal à renoncer. Je travaille plus d’heures qu’un salarié ; mais c’est la saisie d’une opportunité à la suite du D2E. Aujourd’hui, je me rends compte que ça me plaît ; que l’entreprise fonctionne ; qu’elle gagne chaque année de nouveaux partenaires et s’élargit : depuis cette année 2024, c’est nouveau, je sers des collèges et je sers des professionnels. Je m’oriente de plus en plus vers les professionnels ; donc je me dis : « Il y a encore une ouverture. Il y a encore quelque chose à faire. Peut-être qu’un jour le choix se fera ».
FCR : Que vous a apporté d’un point de vue personnel le cadre du diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E) ?
SB : Le D2E m’a permis de prendre conscience et m’a encouragé. On sent que l’on est capable et on apprend des choses ; et je me suis dit : « En fait, j’ai appris tout ça. Le meilleur moyen de voir si je suis vraiment capable de le faire c’est de le tenter ». Donc il y a quand même une prise de risque à un moment ; mais c’est une prise de risque très limitée, dans le sens où je suis salarié, et où je travaille aussi ma thèse, même si je ne suis pas financé pour.
FCR : Sociologue, conférencier, formateur, auteur... Quel titre professionnel choisissez-vous pour vous-même ?
SB : Je prends toutes ces casquettes de conférencier, d’orateur, de tout ça, avec des grosses pincettes. Je fais de la peinture en amateur, et pourtant je ne suis pas peintre [rires]. J’aime la double casquette scientifique-entrepreneuriale, et j’aime rester dans cette dualité. J’aime bien aussi spécialiste de l’oralité, parce que c’est une culture, l’oralité, et ça correspond à toutes les facettes que je peux avoir et qui regroupent l’ensemble de mes activités, qu’elles soient d’ailleurs même écrites ou orales. Il y a le côté enseignement, le côté pédagogie… Alors que l’éloquence est un art de l’instant, l’oralité est ancrée corporellement, historiquement, culturellement. Finalement, je préfère mettre la casquette de fondateur du Pôle de l’oralité… Fondateur du Pôle est celle qui finalement me permet de regrouper le lycée et un peu le doctorat. Ensuite, qu’est-ce que c’est qu’entreprendre ? C’est une démarche par projets ; et c’est aussi l’idée de créer quelque chose qui est fort pour moi. On vient événementialiser sa vie. Il y a une démarche du « je » qui est forte. Les entrepreneurs ne sont pas forcément des personnes qui vont avoir un ego surdimensionné, mais qui vont être un peu hors des moules que le salariat peut imposer. C’est quelqu’un qui rentre un peu dans une case, mais reste un peu à côté ; ou qui vient amener une case ailleurs. En fin de compte, c’est ce que j’aime faire : je ne suis pas toujours d’accord avec l’éducation nationale. Ça ne veut pas dire que je suis contre l’éducation nationale. J’ai simplement d’autres visions. J’ai peut-être quelque chose à apporter ; et finalement ils en sont contents. Pour moi, un entrepreneur, c’est quelqu’un qui cherche à innover, créer, et faire des choses aussi pour autrui. Je suis à leur service, et je viens leur fournir ce qu’ils me demandent ; avec aussi l’esprit critique de « si ça ne porte pas ses fruits, je ne le fais pas », mais pleinement au service des autres ; et d’ailleurs parce que la démarche client oblige à vendre. C’est ça aussi quand on crée une association : ce n’est pas « Je pense que j’ai la bonne idée. Je vais la donner aux autres » ; c’est finalement : « Les autres ont cette idée-là. Ils veulent ça. Ils ont besoin de ça. Nous venons leur apporter le service, l’idée, le concept, ou bien l’action aussi, dont ils ont besoin ». Donc, c’est partir des autres ; et c’est ça le lien social. Je suis à fond dans les projets (voir illustration 3). Dans le salariat, certaines logiques qui me paraissent un peu répétitives peuvent parfois m’ennuyer un peu. Dans l’entrepreneuriat, il y a toujours quelque chose à creuser, à chercher ; on se remet tout le temps en cause. Il y a des choses que l’on rate, des soirées de la loose de l’entrepreneur [rires] ; et j’aime bien aussi ce côté de l’échec que l’on vient solutionner, améliorer.
Illustration 3 : Les neuf lycéennes et lycéens finalistes du concours d’oralité 2023 entourant Sylvain Begon.
© Sylvain Begon, Le Pôle de l’oralité.
FCR : Quels genres d’organisations font partie de votre clientèle au Pôle de l’oralité ?
SB : Ce sont des institutions et parfois des associations scolaires, parfois directement sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale. Et en termes d’entreprises, ce sont plutôt celles du para-public ; et parfois des entrepreneurs qui veulent se former à ces enjeux-là, des microentreprises avec 4 ou 5 salariés, qui démarrent du côté de la formation et veulent gagner du temps. Ces entreprises connaissent mon parcours sciences politiques et savent que je dialogue beaucoup avec les élus de tous bords et avec le personnel politique qui sont leurs interlocuteurs. Je ne cherche pas forcément des clients, mais plutôt des partenaires pour incarner cette oralité pour tous. Quand je parle à des gens qui viennent de l’économie sociale et solidaire, et quand nous allons voir des patrons de grands groupes, ce n’est pas le même public ; mais quand il y a des jeunes qui sont en jeu... Quand on parle aux écoles en leur disant : « Est-ce que vous voulez que vos jeunes aient des emplois à la suite ; qu’ils puissent développer des nouvelles compétences et avoir l’ouverture d’esprit ? », là, tous les établissements du secondaire me disent : « Bravo Sylvain. Tu as raison. C’est ça qu’il leur faut ». Et quand je vais voir les entreprises et que je leur dis : « Est-ce que vous voulez des jeunes compétents, qui savent réussir un entretien d’embauche et qui vont être qualifiés pour votre métier ; et qui en plus ont été formés à cet exercice ? », ils me disent : « Bravo. On signe ». Je comprends les logiques de chacun, car j’appartiens moi aussi un peu à leur monde, sans m’y restreindre.
FCR : Le fait d’avoir suivi une formation d’étudiant-entrepreneur a-t-il changé quelque chose dans la façon de mener vos études universitaires ?
SB : Je vais tenter une réponse... Je dirais que ça a quand même plutôt changé ma perspective personnelle d’opportunité de fin de thèse, que ça m’a ouvert des portes pour dépasser la croyance, assez bien établie, qu’un chercheur deviendrait uniquement enseignant-chercheur. Cette liberté – et je ne veux pas dire que j’ai renoncé à devenir enseignant-chercheur – permet de voir les choses sous un horizon complètement différent. Ma thèse n’est pas l’alpha et l’oméga de ma vie. C’est le tiers de ma vie professionnelle : tiers salarié, tiers entreprise, tiers doctorant.
FCR : Qu’est-ce qui apporte le plus à l’autre : les études universitaires ou l’entreprenariat ?
SB : Si je n’ai pas de compétences, je ne vends rien. À un moment donné, le fait de faire des études, de prendre la parole dans un contexte académique, d’avoir une licence, un bac+5, trois ans de doctorat validés même en ayant pas encore soutenu, ce sont aussi des connaissances importantes que j’ai pu acquérir pendant toutes ces années, ce qui fait que c’est ça que je peux vendre aujourd’hui. Si je n’avais pas fait d’études, je ne serais peut-être pas un spécialiste des oraux académiques d’aujourd’hui. Il faut rendre à l’université ce qui lui appartient, ce qu’elle nous donne. En revanche, du point de vue de l’ouverture d’esprit et de l’ouverture au réel – et ça ne veut pas dire que l’université soit déconnectée du réel –, avoir un pied dans l’entrepreneuriat et un pied dans le travail m’a donné des compétences professionnelles qui sont plus concrètes. Ce que j’ai fait, ce sont des projets qui existent, déjà dans la réalité ; et non pas juste « l’université vous conseille » ce qui reste de l’idée. Ce côté très concret de la pratique, « Aristote face à Platon », est plus professionnalisant que d’avoir un cours qui nous explique comment ça se passe. À un moment donné, il faut quand même se confronter au réel. L’université m’a apporté de nombreuses connaissances et compétences ; mais c’est par le biais de la pratique plus que par le biais des idées que l’université m’a ouvert des portes vers le monde de l’entreprise et vers le monde de l’entrepreneuriat.
FCR : D’un point de vue plus général, qu’est-ce qu’entreprendre peut apporter à des personnes qui ont un parcours universitaire ?
SB : Entreprendre est aussi une forme de liberté. C’est oser s’ouvrir un chemin vers les autres, parce que dans l’entreprenariat on part des autres pour répondre à un besoin. Parfois on a l’impression que l’on a la bonne idée, mais la bonne idée pour personne qui veut de cette bonne idée, c’est une bonne idée pour vous-même, et ça ce n’est pas tellement ce que l’on vous demande en tant qu’entrepreneur. Donc, j’aime l’idée que l’on part des besoins des autres. On répond à un besoin présent dans la société, ou qui est peut-être encore un peu inconscient. Pour reprendre mon exemple, le besoin d’oralité n’était pas vraiment conscient quand j’ai débarqué, surtout dans les établissements du secondaire. C’était plus ouvert pour de la formation professionnelle, mais j’ai fait un autre choix averti, qui a correspondu au besoin. Je vois bien le Pôle de l’oralité comme une interface entre les autres et moi : il y a un peu de moi et il y a aussi les autres. D’ailleurs, de ce point de vue, c’est moins moi qui fais une thèse que les autres qui sont en train de la faire pendant que moi je la produis en étant une interface. L’entrepreneuriat, ça peut être un moyen de se connecter au monde, si on a envie d’entreprendre sa vie avec ses valeurs, c’est à dire de créer quelque chose qui nous ressemble, avec aussi la volonté d’être son propre patron. C’est cette liberté, et, en même temps, il faut aussi avoir conscience que c’est énormément de responsabilités. Comme c’est notre nom qui est affiché partout, si ça marche, « Très bien » ; mais si ça ne marche pas, c’est un peu votre faute. Donc, c’est un peu compliqué parfois à vivre, mais c’est passionnant. Ça peut permettre de ne pas forcément s’enfermer uniquement dans le giron universitaire, de convertir des compétences et des connaissances dans d’autres mondes. C’est un mode de pensée différent de l’université pour quelqu’un qui parle un langage académique. Quelqu’un qui, ensuite, si je reprends une métaphore de l’oral, sera capable d’aller discuter avec l’ouvrier qui boit une bière dans un bar ; et moi j’adore ça ; et qui sera capable d’aller discuter avec un grand patron de banque. Je pense que ça ouvre énormément au monde, dans sa pluralité, dans sa diversité. Évidemment, les exemples sont pris au hasard [rires].
FCR : Comment ce que vous développez est-il partagé à travers votre laboratoire ?
SB : Nous avons un laboratoire à cheval entre Saint-Etienne et Lyon, ce qui fait que le lien via ce réseau est complexe à mettre en œuvre. Du côté recherche, nous avons bien sûr les présentations et les colloques auxquels je peux participer au sein du laboratoire, la journée des doctorants, et la sensibilisation doctorale que j’ai faite avec les élèves de master 2. J’intervenais aussi dans le master FOULE et dans d’autres masters pour faire de la sensibilisation à l’oralité. À un niveau plus général, cette année, l’université a été partenaire du concours « On est tous orateurs », et a décidé de financer la participation des jeunes étudiants à ce concours, toutes filières confondues, y compris de l’IAE et du pôle de Roanne. L’idée était d’amener les différentes composantes universitaires à se saisir de la question de l’oralité via ce dispositif.
FCR : Si nous reprenons les aspects de transformation : qu’est-ce que le fait de devenir chercheur a impliqué et changé ?
SB : Ce n’est pas toujours évident de se séparer de son objet d’étude en sciences humaines et sociales. Dans le monde social on est un peu « pris dans l’éprouvette ». J’ai créé aussi les conditions de l’apparition de mon objet d’étude dans le monde social. Ce sont des enjeux de réflexivité qui font partie des angles les plus importants de ma thèse actuellement. Ce travail-là me permet justement de prendre beaucoup de distance sur ce que je peux faire, et d’être très critique vis-à-vis de mes propres travaux. Dans ma thèse, les enjeux de réécriture correspondent aussi au début du Pôle avec toutes ces erreurs, toutes ces maladresses, ces voies sans issue, ces sens interdits que j’ai pu prendre dans sa création ; parce que ça fait des années que je monte ça. Aujourd’hui je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pourquoi. La thèse me permet de comprendre, d’avoir une vision d’ensemble avec du recul. En tant que coach, j’interviens sur l’individu ; et en tant que chercheur, j’arrive à voir toute une nouvelle perspective de la structure sociale qu’il y a derrière ce monde de l’oralité, les espaces de formation, les espaces de domination, le côté historique. C’est pour ça aussi que j’apprécie de ne pas me cantonner au monde scolaire, dont l’oralité n’est qu’un des mondes de l’oralité. C’est du multi-casquette qui me convient tout à fait. Pour dire les choses simplement, le coach est capable de voir l’individu, d’étudier un caillou sur une planète lointaine et de le caractériser, mais le chercheur en oralité lui va voir toute la galaxie, autour de ce caillou, les logiques de sa formation, l’espace infiniment plus vaste dans lequel il s’insère et surtout, beaucoup plus de variables qui impactent son existence, son évolution et sa catégorisation.
FCR : Et si nous revenons sous la casquette entrepreneur, que vous a-t-elle apporté en tant que créateur ?
SB : À l’instar de Voltaire, je dirais : « Je ne suis pas forcément d’accord avec votre projet, mais je me battrai pour que vous puissiez le faire », pour apporter un soutien sans faille à tous les porteurs de projets citoyens, associatifs, chercheurs, etc., sans attendre l’aval de tous, parce qu’il y a presque toujours des gens qui vont s’opposer pour le plaisir de dire « non ». Le côté entreprenariat m’a libéré de contraintes injustifiées sur ces considérations d’opinion unanime. Ça m’a permis de me dire : « Mais en fait, je suis libre, et je peux le faire », sans forcément une nécessaire autorisation. Me dire que j’avais plus de liberté dans l’entreprenariat, c’était quelque chose d’incroyable, et ça m’a donné des ailes pour faire.
FCR : Qu’auriez-vous envie de dire à d’autres chercheurs qui s’interrogent sur l’entrepreneuriat ?
SB : Ouvrez-vous. Faites ce que vous ne savez pas faire, et vous verrez qu’en fait vous savez le faire. Le doctorat apporte énormément de compétences sous-jacentes à ce que l’on a l’habitude de faire, qui nous amènent vers des mondes différents : le privé, le conseil, la formation, dont les enjeux appellent des compétences qui sont notamment en SHS. On a parfois tendance à s’effacer un peu, derrière la thèse, derrière ses travaux, derrière son terrain, derrière l’entreprise qui nous finance. Et là, on peut se retrouver, amener des nouvelles perspectives, des chemins à emprunter. Testez. Allez-y. Déconstruisez-vous. Reconstruisez autre chose. Vous n’êtes pas votre thèse. Vous avez déjà un peu entrepris dans vos vies : votre vie de couple, votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie de doctorant, de chercheur. Donc, vous avez déjà fait de l’entrepreneuriat sans le savoir. Laissez-vous tenter par un chemin nouveau.